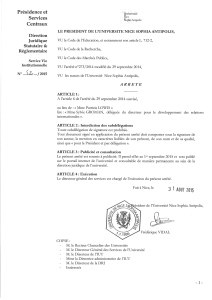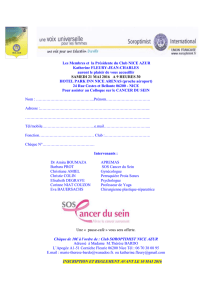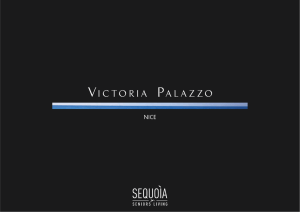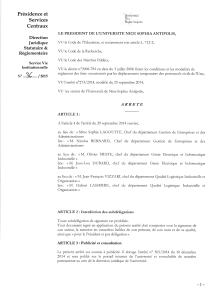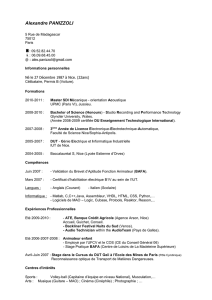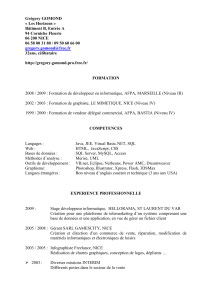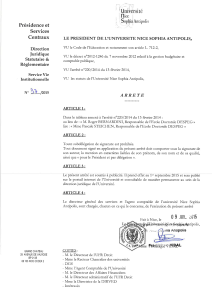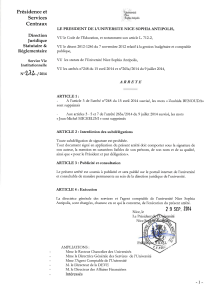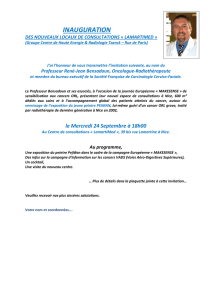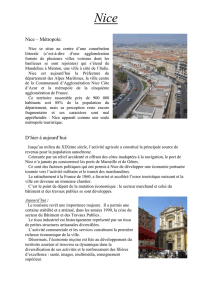les russes et la cote d`azur

Gérard Saccoccini
Les Russes à Nice au XIX°s.
LES RUSSES A NICE AU XIX° S.
Dès 1749, l’Empire russe avait ouvert une représentation consulaire à Nice.
En 1770, commandée par l’amiral Alexis Orlov, la flotte impériale voguait vers la Turquie et fit escale en
rade de Villefranche : l’amiral voulait rendre visite à son ami Jean-Michel Auda, conseiller de commerce en
Russie pour promouvoir les échanges avec les Etats Sardes.
Plus tard, en 1847, le prince Gagarine, diplomate et grand amateur d’art, rencontra lors d’un séjour à Nice le
peintre Joseph Fricero qu’il invita à la cour de Saint Petersbourg afin d’initier au dessin les trois filles de
Nicolas 1er et Joséphine Koberwein, fille naturelle du tsar. Le peintre tomba amoureux de Joséphine et leur
mariage, le 18 décembre 1848, marquait le début de la longue histoire d’amour de l’amitié russo-niçoise. C’est
ainsi que tout commença !
MECENES ET GENEREUX DONATEURS
Les résidents russes se succédèrent à Nice, réalisant les magnifiques édifices qui constituent aujourd’hui
encore un prestigieux patrimoine. La Grande Duchesse Olga, fille de Nicolas 1er, fonda l’hôpital militaire russe
et de nombreuses œuvres caritatives pour soulager la détresse des familles de paysans et de pêcheurs. Dès 1900,
le prénom d’Olga était omniprésent dans les foyers niçois.
Le baron Von Derwies, magnat des chemins de fer, fit construire dans un parc magnifique sa « folie
gothique » : le Château de Valrose, aujourd’hui siège de l’Université de Nice.
L’épouse du marguillier de la cathédrale de la rue Longchamp, princesse Elizabeth Kotschoubey aménagea
sur la colline de Fabron une superbe résidence, aujourd’hui musée des Beaux-Arts Chéret.
Sur l’oppidum de Cimiez, la baronne Manteuffeld, fille du comte Apraxine et de la princesse Troubetzkoï,
fit bâtir une splendide villa de style néo-classique italien. Devenue école maternelle, son parc a été transformé
en jardin public souvent malmené par des hordes de barbares en culottes courtes.
En 1885, l’architecte russe Adam Detloff aménageait le Château des Ollières, sur la colline des Beaumettes,
pour le prince Lobanov-Rostowsky, proche du tsar Alexandre II. En 1889, il construisit le gigantesque Grand
Hôtel pour la famille impériale et sa suite. Au cœur de ce quartier, où l’on parlait russe dans les rues, les
commerces se mirent au goût du jour et leur objet s’inscrivait en russe ! Pendant longtemps, à l’angle du
boulevard Tsarévitch et de l’avenue du Parc Impérial, exista un célèbre bureau de tabacs : la « Civette russe ».
Une autre grande figure de l’aristocratie russe, Katia Dolgorouki, épouse morganatique d’Alexandre II,
assassiné par les nihilistes, vécut recluse dans la luxueuse villa Georges, boulevard Dubouchage. Celle que le
tsar avait surnommée son « démon bleu » y mourut le 15 février 1922.
Le dernier empereur, Nicolas II entamait en 1894 l’ultime règne des Romanoff. A Nice, comme d’ailleurs à
Paris, on dansait sur un volcan et on s’étourdissait dans l’éblouissement du faste des grands ducs et de leurs
fêtes somptueuses ! Les signes avant coureurs de la Révolution, le climat d’émeutes et de guerre civile
décidèrent nombre d’aristocrates russes à émigrer vers la France et la Côte d’Azur, avant même l’abdication de
Nicolas II, le 15 mars 1917, suite aux émeutes de février.
Nombre d’entre eux ont raconté avec émotion leur enfance à Nice, dans un quartier où l’intégration leur fut
douce : on parlait russe dans la rue !
L’évocation de l’abnégation et de l’extraordinaire générosité des familles russes établies à Nice, qui
dépensèrent des fortunes pour accueillir les émigrés, rappelle que si les Russes firent beaucoup pour Nice, et
participèrent sans réserve aux œuvres de la ville avant la Révolution, les Niçois solidaires et reconnaissants s’en
étaient souvenus pour accueillir les exilés.
Au cours de leur longue présence, les Russes ne formèrent jamais la colonie d’hivernants la plus importante
du séjour à Nice au XIX° siècle, mais ils constituèrent la société étrangère la plus généreuse, la plus
extravagante, la plus fastueuse et la plus éblouissante.
Dans la folle insouciance des années d’avant la Révolution d’Octobre, dans le faste de la maison impériale et
le train somptueux des suites princières, tout autant que dans les affres de l’exil, ils furent associés à toutes les
grandes heures de la ville de Nice, contribuant à son essor et à sa renommée.
LE SOUVENIR
Katia repose au cimetière russe de Caucade, en haut d’une allée pentue dominant les sépultures de toute la
noblesse de son pays, comme une revanche sur le destin qui n’avait pas voulu qu’elle régnât sur eux quand ils
étaient vivants. La chapelle qui abrite son tombeau a longtemps porté l’inscription « Catherine Dolgorouki,
princesse Yourievsky, épouse morganatique de S.M. le tsar Alexandre II ».
La mention « morganatique » a été aujourd’hui supprimée.
Une chapelle néo-classique, érigée dans la partie haute de la nécropole, abrite les précieuses icônes de la
chapelle du Château de Valrose. Elle domine la forêt de clochetons, de pinacles et de bulbes vernissés des
sépultures affectant les formes des églises provinciales des territoires de la Volga.
Dans le silence de l’éternité, face à la mer, le temps passe, effaçant la douleur et les ressentiments.
Face au grand large, les sépultures sereines, bercées par le balancement des feuillages et la brise de mer,
perpétuent le souvenir des grandes heures de la colonie russe à Nice et la mémoire de l’impossible rêve de
Pierre le Grand : relier Saint-Petersbourg à la Méditerranée par l’ouverture de la voie d’eau Volga Baltique.
Rêve que réalisa pourtant l’impératrice Alexandra !
Ainsi se sont écrites les pages d’une histoire qui a lié indéfectiblement Nice à la Russie.
Sources :
Le Sourgentin N° 123 - Octobre 1996.
Présence et implantation des Russes à Villefranche et à Nice – Igor Delanoë
1
/
1
100%