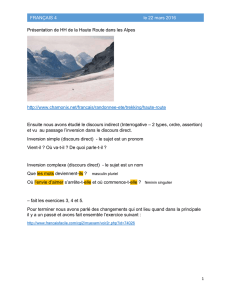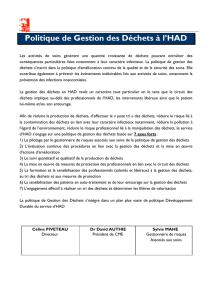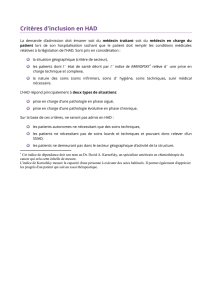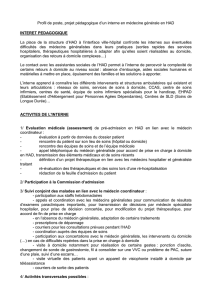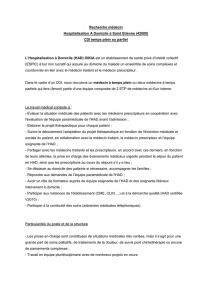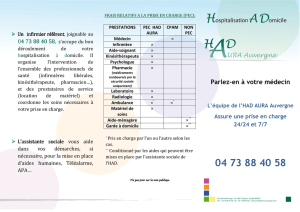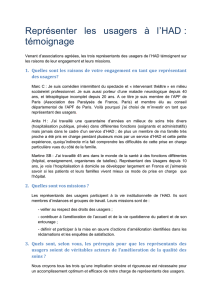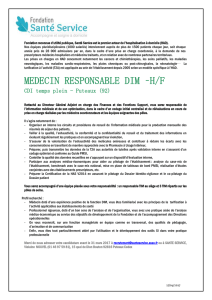FOR two months I had been on the d`Entrecasteaux Islands

FOR two months I had been on the d’Entrecasteaux Islands gathering data for the concluding chapters of my book
upon the flora of the volcanic islands of the South Pacific. The day before I had reached Port Moresby and had seen
my specimens safely stored on board the Southern Queen. As I sat on the upper deck I thought, with homesick mind,
of the long leagues between me and Melbourne, and the longer ones between Melbourne and New York.
It was one of Papua’s yellow mornings when she shows herself in her sombrest, most baleful mood. The sky was
smouldering ochre. Over the island brooded a spirit sullen, alien, implacable, filled with the threat of latent, malefic
forces waiting to be unleashed. It seemed an emanation out of the untamed, sinister heart of Papua herself – sinister
even when she smiles. And now and then, on the wind, came a breath from virgin jungles, laden with unfamiliar
odours, mysterious and menacing.
It is on such mornings that Papua whispers to you of her immemorial ancientness and of her power. And, as every
white man must, I fought against her spell. While I struggled I saw a tall figure striding down the pier; a Kapa-Kapa
boy followed swinging a new valise. There was something familiar about the tall man. As he reached the gangplank he
looked up straight into my eyes, stared for a moment, then waved his hand.
And now I knew him. It was Dr. David Throckmartin –“Throck” he was to me always, one of my oldest friends and,
as well, a mind of the first water whose power and achievements were for me a constant inspiration as they were, I
know, for scores other.
Coincidentally with my recognition came a shock of surprise, definitely – unpleasant. It was Throckmartin – but
about him was something disturbingly unlike the man I had known long so well and to whom and to whose little party
I had bidden farewell less than a month before I myself had sailed for these seas. He had married only a few weeks
before, Edith, the daughter of Professor William Frazier, younger by at least a decade than he but at one with him in
his ideals and as much in love, if it were possible, as Throckmartin. By virtue of her father’s training a wonderful
assistant, by virtue of her own sweet, sound heart a – I use the word in its olden sense – lover. With his equally
youthful associate Dr. Charles Stanton and a Swedish woman, Thora Halversen, who had been Edith Throckmartin’s
nurse from babyhood, they had set forth for the Nan-Matal, that extraordinary group of island ruins clustered along the
eastern shore of Ponape in the Carolines.
I knew that he had planned to spend at least a year among these ruins, not only of Ponape but of Lele – twin centres
of a colossal riddle of humanity, a weird flower of civilization that blossomed ages before the seeds of Egypt were
sown; of whose arts we know little enough and of whose science nothing. He had carried with him unusually complete
equipment for the work he had expected to do and which, he hoped, would be his monument.
What then had brought Throckmartin to Port Moresby, and what was that change I had sensed in him? Hurrying
down to the lower deck I found him with the purser. As I spoke he turned, thrust out to me an eager hand – and then I
saw what was that difference that had so moved me. He knew, of course by my silence and involuntary shrinking the
shock my closer look had given me. His eyes filled; he turned brusquely from the purser, hesitated – then hurried off to
his stateroom.
“‘E looks rather queer – eh?” said the purser. “Know ‘im well, sir? Seems to ‘ave given you quite a start.”
I made some reply and went slowly up to my chair. There I sat, composed my mind and tried to define what it was
that had shaken me so. Now it came to me.
The old Throckmartin was on the eve of his venture just turned forty, lithe, erect, muscular; his controlling
expression one of enthusiasm, of intellectual keenness, of – what shall I say – expectant search. His always questioning
brain had stamped its vigor upon his face.
But the Throckmartin I had seen below was one who had borne some scaring shock of mingled rapture and horror;
some soul cataclysm that in its climax had remoulded, deep from within, his face, setting on it seal of wedded ecstasy
and despair; as though indeed these two had come to him hand in hand, taken possession of him and departing left
behind, ineradicably, their linked shadows!
Yes – it was that which appalled. For how could rapture and horror, Heaven and Hell mix, clasp hands – kiss? Yet
these were what in closest embrace lay on Throckmartin’s face! Deep in thought, subconsciously with relief, I watched
the shore line sink behind; welcomed the touch of the wind of the free seas. I had hoped, and within the hope was an
inexplicable shrinking that I would meet Throckmartin at lunch.
He did not come down, and I was sensible of deliverance within my disappointment. All that afternoon I lounged
about uneasily but still he kept to his cabin – and within me was no strength to summon him. Nor did he appear at
dinner.
Dusk and night fell swiftly. I was warm and went back to my deck-chair. The Southern Queen was rolling to a
disquieting swell and I had the place to myself.
Over the heavens was a canopy of cloud, glowing faintly and testifying to the moon riding behind it. There was
much phosphorescence. Fitfully before the ship and at her sides arose those strange little swirls of mist that swirl up
from the Southern Ocean like breath of sea monsters, whirl for an instant and disappear.
Suddenly the deck door opened and through it came Throckmartin. He paused uncertainly, looked up at the sky with
a curiously eager, intent gaze, hesiated, then closed the door behind him.
“Throck,” I called. “Come! It’s Goodwin.”
He made his way to me.

“Throck,” I said, wasting no time in preliminaries. “What’s wrong? Can I help you?”
I felt his body grow tense.
“I’m going to Melbourne, Goodwin,” he answered. “I need a few things – need them urgently. And more men –
white men –”
He stopped abruptly; rose from his chair, gazed intently toward the north. I followed his gaze. Far, far away the
moon had broken through the clouds. Almost on the horizon, you could see the faint luminescence of it upon the
smooth sea.
The distant patch of light quivered and shook. The clouds thickened again and it was gone. The ship raced on
southward, swiftly.
Abraham MERRITT, The Moon Pool, 1919

Question large : L’inversion
(Question traitée par Lucie Gournay)
Quand on parle d’inversion, il faut se situer par rapport à une norme. Ainsi lorsque l’on présente
l’anglais comme une langue SVO, on part du principe que l’agencement qui apparaît comme
majoritaire et « normal » – c’est celui de la phrase assertive, qui effectivement illustre dans une
grande majorité de cas le schéma sujet-verbe-objet. La phrase interrogative, qui ne suit pas le
même schéma, paraît donc moins centrale, et d’une certaine manière dérivée de la phrase
assertive ; l’inversion qui s’y trouve peut être interprétée comme traduisant l’aspect « second » de
l’interrogation.
Cependant tout est question d’échelle. Si l’on présente cette fois, non plus l’anglais dans son
ensemble, mais les phrases interrogatives directes de l’anglais, l’inversion - par sa désignation
même toujours repérée par rapport à la norme SVO - redevient l’ordre canonique dans un
microsystème relativement homogène. La structure AUX-S-V tout en restant inversée par rapport à
un système élargi, prend le statut d’une norme attendue, celle qui ne se démarque plus.
Il nous faut donc déjà distinguer l’inversion attendue de celle qui produit un effet. Dans le texte
fourni, il y a des occurrences de ces deux types d’inversion. Dans les phrases interrogatives, on l’a
déjà dit, l’inversion structurale AUX-S-V, illustrant une semi-inversion, correspond à l’ordre
canonique. Par opposition, dans les phrases assertives, comme ligne 6 « Over the island brooded a
spirit sullen, alien, implacable […] », l’ordre CCirc-V-S, étiqueté « inversion complète », signale
une variation remarquable, dont la ou les fonctions restent à déterminer.
Car il s’agit bien ici de dégager ce que les inversions du sujet signalent en anglais par rapport à
quelle norme, et dans quel contexte phrastique. On sait aussi que le contexte discursif est
important, mais notre étude se limitera au support du texte narratif de Merritt, extrait de The Moon
Pool.
Nous commencerons par présenter les critères déterminants pour parler d’ « inversions », puis
nous étudierons le cas des phrases interrogatives et des phrases en incise, pour lesquelles
l’inversion du sujet, selon des règles différentes, fait figure de norme. Ensuite, nous étudierons les
types d’inversions dans la phrase assertive, hors dialogue, qui sont parfois décrites comme
stylistiquement marquées.
Il existe des nombreux phénomènes linguistiques pour lesquels le terme « inversion » pourrait
sembler adéquat. Par exemple, si l’on compare the stolen jewels à the jewels stolen, on pourrait
parler de l’inversion adjectif–nom. Or, dès que l’on prend en compte la tradition grammaticale, on
s’aperçoit que l’appellation « inversion » ne réfère pas à n’importe quelle variation dans l’ordre
linéaire. Dans le cas cité, il est d’usage de parler d’antéposition ou de postposition de l’adjectif, le
nom étant ainsi intuitivement perçu comme conservant sa place. On aurait le même genre de
raisonnement pour la variation représentée ligne 32 et ligne 37 "[. . .] what was that difference that
had so moved me.” et “[. . .]what it was that had shaken me so.”, quant à la place de l’adverbe
intensif so par rapport au verbe de sentiment, au participe passé.
De même, un énoncé comme en ligne 14, “Throck” he was to me always », illustre un cas de
turbulence linéaire complexe, qui n’est pas assimilé à une « inversion », d’une part, parce qu’il n’y
a pas de changement symétrique (le GN attribut se trouve en position initiale mais le GN Sujet
reste en position pré-verbale), d’autre part parce qu’on a là, avec la position finale détachée de
l’adverbe always, un ordre qui dépasse l’agencement phrastique prévisible : la turbulence linéaire
reflète non pas un choix de portée comme dans les deux cas précédents, mais la volonté de
représenter le propos dans son aspect oral, discontinu et éventuellement reformulant.
En résumé, parmi les variations qui peuvent être observées au niveau linéaire, l’inversion est
traditionnellement associée à un déplacement symétrique, au sein d’une phrase structurée en

fonction de règles prévisibles. Ce déplacement ne concerne en anglais que l’élément qui a la
fonction de sujet.
On distingue, à partir de critères structurels, deux grandes catégories d’inversion du sujet. Tout
d’abord, on a l’inversion sujet/auxiliaire (ou semi-inversion), que l’on trouve dans les phrases
interrogatives directes (cf. 1), dans certaines subordonnées hypothétiques (cf. 2) ainsi que dans des
phrases assertives comme en (3) :
(1) Can I help you? (ligne 61)
(2) Had my sister been rich, she wouldn’t have become a teacher.
(3) Nor did he appear at dinner. (ligne 50)
Ainsi, la semi-inversion apparaît dans des phrases indépendantes ou des propositions
subordonnées, en quoi elle s’oppose à l’inversion complète (ou FI pour « Full Inversion »), qui est
limitée en anglais contemporain à différents types de phrases assertives indépendantes : les phrases
en incise de dialogue (cf. 4), celles qui expriment une prédication d’existence (5) et enfin celles qui
réfèrent à un évènement ponctuel du type « apparition » (6) :
(4) “E looks rather queer – eh?” said the purser. (ligne 50)
(5) [. . .] but about him was something disturbingly unlike the man I had known long so well
[. . .] (ligne 18)
(6) Coincidentally with my recognition came a shock of surprise [. . .] (ligne 17)
Il y a plusieurs propriétés formelles qui distinguent les deux types d’inversions, à commencer par
celle de l’auxiliaire. En effet, alors que dans les semi-inversions, un premier auxiliaire est
obligatoire et directement suivi du GN sujet, dans le cas de l’inversion complète, c’est l’intégralité
du groupe verbal qui se situe avant le GN sujet. On peut illustrer ce deuxième cas en manipulant
les exemples (4) et (6) :
(4’) “E looks rather queer – eh?” would have said the purser.
(6’) Coincidentally with my recognition had come a shock of surprise [. . .].
De plus, dans les semi-inversions le sujet précède le verbe lexical (en 3, le pronom he est bien
placé juste avant appear), tandis que dans les cas d’inversion complète l’élément analysé
intuitivement comme sujet suit le verbe (en 4, the purser est placé après said.)
Une autre propriété intéressante, c’est la contrainte qui joue sur la réalisation du GN dans le cas
de l’inversion complète. Comme on le voit dans les exemples (1) et (2), dans la semi-inversion, le
GNsujet peut être réalisé sous une forme lexicale ou pronominale. Avec l’inversion complète, seule
la forme lexicale est possible en anglais contemporain.
(4’’) ? “E looks rather queer – eh?” said he.
(6’)* Coincidentally with my recognition came it.
On note, bien évidemment, que dans le cas de l’incise le segment « said he » n’est pas
impossible, mais signale clairement par sa forme un usage archaïsant. Par contre, dans les autres
cas d’inversion complète, la réalisation du sujet post-verbal sous une forme pronominale n’est pas
attestée (cf. 4’’ et 6’). Cette propriété du GN sujet a été interprétée comme découlant de la
fonction présentative de l’inversion complète (cf. entre autres Bresnan 1993).
Avant d’aborder l’analyse fonctionnelle de ces formes, nous remarquerons une autre propriété
discriminante, celle de la classe de verbe. En effet, que la motivation en soit énonciative ou
structurale, il est clair que les verbes dans la semi-inversion ne subissent aucune restriction, alors

que les verbes dans l’inversion complète sont obligatoirement des intransitifs dans les cas (5) et
(6), et obligatoirement des verbes de dire ou de pensées dans les incises. Ainsi les phrases
construites suivantes sont inattestées :
(7) * Then ate a sandwich the purser / *Then ate the purser a sandwich
Et dès qu’un verbe qui n’est pas typiquement de dire est employé dans le contexte d’une incise, il
prend un sens non ambigu lié à l’expression de parole :
(8) « Sir », came a voice from behind.
De plus, toutes les constructions intransitives ne sont pas attestées dans l’inversion complète
puisque l’on ne pourrait pas non plus avoir *Then broke the vase. Il existe une contrainte forte qui
exclut tout verbe télique de l’inversion complète.
On vient de voir que les deux types structurels d’inversion répondaient à des critères formels
précis qui permettaient de les distinguer. Par opposition avec la semi-inversion, l’inversion
complète est régie par d’importantes contraintes structurelles, de sorte qu’on pourrait traiter ces
schémas structuraux l’un après l’autre. Cependant, au sein de ces grands types formels d’inversion,
on distingue des propriétés fonctionnelles, discursives, qui dépendent non pas de la forme inversée
seule, mais de l’interaction qu’il y a entre cette forme et son contexte d’apparition, c'est-à-dire le
microsystème dans lequel elle entre. Ainsi, Dorgeloh 1997, limite son étude fonctionnelle sur
l’inversion en anglais aux structures FI et SAI (pour Subject Auxilary Inversion) que l’on rencontre
dans des propositions indépendantes assertives (cf. 3, 5, 6). Selon l’auteur, cette limitation est
cohérente car l’on a affaire dans ces cas à des variations de l’ordre linéaire qui fonctionnent comme
des marqueurs discursifs, qui mettent en évidence ou « démarquent » le propos exprimé par un
effet stylistique.
Nous commencerons par faire quelques remarques sur l’inversion non stylistique.
Tout d abord, considérons le microsystème des phrases interrogatives. On peut considérer que la
semi-inversion dans l’interrogation sert de marqueur grammatical pour distinguer une relation qui
se focalise sur un élément indéfini, que celui-ci soit exprimé par un élément en WH- ou par un
auxiliaire (dans ce cas, c’est la polarité qui reste indéfinie).
Contrairement à ce qui se passe en français (cf. t’aime qui ? tu viens ?... ) l’ordre inversé reste le
moyen dominant de signaler l’interrogation en anglais. Ainsi, dans l’exemple (9),
(9) [. . .] his controlling expression one of enthusiasm, of intellectual keenness, of – what shall I
say – expectant search. (ligne 39)
le segment en incise qui exprime un commentaire métalinguistique, « what shall I say », n’est pas
suivi d’un point d’interrogation (signe d’intonation). L’inversion AUX-Sjt-Vb associée à un
élément en WH- en position initiale construit sans ambiguïté la valeur interrogative du segment.
Cependant, on trouve des occurrences de questions qui ne suivent pas le schéma inversé attendu.
On s’interrogera alors sur cette variation possible et ces effets au niveau discursif.
Dans les interrogations en WH-, seule la question qui porte sur le sujet suit l’ordre de la phrase
assertive.
(10) Who broke the vase ?
(11) *Who did break the base ?
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
1
/
21
100%