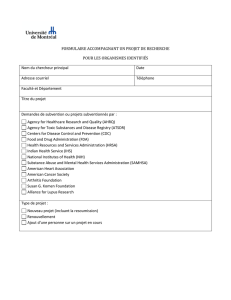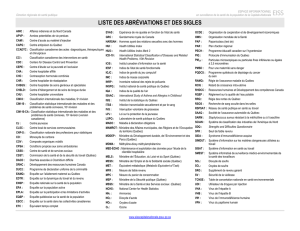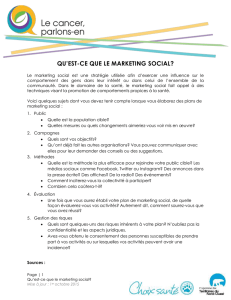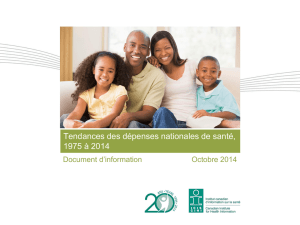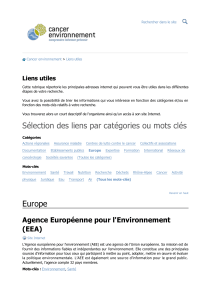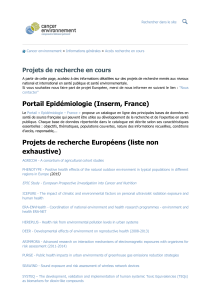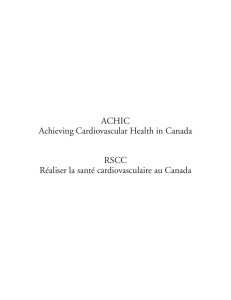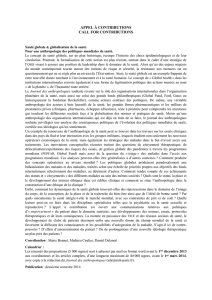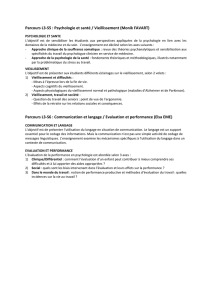Institut de la statistique du Québec (ISQ). 2010a. Portrait

Analyse du
contexte
Synthèse globale
1
Table des matières
Introduction
A. État de santé et tendances socioéconomiques
B. Gestion des ressources et gouvernance
C. Organisation et adaptation des services
D. Technologies, innovations et approches
Conclusion
Introduction
Le contexte dans lequel évolue le système de santé est en constante transformation. Des besoins sont en
émergence et les récentes technologies, pratiques et connaissances offrent de nouvelles opportunités dans
le domaine de la santé. Plusieurs éléments de l’environnement exercent une pression sur le système de
santé. Notons par exemple les tendances sociodémographiques, dont le vieillissement de la population,
l’augmentation des incapacités et l’accroissement des inégalités. D’autres facteurs influent sur la capacité
du système à répondre aux besoins et à prodiguer des soins de qualité : la disponibilité de la main-
d’œuvre, l’implantation des technologies de l’information et l’accessibilité accrue aux connaissances.
Enfin, des défis environnementaux et sociaux comme les pandémies, les changements climatiques et
l’impact de la mondialisation sur l’État et la santé s’inscrivent au contexte global dans lequel évolue le
système de santé. Les enjeux auxquels le Québec doit faire face demandent de mettre en place des
solutions qui leur sont adaptées.
L’objectif de ce document est de dresser un portrait des éléments relatifs au contexte (environnement)
dans lequel évolue le système de santé et des services sociaux, qui ont une influence prépondérante sur ce
dernier. L’approche adoptée permet de dégager les éléments de pression qui apparaissent dominants et qui
font consensus. Cet exercice s’inscrit dans la démarche de planification stratégique du ministère de la
Santé et des Services sociaux. Les choix stratégiques qui en découlent, c’est-à-dire les enjeux, les
orientations, les objectifs et les indicateurs de résultats, s’appuient entre autres sur une lecture du contexte
dans lequel l’organisation évolue. La perspective stratégique amène l’identification de priorités pour une
définition des actions les plus structurantes permettant d’améliorer les services de santé et les services
sociaux dispensés à la population.
Voici les principales questions auxquelles ce document tente de répondre.
• Quels sont les principaux éléments de pression qui influencent le système de santé et des services
sociaux?
• Quels sont les défis et les occasions favorables pour le système de santé et des services sociaux?
• Quelles sont les tendances actuelles et anticipées dans le secteur de la santé et des services sociaux
(facteurs d’importance)?
Les thèmes abordés sont regroupés en quatre catégories, à savoir : 1) l’état de santé et les tendances
socioéconomiques; 2) la gestion des ressources et la gouvernance; 3) l’organisation et l’adaptation des
services et 4) les technologies, les innovations et les approches.

Analyse du
contexte
Synthèse globale
2
A. État de santé et tendances socioéconomiques
1. Situation socioéconomique du Québec
La population du Québec a atteint le cap de 8 millions d’habitants en 2012 et devrait continuer de croître
d’ici 2020 et au-delà. Elle connaîtra un vieillissement important dans les prochaines années avec l’arrivée
des baby-boomers dans le troisième âge. En 2031, le quart de la population aura 65 ans et plus, et le
nombre de « grands aînés » (85 ans et plus) doublera en moins de 20 ans. Ce vieillissement amplifiera la
demande en soins de santé
1
.
Le Québec vit une situation économique favorable, bien que fluctuante : un PIB en croissance, un taux de
chômage amélioré, mais une dette élevée. Sa population active a atteint un sommet avec 60 % des
personnes en emploi en 2012, mais ce taux connaitra une diminution, étant donné l’importante proportion
des 50 ans et plus sur le marché du travail. Les finances publiques affichent un déficit, mais la faible
croissance des dépenses du gouvernement devrait mener à un retour à l’équilibre budgétaire pour 2013-14.
Le Québec aborde une période de pénurie de main-d'œuvre, avec l’arrivée à la retraite des baby-boomers,
ce qui fragilise l’activité économique et l’accès à des services publics de proximité, dont les soins de santé
et les services sociauxMINISTÈRE DES FINANCES ET DE L’ÉCONOMIE
Globalement, les Québécois jouissent d’un meilleur revenu depuis 2000 et ont amélioré leur niveau de
scolarisation. La proportion de personnes à faible revenu est inférieure à celle observée à l’échelle
canadienne (9,5 % versus 10,6 %, selon la mesure du panier de consommation). Depuis 2005, la
proportion de prestataires de l’assistance sociale est passée sous le seuil record de 8 %. Le Québec est
l’une des rares juridictions à avoir réussi à diminuer la pauvreté au cours des dernières années, notamment
grâce à ses programmes sociaux (aide au logement, services de garde…) et particulièrement chez les
jeunes de moins de 18 ans. Une telle progression du revenu et de la scolarisation comporte un potentiel
d’amélioration de la santé de la population. Toutefois, ces gains n’ont pas empêché les écarts de revenus
de croître en raison d’une augmentation marquée de revenu chez les mieux nantis. De plus, les progrès ne
sont pas uniformes et des groupes demeurent dans des conditions de vie précaires, comme les personnes
seules et les travailleurs à faible revenu.
1. État de santé et de bien-être de la population
L’état de santé de la population du Québec s’est amélioré depuis les années 2000 en ce qui a trait à
l’espérance de vie, la survie aux maladies cardiaques et au cancer. La population se dit généralement en
bonne santé, tant physique que mentale. La prévalence du cancer et des maladies cardiaques est cependant
en augmentation. Les maladies infectieuses et les infections nosocomiales ont reculé, mais la vigilance est
de mise comme le prouvent les épidémies de rougeole en 2011 et de grippe A(H1N1) en 2009. Les
changements climatiques sont également préoccupants pour la santé de la population.
La prévalence des troubles mentaux chez les adultes a peu fluctué depuis 2000, une personne sur dix en
étant atteinte chaque année. Néanmoins, chez les moins de 20 ans, elle est passée du simple au double, en
raison du diagnostic plus fréquent du trouble de déficit de l’attention et d’hyperactivité. Depuis dix ans, le
Québec montre une diminution du taux de suicide, particulièrement chez les jeunes.
Des pressions importantes sont exercées sur le système de santé et des services sociaux par les maladies
chroniques et les incapacités. La moitié de la population âgée de 12 ans et plus aurait au moins un
problème de santé chronique en 2010-2011 et le quart en aurait au moins deux. Les dix problèmes de santé
1
Les références sont présentées dans le texte en mode « masqué ». Pour y avoir accès, cliquez sur l’icône « ¶ ».

Analyse du
contexte
Synthèse globale
3
les plus fréquents sont, par ordre de prévalence, les maux de dos, l’hypertension, l’arthrite, les migraines,
l’asthme, le diabète, les maladies cardiaques, les troubles d’anxiété, les troubles de l’humeur et les
troubles intestinaux. L’hypertension touche maintenant 16 % des Québécois et le diabète en affecte 6 %.
Au Canada, le nombre de nouveaux cas de cancer a doublé depuis 1983, reflétant à la fois la croissance et
le vieillissement de la population. Plus de la moitié des nouveaux cas de cancer sont des cancers de la
prostate, du poumon, du sein ou colorectal. De même, l’Alzheimer ou la démence progresse et le nombre
de personnes atteintes au Québec devrait doubler en 25 ans, touchant 270 000 personnes.
Le taux d’incapacité chez les enfants augmente au Québec depuis 2001, se manifestant surtout par des
troubles déficitaires de l’attention, de l’asthme, des troubles d’apprentissage ou un retard de
développement. Les incapacités sont plus fréquentes à mesure que l’âge avance. Alors que 28 % la
population de 15 à 64 ans est atteinte d’incapacités légères, modérées ou graves, d’après l’EQLAV 2010-
2011, ce taux monte à 48 % chez les Québécois de 65 à 74 ans, à 64 % chez les 75-84 ans et à 84 % chez
les personnes de 85 ans et plus. Les incapacités modérées ou graves touchent 11 % de la population de tous
les âges.
Les campagnes et les interventions cliniques de prévention semblent apporter des bénéfices, notamment
sur la consommation de fruits et légumes et la diminution du taux de tabagisme, bien que ce dernier stagne
depuis 2006 autour de 20 % après un progrès remarquable. On observe un accroissement de l’obésité qui
touche maintenant un adulte sur six. Bien que le Québec présente une prévalence de l’obésité légèrement
sous la moyenne canadienne, elle est supérieure à celle de plusieurs des pays de l’OCDE.
2. Caractéristiques des sous-groupes de population et des communautés
La prévalence des problèmes de santé physique chez les femmes est plus élevée que chez les hommes;
elles sont plus nombreuses à déclarer une incapacité, surtout après 65 ans et connaissent un plus grand
nombre d'années d'incapacité dues à la longévité. Les femmes victimes de violence conjugale,
particulièrement les jeunes, sont en augmentation depuis une dizaine d’années.
Une hausse de la prématurité est associée à l’augmentation des naissances multiples et des naissances chez
les mères plus âgées. Par contre, le faible poids à la naissance est en diminution. En ce qui a trait aux
jeunes, près de un sur cinq présente un surplus de poids. Seulement le tiers des enfants et des adolescents
atteignent la quantité de fruits et légumes et le niveau d’activité physique recommandés et un jeune sur dix
(11 %) déclare fumer la cigarette.
La négligence parentale envers les enfants demeure le premier motif des 8 000 prises en charge effectuées
chaque année dans le cadre de la Loi sur la Protection de la jeunesse. Les difficultés de comportement sont
rapportées chez un enfant sur quatre. Le taux de décrochage scolaire au secondaire a diminué au cours de
la dernière décennie, mais il demeure encore trop élevé, surtout chez les garçons.
En 2007-2008, environ un aîné sur cinq a besoin d’aide pour ses activités quotidiennes et les proches sont
une source importante de l’aide reçue. Parmi les personnes qui ont besoin d’aide, 42 % ne reçoivent pas
toute l’aide nécessaire. En 2010, la proportion de personnes âgées de 65 ans ou plus admises en ressources
d’hébergement (CHSLD et ressources intermédiaires) est de 3,6 %. Elle grimpe à 12,6 % chez les 85 ans
ou plus. En tenant compte uniquement du vieillissement de la population, le nombre d’aînés ayant des
besoins en soins de longue durée devrait plus que doubler entre 2006 et 2031.
Depuis 10 ans, l’immigration tend à augmenter au Québec. Les immigrants vivent des difficultés dans la
prise en charge de leur santé : problèmes de communication avec les professionnels de la santé,

Analyse du
contexte
Synthèse globale
4
conception de la santé et de la maladie différente de celle qui prévaut dans la société d’accueil,
méconnaissance des services disponibles, priorité mise à la recherche d’emploi, etc.
Les besoins en soins de santé des Premières Nations sont en croissance. La population augmente, jouit
d’une espérance de vie plus faible et a des problèmes de santé nettement plus répandus que dans la
population québécoise en général : mortalité infantile, alcoolisation fœtale, VIH/SIDA, hépatite C,
diabète, obésité... Les problématiques sociales sont en recrudescence (pauvreté matérielle et sociale,
négligence et mauvais traitements subis à l’enfance, surpeuplement des logements, chômage, faible
scolarisation, taux élevé de suicide, de dépression, etc.). La complexité de la gouvernance à plusieurs
paliers gouvernementaux des services nuirait à l’efficacité des programmes (délais, listes d’attente,
absence de dépistage, zones grises, etc.).
Globalement, malgré des gains réalisés au cours des dernières années les inégalités sociales et de santé
persistent. Les problèmes sociaux et de santé sont plus fréquents chez les personnes défavorisées. Ainsi,
l'écart en espérance de vie en santé peut atteindre 14 ans entre les groupes les plus favorisés et les moins
favorisés. Les taux de prises en charge par la Protection de la jeunesse ont tendance à augmenter avec le
degré de pauvreté du milieu. Réduire les inégalités de santé requiert de lutter contre la pauvreté et agir sur
les conditions de vie qui sont des déterminants de la santé (revenu, scolarité, logement, sécurité
alimentaire, transport, capital social).
B. Dépenses de santé, gestion des ressources et gouvernance
1. Les dépenses de santé
Un des principaux problèmes auxquels sont confrontés de nombreux systèmes de santé est celui d’assurer
un financement adéquat tout en contrôlant les coûts. Le Québec ne fait pas exception. La hausse soutenue
et continuelle des dépenses de santé depuis 1975 menace la viabilité des dépenses publiques en santé, car
elle dépasse le taux de croissance économique et des revenus de l’État. Cette réalité fait en sorte que les
dépenses de santé accaparent une part importante des dépenses gouvernementales, ce qui exerce une
pression sur les autres missions de l’État. Dans un contexte de lutte aux déficits, de restrictions
budgétaires et d’incertitude économique, le contrôle des coûts de santé prend une grande importance.
Enfin, la diminution des transferts fédéraux de santé après l’année 2016-2017 est un autre facteur à
prendre en considération.
Selon le dernier budget du gouvernement du Québec, les dépenses de santé vont continuer de croître à un
rythme de 4,8 % par année, pour atteindre un total de 31,3 milliards de dollars. En 2012-2013, elles
représentent 47,8 % des dépenses par mission du gouvernement québécois (répartition excluant le
paiement de la dette), ce qui en fait le plus important poste budgétaire. Au Québec, le financement de la
santé est principalement public, à l’instar de la majorité des pays de l’OCDE. Il concerne près de 70 % des
dépenses totales en santé. Les dépenses totales de santé composent 12,7 % du PIB en 2012, ce qui dépasse
la moyenne canadienne, qui est de 11,6 %.
Déterminants de l’accroissement des dépenses en santé
Selon l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), les principaux facteurs d’accroissement des
dépenses de santé au cours de la dernière décennie ont été la hausse des coûts de production (ex. :
rémunération des dispensateurs de soins de santé), l’utilisation accrue de services (ex. : médicaments et
services médicaux) ainsi que l’évolution de l’offre de services (ex. : émergence de nouveaux médicaments
et de nouveaux outils diagnostiques et chirurgicaux) et de la demande de services (ex. : évolution des

Analyse du
contexte
Synthèse globale
5
maladies, augmentations du nombre de maladies chroniques et changement de comportements et de
préférences des malades).
De 2002 à 2012, les dépenses totales de santé ont augmenté au Québec, comme dans le reste du Canada.
Les dépenses publiques ont augmenté de près de 12,6 milliards (71 %) et ce sont les catégories de
dépenses « immobilisations », « médecins » et « médicaments » qui ont connu le taux de variation des
dépenses le plus prononcé lors de cette période.
Selon les données de l’ICIS, les dépenses en médicaments au Canada ont connu en 2012 leur plus faible
taux de croissance annuel en 16 ans. Ce ralentissement s’explique notamment par l’expiration du brevet de
médicaments très utilisés et par des mesures de contrôle des dépenses, dont des politiques d’établissement
des prix pour les médicaments génériques.
Les médicaments occupent la deuxième place en importance des dépenses en santé au Québec, après les
frais d'hospitalisation, et ce, depuis 1997. Le total des dépenses en médicaments représente 16,0 % du total
des dépenses de santé au Canada et 19,4 % au Québec (2012). Le Québec consacre davantage aux
médicaments que le reste du Canada et cet écart à la moyenne s’accentue. Cet écart s’explique notamment
par le régime général d’assurance médicament québécois qui contraint les résidents de la province à être
couverts par une assurance médicament, qu’elle soit de nature privée ou publique.
2. Ressources humaines
Les effectifs du réseau de la santé et des services sociaux augmentent. Au 31 mars 2012, les 297 400
travailleurs du secteur de la santé composent 6,9 % de la population active au Québec. En 2012, le Québec
affiche un des taux les plus élevés de médecins par 100 000 habitants au Canada, soit 231 médecins par
100 000 habitants, pour une moyenne canadienne de 209 médecins. Ce ratio était de 217 en 2007. La
moyenne des pays de l’OCDE donne un ratio de 314 médecins pour 100 000 habitants en 2010. Selon
l’ICIS, le nombre de médecins au Québec, ainsi que dans l’ensemble du Canada, a augmenté plus
rapidement que la population. Ceci s’explique par l’arrivée constante sur le marché du travail de nouveaux
diplômés et par la hausse du nombre de médecins formés à l’étranger.
Le système de santé doit faire face aux changements de profil sociodémographique de ses employés.
Pensons, par exemple, à la féminisation de la pratique médicale, aux enjeux générationnels, à la
spécialisation accrue et au nombre croissant de départs à la retraite des travailleurs de la santé. La
modification du profil démographique des professionnels de la santé exerce une influence sur le nombre
d’heures travaillées et sur les pratiques médicales, notamment en ce qui a trait aux impératifs de la
conciliation travail et famille.
Malgré une augmentation globale des effectifs, une pénurie de certains types de professionnels est prévue
dans un futur rapproché, notamment en raison d’un vieillissement des effectifs. Certains titres d’emplois
seraient particulièrement touchés dans le secteur public selon des données du Ministère : diplômés
universitaires en travail social, personnel infirmier, pharmaciens d’établissement, psychologues,
audiologistes, ergothérapeutes, orthophonistes, physiothérapeutes, inhalothérapeutes, préposés aux
bénéficiaires et technologistes médicaux.
D’autres défis concernant les ressources humaines sont aussi à prendre en compte. Les ressources
médicales sont réparties de façon inégale sur le territoire québécois. Toutefois, selon l’ICIS, le nombre de
médecins en milieu rural au Québec est plus élevé qu’il y a cinq ans. Il demeure que le recrutement et la
rétention de certaines catégories de professionnels de la santé représentent des défis plus importants pour
certaines régions.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
1
/
23
100%