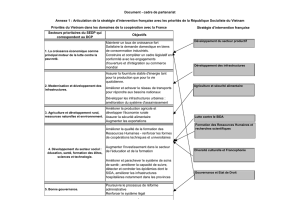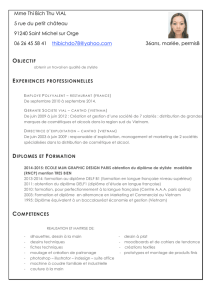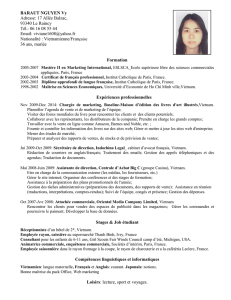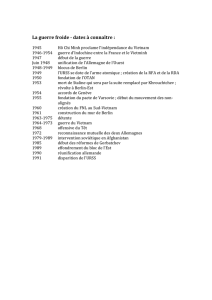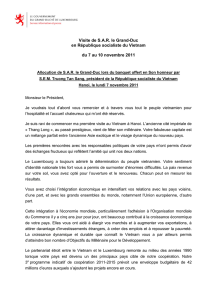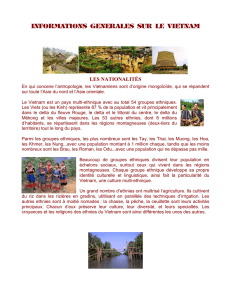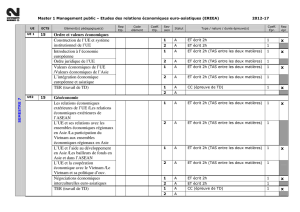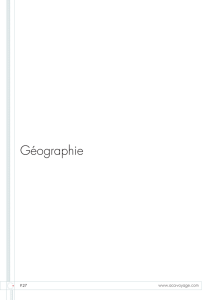Institution et culture - Association Les Lampions

Institution et culture
L’INFLUENCE DU CONFUCIANISME AU VIETNAM
Huguette Ballester, Psychologue clinicienne, Secrétaire de l’ADEPASE
Diep Ngoc Nguyen, Doctorante, Laboratoire PDPS, Université de Toulouse II
- le Mirail
ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT
DE L'EDUCATION ET DE LA PSYCHOLOGIE
EN ASIE DU SUD-EST
Opérateur de la coopération professionnelle et universitaire
Présentation de l’ADEPASE :
L’Association pour le Développement de l’Education et de la Psychologie en Asie du
Sud-est (ADEPASE) a été créée à Toulouse en 1997. Elle est un opérateur de la
coopération professionnelle et universitaire en raison de sa double expérience :
- en enseignement universitaire, recherche et formation professionnelle des cadres
- en conseil et intervention dans les secteurs sanitaire et social, du travail et des
organisations.
Les actions de l’ADEPASE concernent en premier lieu le Vietnam (Hanoi, Son La),
mais font aussi l’objet de sollicitations au Cambodge et au Laos.
Les domaines d’intervention de cette association relèvent de différents domaines, à
savoir :
- La psychologie, l’éducation, le travail social
- La formation, l’orientation et l’insertion
- Le conseil et l’intervention en développement local
Les acteurs de l’ADEPASE sont des universitaires, des praticiens, des étudiants.
La Présidente : Odette Lescarret, Professeur Emérite de Psychologie, membre du
Laboratoire de Psychologie du Développement et Processus de Socialisation (PDPS) à
Toulouse.
L’ADEPASE est une association amie des « Lampions ».
I. Première partie : La transmission des valeurs confucéennes au Vietnam
1. L’influence du Confucianisme comme éthique politique et sociale :
Le Confucianisme a été introduit par les Chinois au IIIème siècle. Plus qu’une croyance
religieuse proprement-dite, le Confucianisme diffuse une éthique politique et sociale selon
laquelle l’homme ne peut se définir que par ses rapports à la communauté, que ce soit la
communauté familiale ou sociale, l’Etat etc. Pour le Confucianisme, l’individu est avant tout
un être social qui a des obligations envers la communauté.
L’influence de la Chine au Vietnam est forte pour des raisons historiques du fait de longues
périodes de domination sur les territoires vietnamiens. Le Confucianisme a continué à être

pratiqué après l’indépendance du Vietnam au Xème siècle et a fait l’objet d’une
reconnaissance par la cour royale. La domination chinoise de plus de dix siècles (les dix
premiers de notre ère environ) a donc transmis des systèmes de valeurs, essentiellement des
valeurs confucéennes qui font partie de la tradition et qui sont respectées par les vietnamiens.
Il s’agit pour nous d’apprécier l’impact psychologique des valeurs confucéennes sur les
personnes dans la société vietnamienne aujourd’hui.
Parmi les valeurs confucéennes, nous pouvons citer : le sens de la famille la piété
familiale), le respect de l’ordre et de la hiérarchie, le respect des règles, le sens des
convenances et de la modestie, la considération pour l’érudition, mais aussi des
qualités personnelles comme le courage, la persévérance et le respect de la parole
donnée.
Les valeurs du Bouddhisme, comme grand système de croyance aussi ancien que le
Confucianisme, joue également un rôle important dans la société vietnamienne actuelle dans
la transmission des valeurs. Le Bouddhisme est né en Inde vers 500 av. J.-C., il a été introduit
au Vietnam du Nord en 189 av. J.-C. quand des bonzes chinois sont venus pour y trouver
asile. Ensuite, au IIIème siècle, des moines bouddhistes de l’Inde sont venus s’installer au
Vietnam.
Parmi les valeurs bouddhiques, nous pouvons citer : la bienveillance, la compassion,
l’amour les uns envers les autres et l’égalité entre les êtres (Vietnam attitude, 2011).
D’un point de vue psychologique, le Bouddhisme apparait comme une tentative de
l’homme de mettre à distance les désirs et/ou les conflits psychiques, et la souffrance
que ceux-ci peuvent générer, en cultivant une certaine forme de détachement.
Mais, le Vietnam n’a pas fait que subir l’influence de la Chine du Nord, il s’est aussi tourné
tout au long de son histoire vers les civilisations du Sud-est asiatique dont il a assimilé les
influences culturelles.
Par ailleurs, l’organisation en communautés villageoises – công dông lang xa- typiques de la
société vietnamienne, a été un facteur de résistance forte au modèle politique centralisateur
chinois et au Confucianisme qui a ont été adoptés officiellement par les dynasties successives
(Ly, Trân, Lê) après l’indépendance du Vietnam au Xème siècle. Au niveau populaire, il y a
eu une forte résistance des sociétés villageoises par rapport à l’imprégnation de la culture
chinoise et au modèle politique centralisé chinois dans lequel le Confucianisme jouait un rôle
important pour maintenir un ordre social stable, dans lequel chacun reste à sa place dans le
respect d’une hiérarchie familiale et sociale (Do Benoit, 2011).
2. L’influence française :
La colonisation française a également eu une influence sur les valeurs, les attitudes et les
comportements des vietnamiens, puisque l’assimilation de la langue et de la culture françaises
a été imposée par le pouvoir colonial. Mais cela s’est fait de manière limitée, dans la mesure
où cette influence a surtout touché l’élite vietnamienne riche et lettrée des villes qui
fréquentait les écoles et lycées français, et les beaux-arts. Cette élite a pu ainsi s’imprégner
des valeurs occidentales, adopter le style français sur le plan vestimentaire,… En revanche, la
colonisation française a eu beaucoup moins d’influence en milieu rural (Vietnam attitude,
2011).

Les historiens du Vietnam notent qu’une des caractéristiques de la culture vietnamienne est de
parvenir à « vietnamiser » tous les apports, tous les éléments culturels qui viennent de
l’extérieur, de les faire concorder avec les siens propres, pour mieux les dépasser et innover
pour en faire autre chose, y compris le Confucianisme (cf. la notion de « bricolage » proposée
par Phan Ngoc). L’identité culturelle vietnamienne est pluraliste, elle se caractérise par une
grande adaptabilité et une capacité d’innovation (Do Benoit, 2011).
Sur le plan psychologique, cela pose la question de savoir ce que chacun, individu ou groupe,
fait d’une transmission culturelle ou psychique, comment il se l’approprie pour mieux la
subvertir et en faire autre chose : une création personnelle, une innovation collective.
3. Le sentiment d’identité nationale et le parti communiste :
Le Vietnam a été bousculé tout au long de son histoire par des guerres tragiques. Il est resté le
symbole d’un petit pays agressé par de grandes puissances étrangères qu’il a réussi à vaincre,
à chaque fois, grâce à un peuple courageux et indépendant. A différentes périodes de son
histoire, le Vietnam s’est libéré des chinois, des français, des américains et des japonais, entre
autres.
Quelques dates et périodes clés : (Mai Ly, 2009)
1884-1945 : Domination française et chute de l’Etat monarchique centralisé du Vietnam.
1945-1954 : Période d’indépendance nationale et de résistance à la reconquête française (Ho
Chi Minh lit la déclaration d’indépendance à Hanoi le 2 septembre 1945).
Cette période se caractérise par une critique radicale du Confucianisme, qui était
associé au féodalisme, et qui était à combattre au même titre que le colonialisme.
1954-1975 : Guerre contre les américains aboutit à la libération totale du Sud-Vietnam et à la
réunification du pays. Le 30 avril 1975, la prise de Saigon met fin à la guerre armée contre les
américains avec, au moins, 4 millions de morts côté vietnamien.
Néanmoins, pendant cette période, on va assister à un retour du Confucianisme par le
biais de la formation des cadres politiques du parti communiste vietnamien en Chine.
Ceux-ci vont adopter le modèle maoïste chinois et vont voir dans le Confucianisme un
outil idéologique pour soutenir le développement économique du pays. A titre
d’exemple, la réforme agraire vietnamienne de 1953 et 1956 va s’inspirer de la
« rectification idéologique » maoïste (Do Benoit, 2011).
1975-1986 : Restauration du pays après deux guerres libératrices, française et américaine.
Mais, en 1976 des conflits frontaliers avec le Cambodge et les Khmers rouges vont se
rajouter aux difficultés existantes et affaiblir la jeune république socialiste. Pendant toute cette
période, jusqu’à la fin des années 80 avec l’effondrement de l’Union Soviétique, le Vietnam
ne pouvait compter que sur les aides de l’URSS et des pays de l’Est puisqu’il subissait un
embargo commercial et financier américain. Le pays était isolé.
Depuis 1986 : Lancement d’une politique dite de Renouveau, période dite du dôi moi. On
assiste à une ouverture pour tenter de résoudre les difficultés économiques internes et
retrouver une place sur le plan international, d’abord en normalisant les liens diplomatiques
du Vietnam avec la Chine et les Etats-Unis, et en tissant des coopérations avec le Japon et
l’Union Européenne. Cette politique volontariste de Renouveau a contribué à instaurer une
dynamique de réconciliation sur le plan international mais aussi, en interne, sur le plan
national.

Durant cette période, le Vietnam est amené à réviser son adhésion au modèle
confucianiste en même temps que les conditions de son développement économique.
Aujourd’hui, le Vietnam est une société certes avec un seul parti au pouvoir (PC vietnamien)
mais qui a adopté ce que les vietnamiens appellent « l’économie de marché suivant
l’orientation socialiste », qui valorise l’initiative et la propriété privée comme moteur du
développement du pays.
Le « savoir-faire vietnamien » consiste à garder une certaine stabilité sociale et
politique, malgré les mutations économiques et les crises financières au niveau
international, tout en conservant partiellement des valeurs traditionnelles, issues du
Confucianisme, mais en ne se privant pas d’adhérer à certaines valeurs démocratiques
occidentales, comme les droits fondamentaux de l’individu, l’égalité entre hommes et
femmes (cf. le Livre blanc sur les droits de l’homme en 2005), (Do Benoit, 2011).
4. La famille et le mariage, les évolutions contemporaines :
Les valeurs traditionnelles confucéennes au sein de la famille sont encore présentes au
Vietnam. Historiquement, jusqu’au XXème siècle, le mariage est une question essentielle, non
seulement pour les jeunes mariés en premier lieu, mais aussi pour la famille élargie dans le
système de parenté. Dans la conception confucianiste, le mariage vise à perpétuer le lignage
par la procréation, surtout celle des garçons. Mais, le mariage a également une fonction
économique dans laquelle l’épouse n’est pas seulement une mère, elle occupe aussi la place
de travailleur principal et gère tous les problèmes de la maison de son époux. C’est pour cette
raison que les familles mettaient un soin particulier au choix de la bru (bonne santé et capacité
de travail de la belle-fille). Ainsi, en vertu des conceptions confucéennes : « La fertilité,
l’obéissance au mari, la piété filiale envers les parents du mari, tout comme la capacité à
apporter une contribution économique à la famille de l’époux dans le futur, sont considérées
comme les qualités individuelles les plus importantes. » (Gubry, 1994, p.86).
Au Vietnam, le mariage était arrangé par les parents ou par les personnes âgées de la famille,
et les individus n’avaient quasiment pas le choix. Le sentiment amoureux était peu ou pas pris
en compte. Grosso modo, cette famille traditionnelle vietnamienne va se perpétuer jusqu’en
1945.
Après la révolution d’août 1945, le mariage va connaitre des évolutions importantes du fait
des changements socio-économiques et des choix politiques qui vont être faits. Le nouveau
pouvoir opte pour des relations conjugales progressistes pour garantir la liberté de choix et
l’égalité entre hommes et femmes dans le mariage (la Constitution de 1946 décrète la
suppression de l’inégalité entre hommes et femmes). Plus tard, des lois sur le mariage sont
promulguées en 1959 et 1986 qui garantissent les droits de la femme dans la famille.
Nous sommes passés du mariage arrangé par la famille au mariage librement consenti, dans
lequel les individus jouent un rôle plus actif dans la prise décision de leur propre vie et du
choix du conjoint. Mais, les études montrent que le distinguo entre mariage arrangé et
mariage librement consenti n’est pas absolu. On parle plutôt de « collaboration entre les
individus et leurs familles », entre les générations, comme élément central dans les décisions
nuptiales (Gubry, 1994, p.97).

5. La situation de la femme, l’émancipation :
La société vietnamienne sort d’une longue période dans laquelle les valeurs confucéennes
étaient omniprésentes et se traduisaient par des discriminations à l’égard des femmes. Des
progrès importants ont été accomplis après l’indépendance de 1945 en faveur de
l’émancipation des femmes. Autrefois, l’accès des femmes à l’éducation officielle était
interdit, la femme n’était pas citoyenne en droit (Gubry, 1994). Dans la société traditionnelle
vietnamienne, la condition féminine était soumise à un code confucéen qui reposait sur quatre
vertus (tu duc) et trois soumissions (tam tong).
« Sage était celle qui répondait d’abord aux quatre exigences : công, dung, ngôn,
hanh. Công : une femme est avant tout une travailleuse habile, patiente et efficace ; en
vrai « soutien intérieur », elle assume toutes les tâches domestiques. Dung : beauté et
féminité, la femme incarne la paix, l’indulgence et la réconciliation. Ngôn : elle
maîtrise l’art de la parole qu’elle utilise autant avec justesse que justice. Hanh : enfin,
ayant un sens moral développé, une femme doit être soucieuse d’offrir aux autres des
actions positives. » (Do Benoit, 2011, p.77).
Toutefois, des études montrent que l’influence du Confucianisme n’a peut-être pas été aussi
forte au Vietnam que dans d’autres pays d’Asie orientale, avec l’existence de systèmes
juridiques différents (les droits des femmes y auraient été mieux protégés), (Gubry, 1994).
La guerre a également joué un rôle important, les femmes ont participé activement au combat
pour la libération du pays et ont remplacé les hommes dans les activités de production et de
vie quotidienne. Cette situation particulière a contribué à construire une identité de la femme
vietnamienne, combative et courageuse, conjuguant les valeurs confucéennes et la tradition de
lutte pour l’indépendance, alliant le sacrifice de sa personne et son engagement pour la justice
et la liberté (Gubry, 1994).
6. Les jeunes et les valeurs de la société vietnamienne :
De nos jours, l’idéal de la jeune génération au Vietnam est de pouvoir s’élever socialement.
Cette posture marque une rupture avec le passé et est à l’origine d’un écart de générations.
Car la réussite sociale se fonde désormais sur les qualités personnelles de l’individu, sur son
mérite personnel, ce qui amène les jeunes à s’affranchir de la famille et de leur communauté
d’appartenance, réduisant ainsi l’influence du Confucianisme sur les comportements. Ces
nouvelles valeurs sociales, liées aux mutations économiques du pays, modifient en profondeur
les relations au sein de la famille et les rapports entre les générations. Les jeunes vietnamiens
sont aujourd’hui davantage attirés par l’extérieur, par les valeurs occidentales, mais ils
conservent, malgré ces évolutions, le sens de la famille et le respect des anciens (Vietnam
attitude, 2011).
La deuxième partie de notre communication vise à présenter et à analyser, à travers une
recherche sur le terrain, l’influence du Confucianisme sur la vie moderne des adolescents
vietnamiens de la génération actuelle.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%