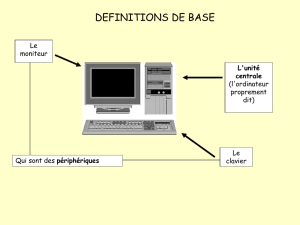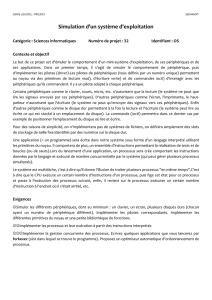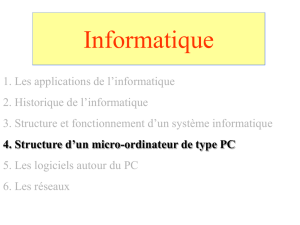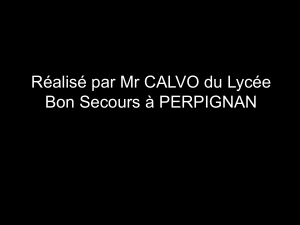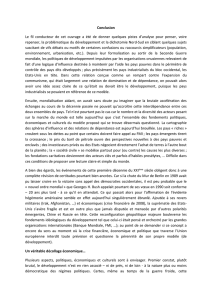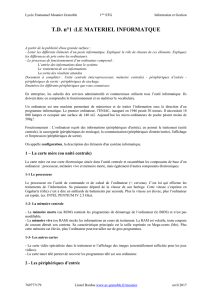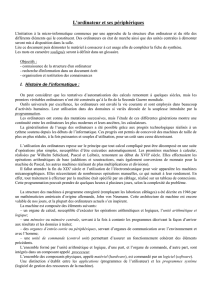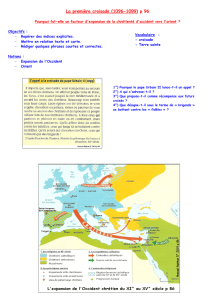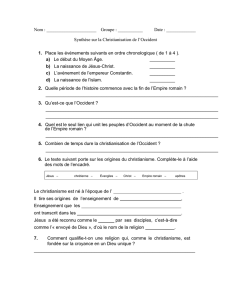Word

Introduction
Les nombreuses visites en Afrique, Asie et Moyen-Orient de Hu Jintao (premier ministre de la République de Chine), témoignent
de la volonté de ce pays « émergent » de s'affirmer concrètement sur la scène économique et politique mondiale. Le gouvernement
chinois veut ainsi passer du statut de système politique périphérique à celui d'un centre duquel on dépend.
Les pays dits « périphériques » sont ceux couramment appelés pays du Tiers-Monde, du Sud ou en voie de développement.
La frontière est floue et nos exemples se limiteront aux plus emblématiques. Ces pays sont définis comme opposés et/ou exploités
par le centre, constitué des pays riches de l'Occident, et plus particulièrement de la Triade (Etats-Unis, Europe de l'ouest, Japon).
Si les pays en voie de développement sont sortis de la décolonisation depuis plusieurs années déjà, on peut remarquer qu'ils restent
en certains points relativement dépendants des pays occidentaux. Beaucoup de théories mettent en avant cette dépendance au
centre qui imprègnerait les périphéries et notamment leur système politique. Le système politique peut être défini comme un tout
décisionnel formé d'un régime politique, d'une structure économique et d'une organisation sociale. La notion de système politique
peut cependant être remise en cause, et la notion de dépendance peut aussi être pensée vis à vis d'un contexte culturel propre plutôt
que vis à vis de l' »Occident ». Néanmoins, nous centrerons l'exposé sur le terme "périphérique" et ses différentes acceptions.
Ainsi, la notion de système politique"périphérique" peut être comprise comme une dépendance. Pourtant, on peut aussi la
traiter en terme de différence, notamment au niveau culturel.
Nous allons donc voir comment s'exprime la dépendance économique et politique des pays périphériques par rapport à l'Occident,
avant de relativiser cette approche en traitant notamment la culture propre aux périphéries.
I- Des systèmes politiques périphériques en tant que dépendants de l'Occident
Tant au niveau théorique que dans les faits.
A) Dépendance épistémologique
On peut remarquer que les théories que nous allons présenter sur les relations Nord-Sud sont uniquement issues de
l'Occident, qui universalise son discours sans même questionner d'autres réflexions.
C'est ainsi que la conception ethnocentriste de périphéries dépendantes et en retard, qui base le dvtalisme et ses origines
évolutionnistes, est aussi présente dans le nouveau courant dépendantiste et néo-marxiste.
1-Évolutionnisme et développementalisme
EVOLUTIONNISME
Première conception du développement au XIX°, qui postule l'existence de lois immanentes à toute évolution humaine.
De fait, les quelques traits communs à l'histoire des sociétés présumeraient l'universalité de la modernité industrielle
(positivisme d'Auguste Comte). Le darwinisme social sous-tendu pense les sociétés dominantes comme
fondamentalement meilleures. Cette dérive racialiste légitime la domination par un devoir moral d'accompagnement
des sociétés dépendantes.
Cette infériorité supposée s'exprime à travers les dénominations occidentales hiérarchisantes; Lewis Henry Morgan
distinguait ainsi trois stades d'évolution des sociétés: sauvage, barbare et civilisé. Aujourd'hui on a les "pays du Sud",
majoritairement d'anciennes colonies, ou "1/3 monde", "pays pauvres", "PMA", "PVD", "pays sous-développés"…
Ces derniers noms viennent du DVTALISME, inauguré par le discours de Truman en 49 et encensé dans les
années 60.
Ce courant introduisait un lien de solidarité entre développement et sous-développement, même si il avait d'abord pour
but d'assister les pays en voie de décolonisation afin de les écarter de l'influence soviétique. Il s'agit donc pour
l’Occident de laisser croire en sa responsabilité exclusive de conduire le développement des périphéries alors
dépendantes, notamment à travers l'économie libre-échangiste (bqs mondiale 44/régionale 64, PNUD 65).
La théorie de la modernisation des années 50 reprend le même stéréotype d'incompétence du "sous-développé",
en avançant que c'est un problème culturel qui empêche ces sociétés périphériques de s'arracher à la tradition comme l'a
fait l'Occident (étapes de Rostow, confusion des secteurs développés pour Talcott-Parsons).
Cette conception du "retard" induit la dépendance à un but occidental, au-delà de l'histoire et de la culture locales.
Le terme de "développement" en lui-même n'est donc pas neutre en ce qu'il induit une linéarité universaliste où les
périphéries dépendraient du centre; Serge Latouche nomme ainsi néo-développementalisme les nouvelles utilisations
du terme de développement; "autocentré, endogène, durable"…
TRANSITION
On peut voir pourtant que la CEPAL (Commission Economique pour l'Amérique Latine), pensait de ce courant
développementaliste qu'il favorisait plus les pays industrialisés que les autres. Les dirigeants de la CEPAL imaginèrent
donc une légère émancipation au moyen d'une gouvernance forte qui puisse apporter le productivisme, des
investissements sociaux, une diversification économique…

Si cette approche a été qualifiée de "socialisme camouflé" du fait de la similitude avec les théories de la dépendance,
elle a aussi été décriée par des courants plus radicaux encore;
2-Impérialisme et dépendantisme
Les théories de la dépendance sont assez diverses voire divergentes.
Elles peuvent s'inspirer d'une part d'intellectuels marxistes et néo-marxistes à propos de l'IMPÉRIALISME
comme stade suprême du capitalisme (ouvrage de 1916).
En effet, l'impérialisme capitaliste induit le sentiment d'une supériorité culturelle et technique sur le pays dépendant. Le
colonialisme était le développement du capitalisme (fourniture de matières premières), et Lénine a montré la dimension
mondiale de l'exploitation capitaliste en imaginant en avance une nouvelle mise en dépendance de certaines nations par
de grandes entreprises tendanciellement a-nationales.
Cardoso met ainsi en évidence que la domination économique (IDE, prêts, …) entraîne celle politique tout en étant
masquée par l'indépendance des anciennes colonies.
Le modèle de CENTRE/PÉRIPHÉRIE, théorisé par Emmanuel Wallerstein, fait aussi partie du courant de la
dépendance.
De fait, il traite des économies-monde qui se déplacent selon les époques de Venise à New-York (Braudel) tout en
gardant une structure hiérarchique inégalitaire, à partir de laquelle la périphérie dépend effectivement du centre.
La théorie du DÉPENDANTISME en tant que telle, très influente dans les années 60 à 70, soutient une vision
globale et holiste de l'histoire sociale, politique et économique mondiale.
Au niveau extérieur, cette théorie avance que les pays les plus riches maintiennent la dépendance des pays les plus
pauvres par des contraintes légales, financières et techniques. Cela pour permettre leur propre développement à travers
l'exploitation des ressources naturelles et la main d'œuvre (colonisation). C'est donc une interdépendance arbitraire où
le Sud est structurellement mis en dépendance par son intégration au commerce international.
Au niveau interne, cette intégration est progressive et différenciée selon la fonction dans le capitalisme international
de l'époque, la structure de la société à ce moment… l'adaptation à cette "agression capitaliste" changera au gré de
l'histoire et de la culture de la périphérie, que mettent en œuvre les élites locales avec le possible soutien des masses.
Pourtant, ces adaptations ne suffisent pas à harmoniser l'évolution de la périphérie, tout de même soumise et confrontée
à des valeurs qui ne sont pas les siennes et dont elle ne récolte pas les fruits.
En témoignent les nombreux exemples de concrétisation de la dépendance prolongée des périphéries, aux niveaux
politique comme économique;
B) Concrétisation de la dépendance
Dans cette partie, nous allons voir concrètement l’application de la dépendance des pays dits « périphériques » par
rapport à l’Occident. Cette dépendance s’est tout d’abord exercée lors de la colonisation et de nombreuses structures
mises en place à cette époque ont été maintenues par la suite. Puis, nous analyserons les rapports de domination
économique, à travers l’impérialisme capitaliste occidental.
1- La dépendance politique à travers la colonisation
Lorsque des pays occidentaux ont colonisé les pays du « Sud », ils y ont instauré des structures politiques à l’image de
leur propre civilisation. Ils ont ainsi mis en place un centre politique et militaire, une administration économique, une
bureaucratie souvent dirigée par les élites occidentales ou par une élite locale occidentalisée. Cette bureaucratie
permettait de contrôler la société civile mais également les élites locales. Sous la forme souvent d'une tutelle sur le
système politique du pays colonisé étaient imposée toute une structure politique et économique. On imposait alors toute
une vision et lecture du monde occidentalo-centrée. Cela participait de la « mission civilisatrice » que s'étaient attribuée
les puissances colonisatrices (conformément à la théorie du développementalisme). C'était une sorte de nationalisme
inadapté aux structures locales mais le but de civiliser et de développer les pays « périphériques » était primordial.
Ainsi, en Afrique par exemple, l'espace politique a été complètement recomposé. « La classe dirigeante européenne
avait une haute idée de ses qualités culturelles, biologiques et technologiques qui s'accompagnait d'une vision
systématiquement négative des Africains. » Young C.
Concrètement, il y a même eu un processus de dépolitisation des populations colonisées « basé sur l'officialisation d'un
statut subalterne et sur le primat de la bureaucratie dans l'orientation et l'application des décisions publiques ». Tout est
guidé par des principes politiques venant de la métropole. Prenons l'exemple de la France sur son empire colonial
africain : L'Afrique Equatoriale Française et l'Afrique Occidentale Française sont dirigées par un gouverneur général
qui contrôle les gouverneurs placés à la tête de chacun des territoires qui composent les deux fédérations. La puissance

anglaise quant à elle favorise un modèle de gouvernement indirect, c'est-à-dire qui combine le contrôle de la puissance
coloniale avec des structures traditionnelles pré coloniales. Les élites traditionnelles ont alors un rôle d'intermédiaires.
Dans les faits, les populations locales y compris leurs élites sont soumises au pouvoir colonial.
Si les pays sont sortis de la colonisation, il reste encore aujourd'hui certaines traces de cette époque, notamment à
travers des institutions politiques laissées en l'état et plus ou moins adaptées à la réalité nationale. Dans l'ex-Afrique
d'influence française, le modèle constitutionnel de la Ve République a prévalu, surtout à partir des années 60. En outre,
une libéralisation politique se met en oeuvre après la Seconde Guerre Mondiale. Cette phase de libéralisation voit
émerger des partis politiques plus ou moins proches des partis métropolitains en ce qui concerne l'Afrique française, et
plus particulièrement en Côte d'Ivoire avec le RDA ou Rassemblement Démocratique Africain. Le syndicalisme se
développe, de nouvelles élites s'affirment, familiarisées avec les mécanismes de l'élection et de la représentation ou
encore concernant les fonctions ministérielles. Beaucoup de pays africains ont ensuite appliqué le mimétisme
institutionnel, copiant le modèle français : un président maîtrisant l'exécutif, un parlement bicaméral, des élections au
SU, un système multi-partisan...Néanmoins, les pays colonisés ne sont pas le reflet d'une démocratie parfaite.
En outre, à partir des années 1960, la volonté des pays colonisateurs est de pérenniser leur tutelle économique à défaut
d'une tutelle politique. C'est ce qui caractérise le néocolonialisme. Ce néocolonialisme se traduit toujours par une
dépendance.
2- La dépendance économique à travers le néo-colonialisme
Les pays occidentaux dans leur rapport aux pays anciennement colonisés vont chercher à maintenir des liens,
cette fois-ci plus économiques, en raison notamment comme on le verra d'échecs dans la politique.
La place prépondérante de l'économie se remarque dans l'idéologie véhiculée par les puissances occidentales : le
libéralisme. Pour Serge Latouche, l'impérialisme des occidentaux a déterminé le capitalisme imposé dans les pays du
Sud. Cette nouvelle dépendance des pays périphériques se traduit par la forte importance qu'acquièrent les
investissements occidentaux dans leur structure économique, la présence des firmes multinationales, l'ingérence des
associations humanitaires... Ainsi, la dépendance se traduit pour certains par un assistanat. Dans l'exemple africain, le
phénomène d'ingérence humanitaire serait pour certains « la traduction à la fois du statut dévalorisé du continent
africain et de l'incapacité des États à agir selon les procédures internationales classiques. » Au Rwanda et en Somalie,
la lourdeur de l'intervention humanitaire serait proportionnelle au renoncement politique généralisé.
Ces dernières années, l'impérialisme s'impose dans les pays périphériques par le recours aux intermédiaires comme les
organisations internationales et onusiennes particulièrement. Ceci fonde les thèses néo-dépendantistes.
Dans cette théorie comme dans beaucoup d'analyses récentes de la dépendance des systèmes politiques périphériques,
l'économie a une place déterminante car elle agit sur le politique. En effet, l'économie devient aujourd'hui un facteur
explicatif de la domination des Occidentaux. Néanmoins, l'on doit souligner les importantes motivations politiques qui
subsistent dans cette domination.
Dans le même ordre d'idée, on peut aussi souligner le néocolonialisme des Etats-Unis à travers des accords bilatéraux
qu'ils concluent avec des pays périphériques comme c'est actuellement le cas pour une dizaine de pays en voie de
développement, concernant des accords de libre-échange, dont des pays d'Amérique latine. On voit aussi l'application
de ce néocolonialisme à travers les institutions internationales comme le FMI ou la Banque mondiale qui accordent des
prêts à des pays du tiers monde s'ils prennent des mesures favorables à leurs propres intérêts financiers. La dette des
pays du tiers monde est donc renforcée par cette dépendance des pays périphériques aux pays occidentaux.
Ainsi, la périphérie est ici comprise négativement dans le sens où les pays périphériques sont dépendants
politiquement et économiquement des pays occidentaux. Leur système politique propre garde encore aujourd'hui de
nombreuses traces du colonialisme et cela a peu de chances d'évoluer si l'on considère l'importance actuelle du
néocolonialisme économique principalement. Toutefois, il ne faut pas s'en limiter à cette définition de la périphérie
mais il convient de prendre notamment en compte le facteur culturel afin d'appréhender la notion de « système politique
périphérique » comme un système également différent du système central occidental. En ce sens, le terme
« périphérique » cesserait d'avoir une connotation péjorative car on s'intéresserait plus à penser les sociétés du Tiers
Monde en elles-mêmes et pas « par rapport à l'Occident ».
Afin d'appréhender la notion « périphérique » dans un autre sens que celui de la dépendance, nous allons ici exposer les
échecs de transposition du modèle politique occidental liés aux différences culturelles. Puis nous analyserons la
trajectoire propre à certains systèmes politiques périphériques, pour se demander si ceux-ci ne font pas le choix d'une
autre modernité. Prendre le facteur culurel en compte, idée de politique comparée proche de l'anthropologie.
II- Des systèmes politiques périphériques aussi en tant que différents de l'Occident

La différence à l'Occident s'exprime donc négativement, par les
A) Échecs de transposition dans une culture différente
1-Echec théorique
Au cours des années 70, le comparatisme classique est en crise et on relativise l'approche occidentale des suds. Les
théories de la dépendance qui ont initié cette critique restent cependant un modèle occidentalo-centré et universalisant
qui sous-estime l'autonomie culturelle des périphéries.
On admet toujours plus la PLURALITÉ des centres comme des périphéries, et on voit d'autant plus la faiblesse
du terme "1/3 monde", créé par Alfred Sauvy dans un cadre non scientifique, à travers la multiplication d'autres termes
différenciés; nouveaux pays industrialisés (Corée du sud, Taïwan, Singapour, Hong-Kong), pays émergents (Chine,
Inde), puissances régionales (Brésil, Afrique du Sud), pays les moins avancés (Afrique subsaharienne)...
Pour Serge Latouche cette diversité viendrait du fait que le politique précède l'économique, et non l'inverse
(marxisme), ce qui induit que le capitalisme ne vient pas naturellement et unifie encore moins les systèmes politiques à
travers l'impérialisme. Il n'y a donc ni bloc uni ni traitement global efficace, et les valeurs occidentales, même
enrichissantes ne sont pas normatives.
Les CONSÉQUENCES CULTURELLES de ce modèle imposé sont négligées alors même qu'elles peuvent
aboutir à un choc des civilisations autrement plus dangereux qu'un choc politique, selon Samuel Huntington.
Face à la crise identitaire actuelle, on défendrait en effet plus qu'avant sa culture (particulièrement sa religion) et non
les idées politiques ou économiques. Il y aurait donc au XXI°siècle un fort risque de confrontation des revendications
d'indépendance culturelle entre centres (Europe, USA) et périphéries (monde musulman, Chine).
2-Echec pratique
Le développement promis aux anciennes colonies est soit très lent soit absent, même avec une adaptation progressive et
différenciée. Des fondements de la culture locale sont en effet négligés, ce qui constitue un frein à l'essor qu'a connu
l'Occident et ce qui provoque une tension (les musulmans en Europe).
Ces changements culturels imposés ont des conséquences ECOLOGIQUES graves; le gouvernement
occidentalisé indien avait ainsi voulu moderniser la production de communautés sri-lankaises en imposant la pêche au
filet (avec du surplus) plutôt que la pêche à l'arc et la flèche, prévue pour l'unique subsistance.
Les conséquences de cette généralisation du surplus se voient aujourd'hui, dans les périphéries qui subissent et
poursuivent les excès occidentaux sans avoir les moyens politiques ou économiques de les limiter; hyper-pollution du
lac de Tong Lé Sap au Cambodge en quelques décennies d'activité commerciale, rupture de la chaîne alimentaire dans
la région des grands lacs de Tanzanie avec l'introduction de la perche du Nil, extension des déserts de Gobi en Chine et
du Sahara en Afrique, notamment à cause de l'agriculture intensive.
La société civile pourrait, comme en Occident, protester pour sa sécurité écologique. Mais au niveau
POLITIQUE, la périphérie de ces nations est minorisée (on le voit par l'absence de classes moyennes), alors même
qu'elle y est souvent dite traditionnellement importante. À l'inverse est survalorisé un centre d'élites occidentalisées qui
délaisse les cultures locales (synonyme de passéisme), et l'idéal occidental. En Afrique notamment, Daniel Bourmaud
met en avant les dérives du présidentialisme monocentré qui glisse vers l'autoritarisme violent, ou encore les
dysfonctionnements bureaucratiques qui favorisent la corruption généralisée.
La seule mobilité politique des élites consiste en des coups d'États souvent sanglants; assassinat de Melchior Ndadaye
au Burundi en automne 93, dictature de Mobutu et conflits sanglants dans la nouvelle coalition au Congo-Kinshassa,
génocide rwandais planifié par le pouvoir en 94…
Ce dernier exemple pose la question de l'échec IDENTITAIRE; en effet le concept d'État-nation dans le cadre
de frontières arbitraires favorise d'autant plus les conflits territoriaux que préexistaient souvent d'autres frontières
(communautés africaines, pays en -stan) ou du moins une tradition de pluralisme territorial et d'identité fonctionnelle où
se mélangeaient donc les cultures. C'est ainsi que les tensions balkaniques peuvent être comprises comme le résultat du
choc entre l'idée occidentale d'État-nation libéral et la tradition musulmane de mélange respectueux des cultures.
ECONOMIQUE
La culture de l'entrepreneur libéral, bien que promue par l'occident, reste bien souvent absente du fait des structures
communautaires et de la soumission à l'Occident et aux élites locales qu'il mène. Le clientélisme empêche ainsi le
développement économique promis en restant souvent à une dégradation des termes de l'échange sans réelle
émancipation industrielle.
Ce primat imposé de l'économie sur le politique peut justifier nombre d'injustices (exploitation et autoritarisme pour
qu'une minorité fasse des profits au détriment de la démocratie et de la majorité, comme en Chine ou au Moyen-Orient)
et provoquer des crises sociales sans précédent (Asie du sud en 1997, Argentine en 2002…).

C'est de ce fait que dans les périphéries des pays centraux-mêmes, l'existence d'un "quart-monde" (les exclus des pays
riches) provoque une conscience d'un modèle occidental source d'inégalités fortes. Face à cela, divers mouvements
altermondialistes militent pour une autre modernité, qui pourrait venir des périphéries;
B) Une modernité périphérique: le choix d'une autre "évolution"?
Si le modèle politique et économique occidental connaît de nombreuses failles, notamment dans son imposition aux
systèmes politiques périphériques, il convient de s'interroger sur la possible trajectoire volontaire de ces derniers vers
une autre évolution, une modernité périphérique. Ici nous choisissons d'employer le terme « évolution » car celui de
« développement » reste un terme occidental induisant une certaine linéarité du processus. Or, dans de nombreux pays
en voie de développement ( l'Asie du Sud par exemple avec la Thaïlande ), l'évolution de leur système est loin d'être
linéaire comme en témoignent les crises économiques qui détruisent souvent l'ordre établi. Exemple : Crise Argentine,
les autoritarismes en Afrique...
Ici le postulat de l'autonomie des hommes à construire leur destin est posé. L'exemple de l'Inde qui refuse l'aide
internationale lors du tsunami en décembre 2004 l' illustre.
1-Une différenciation culturelle qui mène à…
Voyons tout d'abord en quoi les systèmes politiques périphériques se différencient culturellement de ceux des
pays occidentaux.
La culture des pays périphériques s'oppose tout d'abord à celle des pays occidentaux, parfois dans sa tradition
polythéiste et romantique, face au rationalisme et au monothéisme. Elle est propre à chaque État et l'on ne peut donc
pas établir de culture commune à tous les pays en voie de développement. L'univers des africains est par exemple
fondamentalement religieux et, pour eux, en société on n'existe pas pour soi mais par rapport aux autres. La tradition
africaine est empreinte de « pudeur morale, sens de la famille et sens du mystique », Eugène Fournier.
L'étude des cultures et traditions des pays en voie de développement apparaît aujourd'hui de plus en plus nécessaire
pour établir la distinction entre système politique périphérique et système politique occidental. La socio-histoire de la
culture-civilisation participe de cette étude car elle analyse la construction et la domination des pays selon un processus
historique, en lien avec la tradition culturelle des pays. Nouvelles théories s'imposent face à l'insuffisance des théories
classiques qui négligent le facteur culturel.
Une autre différence culturelle qui existe depuis longtemps et subsiste aujourd'hui : en Asie, avec la valeur du travail
très différente de celle de l'Occident. D'autre part, la croissance peut ne pas être nécessaire pour le bon déroulement
d'un système politique, alors qu'elle semble imposée par les occidentaux comme indispensable. Les NPI d'Asie sont
ainsi passés du statut de pays en voie de développement à celui de nouveaux pays industrialisés en très peu de temps et
selon un modèle très différent de celui du développement occidental.
L'on peut en outre trouver des germes internes de la modernité et de la démocratie dans de nombreux systèmes
politiques périphériques, comme en témoigne par exemple la palabre en Afrique, coutume de rencontre et de création
ou de maintien de lien social. Cette coutume africaine permet également de régler les contentieux et s'apparente à une
forme de démocratie. Pour Eugène Fournier, « la culture africaine, bien qu'il ne faille pas tout retenir, contient des
valeurs que l'on pourrait proposer au patrimoine spirituel de l'humanité. »
Amartya Sen a pointé cette caractéristique périphérique qui démontre que la culture des pays en voie de développement
est différente mais qu'elle peut amener à une autre modernité, non moins positive que celle des occidentaux.
On peut également souligner l'apport de la théorie culturaliste qui réintègre la culture dans l'étude des sociétés
périphériques : ce courant tente une description de la société sous les points de vue de l'anthropologie et de la
psychanalyse. Il met en évidence l'influence prépondérante de la culture sur la personnalité des individus.
Cette différenciation culturelle que nous avons établi se traduit souvent dans les faits par une différenciation politique
des systèmes politiques périphériques.
2-… Une différenciation politique
En effet, la différence culturelle des pays périphériques s'exprime souvent dans leur fonctionnement politique. On peut
ainsi distinguer plusieurs modèles de systèmes politiques pré-modernes : le modèle segmentaire ( sans centre, constitué
uniquement d'une société civile, comme pour les sages africains ) et le modèle patrimonial ( faible différenciation du
centre et de la société civile, structures politiques centrales considérées comme propriété du prince et de son entourage,
avec pratiques clientélistes du centre patrimonial ) sont plutôt à relier aux systèmes politiques périphériques et
s'opposent aux modèles féodal, impérial et de cité-Etat, caractérisant plus les systèmes politiques des pays occidentaux.
Les différences politiques se voient également de nos jours, dans le contexte de modernité actuel.
Ainsi, dans les pays périphériques, la tradition politique n'est pas forcément celle d'un centre institutionnalisé, et
lorsqu'il y a un centre, celui-ci ne se traduit pas forcément pas l'Etat que nous connaissons dans nos sociétés
 6
6
1
/
6
100%