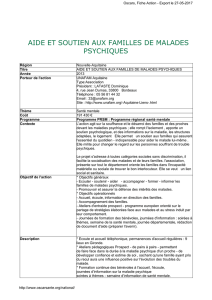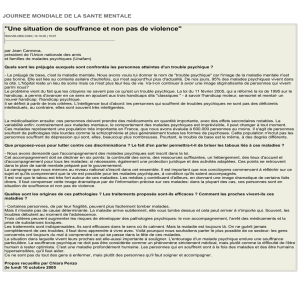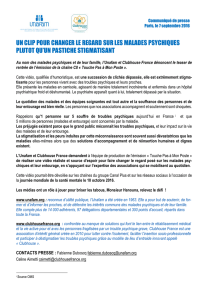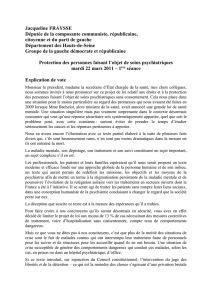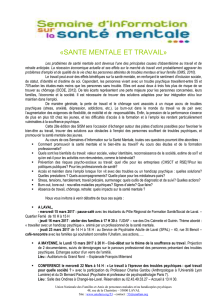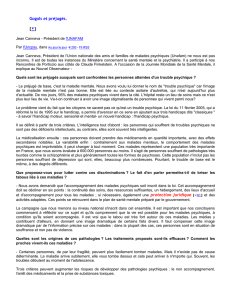Avec cet article - synergie Un réseau de Bénévoles pour «Faire Face».

La famille face à la maladie psychique
Vivre avec un proche souffrant d’un trouble psychique est une expérience éprouvante. Des
solutions pour accompagner les familles voient le jour, mais elles se retrouvent encore
souvent en première ligne.
AMELIE-BENOIST/BSIP
La stigmatisation des patients atteints de maladies psychiques conduit à
l’isolement. Mais les familles s’impliquent de plus en plus.
Avec cet article
Les proches oscillent entre inquiétude et espoir
Annick Hennion : «La maladie mentale continue à faire peur»
Souffrances, incompréhensions, inquiétudes, culpabilité, isolement, ruptures, ressentiment…
Ces mots durs reviennent inlassablement dans les propos des familles des malades atteints
de troubles psychiques. Quand il est aussi question d’espoir, c’est bien souvent après un
parcours chaotique. «Aujourd’hui on considère qu’entre les premiers signes de la maladie et
le diagnostic, près de dix années s’écoulent. Pourtant, on sait l’importance d’un diagnostic
précoce pour le devenir des malades», souligne Annick Hennion, directrice de l’œuvre Falret
qui lance aujourd’hui sa première campagne d’information sur la santé mentale afin de lutter
contre la stigmatisation des personnes touchées par la maladie.
Un manque d’empathie qui affecte les malades, mais aussi leurs familles, propulsées en
première ligne dès les premiers symptômes. Certes la loi du 11 février 2005 reconnaît la
notion de handicap psychique et, à ce titre, une prise en charge médico-sociale de ces
personnes. Mais les témoignages soulignent que du chemin reste à parcourir. Derrière les
injonctions stériles – «Remue-toi
! Prends tes médicaments
! Arrête de t’angoisser
!» – se
cache souvent la détresse de ceux qui endossent à la fois le rôle d’aide-soignant et de
«pare-feu», entraînés à repérer les signes avant-coureurs d’une crise, dosant les
médicaments, ou tentant de calmer les angoisses.
«Personne n’est préparé à vivre de tels bouleversements qui mettent à mal tous les repères.
Ces proches sont en recherche d’écoute, de soutien et de compréhension, et aussi en quête
de sens car ils ne trouvent plus dans leurs ressources naturelles assez de force pour faire
face», observe Marie-Françoise Debourdeau, psychologue responsable du service Écoute
famille à l’Unafam.
Fait relativement nouveau, si les parents, les conjoints, la fratrie (notamment lorsque les
parents disparaissent) sont propulsés au rang d’aidants familiaux, les grands-parents sont
aussi de plus en plus concernés, témoigne Aline, bénévole à l’Unafam, impliquée dans des
groupes de réflexion. «Des couples se formant sur les lieux de soin ou de réinsertion, il est
assez fréquent que certains de nos petits-enfants aient leurs deux parents atteints de
troubles psychiques. Pourtant, il ne semble exister aucune évaluation du nombre de familles

concernées, de leurs besoins et des réponses à apporter. Ce qui rend encore plus difficile
l’exercice de nos fonctions de grands-parents.» Tiraillée entre la protection des petits-
enfants, et la confiance à accorder à leur propre enfant, cette génération désemparée
cherche alors sa place.
Comme de nombreux proches, ils expriment souvent un ressentiment à l’égard des
psychiatres, accusés de se dissimuler derrière le secret médical et une communication au
compte-gouttes. Que répondent ces derniers ? «Dans l’ensemble, nous respectons un grand
principe
: on parle avec la famille en toute transparence du patient que l’on suit, mais avec
l’assentiment de ce dernier», explique le docteur Denis Leguay, psychiatre hospitalier à
Angers (1).
Certes, des dysfonctionnements existent, reconnaît le praticien. «Il y a le manque de temps,
et certains psychiatres gardent aussi une méfiance de principe par rapport aux proches…
Mais dans l’ensemble, on est loin de l’idée, qui a longtemps prévalu, de la famille coupable
et aliénante. La majorité des psychiatres savent combien elle est en première ligne pour
aider la personne à se rétablir et, depuis une dizaine d’années, font plutôt le pari de l’alliance
thérapeutique.»
Point positif, des bonnes pratiques se mettent peu à peu en place. Adapté d’un modèle
canadien, Pro famille est un programme psycho-éducatif présent dans certains hôpitaux,
destiné aux proches de patients souffrant de schizophrénie, qui propose des clés aux
proches pour améliorer la relation avec le malade. «Les connaissances acquises grâce aux
recherches en neurosciences vont aussi nous aider à mieux définir les particularités de la
relation avec le malade et ainsi de soutenir les familles. Des études sont en cours», assure
le professeur Marie-Christine Hardy-Baylé, chef du pôle psychiatrie au centre hospitalier de
Versailles.
Il reste que l’inquiétude principale des familles concerne l’attitude à adopter dans les phases
aiguës de la maladie. «Une idée simple serait d’établir – en dehors d’une crise – un contrat
avec la famille, l’équipe soignante et le patient, afin que ce dernier désigne une personne de
confiance qui se sentirait plus sereine pour prendre les décisions qui s’imposent», suggère le
professeur Hardy-Baylé en observant qu’à l’heure où l’on souhaite être acteur de sa santé,
cette mesure peu coûteuse serait aisée à mettre en œuvre.
Dans un autre domaine, l’œuvre Falret qui propose des lieux d’hébergement pour les
malades, est aussi consciente du risque d’épuisement des proches : depuis 2009, le séjour
« Répit » (2) permet à ces derniers de faire une pause durant une semaine, alors que la
personne malade est accueillie dans une structure voisine. Autant d’initiatives qui ne
suffisent pas encore à pallier l’insuffisance de la prise en charge à la sortie de l’hôpital.
Bénévole de l’Unafam, Aline se veut cependant optimiste : «Heureusement, il arrive que la
force de la vie surprenne tout le monde», conclut-elle.
………………..
QUELQUES CHIFFRES
En France, les pathologies relevant de la psychiatrie se situent, après le cancer et les
maladies cardio-vasculaires, parmi les plus fréquentes. Elles apparaissent souvent au
moment de l’adolescence, ou au début de la vie d’adulte.
Plus des deux tiers des médecins généralistes déclarent devoir prendre en charge
chaque semaine au moins un patient souffrant de dépression (81 % pour un trouble
anxieux). 70 % des malades sont soutenus par leurs proches familiaux.
TROUVER DE L’AIDE
Œuvre Falret www.falret.org. Tél. : 01.58.01.08.90
Union nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
psychiques www.unafam.org
Le service d’écoute téléphonique Écoute famille (01.42.63.03.03) de l’Unafam propose le
soutien d’une équipe de psychologues cliniciennes.
Un livre témoignage Le Coupe-ongles, Stéphane Alexandre, Éd. Arènes, 19 €.
Marie Auffret-Pericone
(1) Il sera aussi aux «8e s journées de RéH@b’» à Angers , les 5 et 6 Juin 2014 sur le thème
de l’expérience des usagers et des équipes pluridisciplinaires. www.rehabilite.fr
(*) Ce programme a été récompensé par des trophées nationaux. www.associationrepit.fr

Les proches oscillent entre inquiétude et espoir
Les familles de schizophrènes se sentent souvent désemparées devant la maladie et isolées
dans la société.
«Le diagnostic de la maladie fut long et difficile à obtenir»
Audrey, mère de Raphaël, 17 ans.
«Mon fils est schizophrène. Il est scolarisé en première ES, dans une école privée hors
contrat qui accueille des jeunes ayant du mal à entrer dans le moule scolaire. Si on m’avait
dit, quand il avait 11 ans, qu’un jour il préparerait le bac, je ne l’aurais pas cru.
J’ai senti très tôt qu’il y avait “quelque chose”. Pendant ses cinq premières années, il n’a
jamais fait une nuit complète. À l’école, il n’avait pas d’amis. Très tôt, il a consulté des psys
qui ne nous disaient pas grand-chose, sinon qu’il était dans un fantasme de “toute-
puissance” et autres âneries psychanalytiques.
En classe, il était souvent agité. Lors d’un voyage scolaire, il a “pété les plombs”. Quelques
mois plus tard, il s’apprêtait à se jeter par la fenêtre car il “ manquait d’air”. Il a fallu le
déscolariser.
Le diagnostic de la maladie fut long et difficile à obtenir. Vers 12-13 ans, dans un hôpital
parisien, un psychiatre assez expérimenté nous a parlé de schizophrénie. Connaître le
diagnostic m’a presque rassurée. Il a pu intégrer un hôpital de jour, à 12 ans, où il a pu
suivre un cursus scolaire durant trois ans, mais avec de violentes crises d’angoisse chaque
matin. Les médicaments ont été d’une grande aide. Il en prend encore, mais à dose réduite.
J’ai dû cesser toute activité pour m’occuper de lui. Mon mari prenait le relais le week-end.
Nous sommes restés très unis et solidaires. J’ai tout fait pour continuer à avoir une vie
sociale. Mais parfois, tout m’était indifférent.
J’ai toujours dit à ma fille, la sœur de Raphaël, que j’étais disponible pour elle. Mais elle a
sans doute mis ses inquiétudes de côté. Nous avons eu de la chance, car il n’a pas été
victime de rejet de notre famille. Il est très courageux. Aujourd’hui il a 17 ans, se prend en
main, et a mis en place des stratégies pour calmer ses angoisses et ne pas laisser la
maladie prendre le dessus. Récemment, il est parti en camp de vacances, a pris l’avion
seul… Il y a un vrai espoir.»
«Quand ils ont décidé de créer un foyer, les réactions ont été négatives»
Pierre et Marie-France, parents de Jocelyn, 44 ans.
«Nous avons quatre enfants, dont deux souffrent d’une maladie psychique : une fille de
47 ans qui vit dans un foyer médicalisé, et un garçon de 44 ans, souffrant d’une psychose
légère, décrite par sa psychologue comme une “schizophrénie affective”. Il est marié et père
de deux enfants de 7 et 11 ans.
Sa maladie s’est déclarée vers 15 ans, avec des troubles importants. Grâce à la
psychothérapie et les médicaments, son état s’est stabilisé, mais il reste fragile, ce qui est
souvent pour nous une source d’inquiétude. Quand il a rencontré sa femme et qu’ils ont
décidé de fonder un foyer, les réactions autour de nous ont été négatives.
Certains de nos proches – en particulier son frère qui avait beaucoup souffert de sa
violence – nous ont dit que nous ne devions pas le laisser se marier. Sa rencontre avec sa
femme qui venait d’Algérie a été une rencontre d’amour, mais aussi celle de deux fragilités.
Ils ont trouvé compréhension et protection mutuelles.
Notre fils connaît toujours des hauts et des bas, auxquels s’ajoute une précarité
économique. Ses enfants savent que leur père est malade. Nous sommes très présents
auprès d’eux depuis le début. Il faut faire confiance aux enfants sur leur capacité de
s’adapter. Ils font ainsi l’apprentissage de la différence, de la fragilité.
Pendant longtemps, nous avons ressenti une certaine honte par rapport à nos amis dont les
enfants grandissaient, faisaient des études… Durant toutes ces années, nous avons trouvé
du soutien dans un mouvement chrétien, le Relais Lumière Espérance et à l’Unafam, où
nous participons à un groupe de grands-parents.
Échanger avec d’autres permet de relativiser nos problèmes qui paraissent minuscules par
rapport aux difficultés auxquelles certains sont confrontés. »
Recueilli par Marie Auffret-Pericone

Annick Hennion : «La maladie mentale continue à faire peur»
En lançant la campagne «Aimer pour guérir», la Fondation Falret souhaite informer et
contribuer à «déstigmatiser» les personnes souffrant de troubles de santé mentale.
Entretien avec Annick Hennion, Directrice de la Fondation Falret
La Croix : La Fondation Falret organise sa première campagne d’information sur la
santé mentale. Quel est son objectif ?
Annick Hennion : Pour compléter l’action de l’œuvre Falret (1), la Fondation s’est donné
une triple mission : l’information du public afin de contribuer à « déstigmatiser » les
personnes souffrant de troubles de santé mentale, la recherche-action pour faciliter leur
adaptation à la société, et le soutien à l’innovation des pratiques d’accompagnement.
Pour cette première opération, nous avons choisi de montrer combien les familles sont en
première ligne face aux troubles psychiques.
Y avait-il urgence à communiquer sur ce sujet ?
A. H. : Selon l’OMS, en 2020, un Français sur cinq sera touché, au moins une fois dans sa
vie, par un problème de santé mentale. La prévalence de certains troubles, comme
l’anorexie, la dépression, les troubles anxieux, de l’humeur ou les TOC (troubles
obsessionnels compulsifs), augmente. Parallèlement, la maladie mentale continue à faire
peur.
Dans les médias, quand on parle de schizophrénie, ce n’est qu’à la suite d’un fait divers
dramatique et souvent ces malades disent : «J’ai demandé de l’aide, mais personne n’a
répondu.» Les gens «normaux» ont du mal à tendre la main aux personnes différentes qui,
parfois, arrêtent de prendre leurs médicaments pour rester dans leur bulle ou leur délire. Si
nous étions plus accueillants, les malades accepteraient davantage de se soigner.
Vous êtes en contact avec de nombreuses familles de malades psychiques. Que vous
disent-elles ?
A. H. : Nous sommes en contact avec les familles qui font valoir la détresse dans laquelle
elles se trouvent. Pour près de la moitié des personnes souffrant d’un trouble de santé
mentale, les premiers signes se déclarent autour de l’âge de 14 ans. Or, ces troubles sont
difficiles à diagnostiquer et les médecins hésitent à « étiqueter » trop vite une personne.
Elles témoignent aussi du manque d’accompagnement et de structures pour les accueillir,
même si, grâce à la loi du 11 février 2005, la notion de handicap psychique est reconnue et
permet, en principe, une meilleure prise en charge. Mais certaines institutions refusent de
prendre en charge certains malades « trop lourds », et la famille doit alors s’en occuper.
Ces proches témoignent aussi de leur isolement : leur entourage a peur de l’imprévisibilité
d’une crise, et de la bizarrerie. Ce sont les malades et leurs familles qui nous ont incités à
faire connaître ce problème.
Quels sont les enjeux de cette campagne aujourd’hui ?
A. H. : D’abord informer pour contribuer à diminuer les préjugés et mettre en lumière les
solutions que l’on peut apporter à ce fléau si l’on s’y met tous. Car ces différents troubles, de
natures très différentes, nécessitent un accompagnement et des soins spécifiques et
individualisés, qui ne relèvent pas uniquement du champ médical mais aussi du secteur
social et de la société tout entière.
Le «tout-soin» ne suffit pas. On ne peut pas mettre tous les malades sous tutelle. Les
psychiatres comprennent de plus en plus qu’ils doivent se déposséder d’une partie de leur
pouvoir pour travailler en synergie avec les familles, les travailleurs sociaux, les malades.
Dans ce domaine, la France est à la traîne. Les pays anglo-saxons, le Canada, la Belgique,
l’Italie ont mis en place des réponses médico-sociales qui fonctionnent. L’avantage d’être les
derniers est qu’il ne nous reste plus qu’à appliquer ce qui marche. L’OMS en a fait une
priorité mondiale. Tout reste à faire.
Recueilli par Marie Auffret-Pericone
(1) La Fondation a été créée il y a tout juste un an sous l’égide de la Fondation Notre-Dame
afin d’élargir l’action de l’œuvre Falret, par son président Philippe Fabre-Falret. Son ancêtre,

le docteur Jean-Pierre Falret, psychiatre et aliéniste du XIXe, avait une vision humaine et
chrétienne du malade psychique, en qui il voyait «une personne, sujet de droits et de
devoirs, capable d’intelligence et de progrès qui a sa place dans le monde». Il a été le
premier à comprendre qu’on peut guérir de la maladie mentale, mais que l’avenir de la
personne dépend largement du suivi à la sortie de l’hôpital. L’œuvre Falret, créée il y a
173 ans, accompagne 3 000 personnes chaque année, en créant des lieux d’accueil et en
les guidant vers une réinsertion sociale et professionnelle.
1
/
5
100%