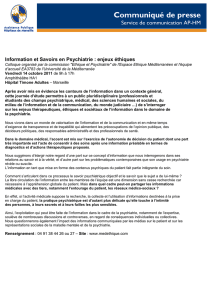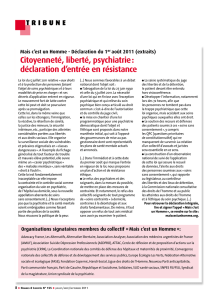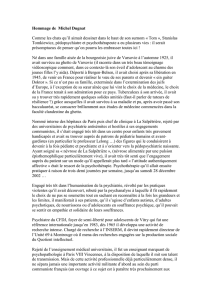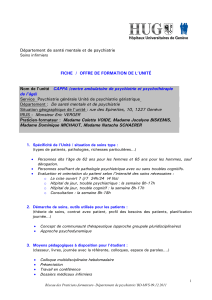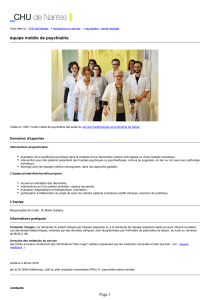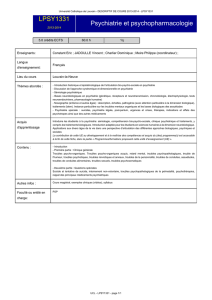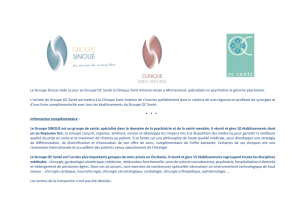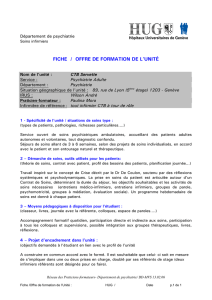HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE Ce bref exposé de l`histoire des

Docteur N.Monnier 1
HISTOIRE DE LA PSYCHIATRIE
Ce bref exposé de l'histoire des grands courants de la psychiatrie se propose de couvrir une
période allant de l'antiquité au début du XXI° siècle. Nous nous limiterons aux mouvements ayant
eu des répercussions sur les pratiques de soins actuelles. Nous ignorerons donc volontairement
ceux ayant peu d'impact en occident, les techniques n'ayant pas réellement laissé de traces et les
approches trop mystiques...
Par ailleurs, comme pour l'étude de tout écrit historique, nous devrons tenir compte de
différentes limites :
* La rareté voire l’absence de certaines sources particulièrement pour les périodes les plus
anciennes. Cette rareté peut être constitutive par absence d'écrit, contextuelle par perte des
textes ou délibérée par destruction ou remaniement de certains écrits. Nous pouvons par exemple
citer la disparition de nombreux textes des pré socratiques qui ne correspondaient pas à une vison
socrato-centrée de la culture catholique.
* La variabilité de la notion de médecine et de la différenciation médecine somatique
psychiatrie : Le lien entre le corps de l’esprit oscille entre les monistes et les dualistes
matérialistes.
* Le lien voire la confusion entre la médecine, surtout psychique, et la religion. La notion
même de soins ne se libère que tardivement de la religion et l'on propose des pèlerinages pour
guérir les fous jusqu'au XX° siècle. Enfin, la médecine, et surtout la psychiatrie, trouve souvent
écho dans la philosophie dominante et impose des concepts en accord avec les systèmes
philosophiques en vigueur.
* Les idées et événements anciens sont souvent évalués ou jugés avec une vision actuelle
et une théorie qui n'a plus court est souvent perçue comme mineure voire ridicule. Ainsi, la
phrénologie ou la méthode du Docteur Coué passent pour des idées farfelues, minorant du fait
leur importance contextuelle.
* Une idéalisation des méthodes non traditionnelles. Il est toujours difficile d'extrapoler
des techniques dans une population non comparable. La médecine française a par exemple
longtemps agi sur une population dont l’espérance de vie ne dépassait pas 30 ans et pour laquelle
les problèmes de santé majeurs étaient la dénutrition, la tuberculose et la syphilis....
ANTIQUITE GRECO-ROMAINE
La médecine antique grecque a longtemps mis en opposition une école recherchant la cause des
maladies (École dogmatique dont le plus célèbre représentant fut Hippocrate et sa théorie des
humeurs) et une école empirique se centrant sur l'expérience clinique. Il existait bien évidemment
de nombreuses autres approches dont l’école méthodiste (représenté par Asclupiade de Pruse)
qui se représentait le corps comme un assemblage de particule en mouvement.
Nous citerons pour mémoire les écrits du sophiste Antiphon d'Athènes qui soignait en interprétant
les rêves et pratiquait une thérapie des âmes fondée sur le discours.
Les romains ont poursuivi les mêmes voies de recherche avec par exemple la théorie des
tempéraments de Galien. La société romaine a par ailleurs théorisé un statut juridique pour
l'insensé, statut mêlant protection et répression.

Docteur N.Monnier 2
MOYEN AGE
La religion impose une nette séparation entre le corps et l'âme et la maladie mentale est
considérée au mieux comme une possession démoniaque au pire comme une hérésie. Les
malades se retrouvent parfois dans les hôtels-Dieu dans un but plus asilaire que thérapeutique.
Les soins se résument le plus souvent à des prières ou des pèlerinages.
RENAISSANCE
Marqués par le catholicisme, les médecins de la renaissance redécouvrent progressivement les
écrits grecs, le plus souvent transmis par les arabes.
Les guerres et l'urbanisation entraînent une nette augmentation du vagabondage avec un rejet
récurrent du fou. La vignette historique de la Nef des Fous immortalisée par Jérôme Bosch marque
cette exclusion d'une population gênante. A noter, en Espagne, le travail de Jean-De-Dieu,
fondateur de la confrérie hospitalière qui porte son nom et saint patron des infirmiers.
AGE CLASSIQUE
La période voit une multiplication des errants avec une nécessité pour les sociétés de faire face à
la misère urbaine. C'est l'époque du « grand enfermement » selon les termes de l'ouvrage de
Michel Foucault « Histoire de la folie à l'âge classique ». Cet ouvrage parle de la création des
hôpitaux généraux en 1656. Ces hôpitaux, premiers lieux réellement de soins, sont accusés d'être
des lieux d'enfermement pour les fous. En fait, les hôpitaux généraux n'ont jamais accueilli une
proportion importante d'insensés (moins de 10% des résidents).
Les fous étaient plus souvent pris en charge dans les maisons de force et surtout par les lettres de
cachet. Ces dernières, images de l'incarcération abusive aux dires des révolutionnaires, suivaient
une procédure assez stricte et étaient la plupart du temps à l'initiative des familles du malade.
Elles seront abolies par la révolution française qui les remplacera vite par une autre forme
d'enfermement.
Ces lieux d'hébergement sont aussi le premier pas d'un traitement social de la misère avec une
volonté de remettre dans la société les déments curables.
Même si les soins sont encore balbutiants et le plus souvent religieux, le XVIII° siècle voit
apparaître les premières démarches scientifiques de démembrement de la maladie mentale,
essentiellement en Angleterre : Sydenham (1624-1689), Cullen (1710-1790)...
REVOLUTION FRANCAISE
En 1793, s’inspirant des méthodes de travail de son infirmier Jean-Baptiste PUSSIN, Philippe Pinel
(1745-1826) « libère » les aliénés de leurs chaînes à Bicêtre puis à la Salpêtrière. Il théorisera la
prise en charge « humaniste » des patients dans son « Traité médico-philosophique sur l'aliénation
mentale » (1801).
Cet élan humaniste et scientifique sera le point de départ de la mise en place de la psychiatrie
moderne.

Docteur N.Monnier 3
XIX° SIECLE
Ce siècle verra l'apparition des différents aspects de la prise en charge des pathologies
psychiatriques :
Nosographique avec la grande tradition des aliénistes français : le délire chronique
d’interprétation de Sérieux et Capgras, la bouffée délirante aiguë par Magnan, la psychose
hallucinatoire chronique par Ballet, la folie maniaco-dépressive par Falret, la perversion et
dégénérescence par Morel.... Ces travaux se font en parallèle avec la découverte ou la
théorisation de maladies neurologiques : Charcot (1825-1893) et la sclérose latérale
amyotrophique, la sclérose en plaque..
Thérapeutique avec l'élaboration de nouvelles approches : Mesmer et son magnétisme
animal, Charcot et l'hypnose, Janet (1859-1947) et l'approche de l'inconscient qui préfigure
la psychanalyse...
Juridique avec, à l'initiative d'Esquirol (1772-1840), la loi de 1838 sur les hospitalisations
sous contrainte (qui restera en vigueur jusqu'en 1990) et l'irresponsabilité du dément
(article 64 du code pénal modifié en 1994).
XX° SIECLE
1) ISOLEMENT DE LA SCHIZOPHRENIE
Emil Kraepelin, en 1898, isole la notion de démence précoce des autres formes de démences.
Cette première véritable formalisation insiste sur le début « précoce », c’est-à-dire à
l’adolescence, et sur l’aspect déficitaire.
Eugen Bleuler, en 1911, conteste l’évolution systématiquement déficitaire, et introduit la
distinction entre signes primaires (dissociation, c’est-à-dire littéralement un trouble de
l’association), fondamentaux, et secondaires, liés aux modes de réaction de défense et
d’organisation de tel sujet avec l’atteinte primitive (autisme, perceptions délirantes).
Les aliénistes entre autres français fourniront de profondes analyses du syndrome dissociatif
(citons Henry Ey et le lyonnais Jean Guyotat).
2) LA PSYCHANALYSE
La psychanalyse s'est développée à la fin du XIXe siècle dans la continuité des travaux de Sigmud
Freud (1856-1939) véritable inventeur de cette nouvelle approche de la pathologie psychiatrique.
Fondateur reconnu de la psychanalyse, Freud s’est très vite entouré de disciples et collaborateurs.
Malgré la qualité souvent remarquable de ses « disciples », il y aura systématiquement des
ruptures souvent violentes avec Freud, limitant la notion d’école. Les théories développées par
Otto Rank , Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Georg Groddeck ouKaroly Ferenczy marquent souvent
des ruptures avec la théorie freudienne .
Les post-freudiens et les écoles étrangères développeront la diversité de la psychanalyse avec le
courant freudo-marxiste développé par Wilhelm Reich, la psychanalyse américaine avec Franz
Alexander et Bruno Bettelheim et la psychanalyse anglaise très riche (Mélanie Klein, Anna Freud,
Michael Balint, Wilfred Bion et Donald Winnicott).

Docteur N.Monnier 4
En France, la psychanalyse se développera plus tard à distance de la deuxième guerre mondiale :
les pionniers seront à l'origine de la création de la Société psychanalytique de Paris autour de
Marie Bonaparte (1882-1962). La psychanalyse française prendra un tournant spécifique avec
Jacques Lacan (1901-1981) qui introduit le signifiant et les trois catégories structurales que sont
l'Imaginaire, le Symbolique et le Réel.
3) LE COMPORTEMENTALO COGNITIVISME
L’approche comportementale en psychiatrie s’est développée dans les suites des travaux de
Pavlov dans les années 1930, surtout dans les pays anglo-saxons. La réflexologie et le
conditionnement ont leur importance en psychiatrie tant au niveau clinique que thérapeutique.
Sur le plan clinique, le comportementalisme permet de rendre compte d’une part importante de la
pathologie mentale comme pouvant s’inscrire comme un comportement adaptatif au stress
environnemental. Sur le plan thérapeutique, dans la suite des travaux de Watson, de Skinner
(1904-1990) ou de Wolpe, elle permet de développer des thérapies dites « comportementales »
telles que les méthodes de désensibilisation. Plus tard, Bandura introduit la notion de «
renforcements intérieurs » avec l’étude des croyances, des attentes et des pensées.
L’approche cognitiviste est en plein développement. Développée dans le sillage de la psychologie
comportementale, mais aussi de la psychologie sociale et de la phénoménologie, elle a été
décuplée dans son essor par l’informatique. Elle s’appuie sur l’affirmation que les processus de
pensée conscients ou inconscients peuvent faire l’objet d’une investigation scientifique et d’une
démarche expérimentale. Pour le cognitivisme, les informations, les représentations qu’elles
engendrent et les systèmes logiques qui en découlent, peuvent être modélisés. Le psychisme est
alors considéré comme un système fonctionnel qu’il est possible en thérapie de travailler en
s’appuyant notamment sur les croyances, les logiques intérieures comme les événements.
4) THÉRAPEUTIQUES
a) Pré neuroleptiques
Les méthodes de soins deviennent de plus en plus scientifiques à défaut d'être efficaces. Outre les
différentes techniques de choc (Choc au Cardiazol, Cure de Sakel à l'insuline, impaludation...) , la
psycho chirurgie aura une place de choix, bien que sombre. Mise au point pas le portugais Moniz
(prix Nobel de Médecine en 1949), la lobotomie a eu un succès considérable dans l'immédiate
après guerre. Quelques soins ont tout de même une efficacité et améliorent la pris en charge des
patients : électrochocs, barbituriques, enveloppement...
b) Les neuroleptiques
Au début des années 50, Jean Delay et Pierre Deniker, reprenant les travaux de l’anesthésiste
Henri Laborit, montrent l’efficacité du premier neuroleptique (la chlorpromazine) sur les signes
psychotiques. Les autres psychotropes suivront très rapidement : les antidépresseur IMAO en
1952, les antidépresseurs tricycliques en 1957, le lithium dans les années 1970; les
benzodiazépines dans les années 80.
A la fin des années 90, la découverte des neuroleptiques atypiques modifie la prise en charge des
malades grâce à des effets secondaires moins invalidants.

Docteur N.Monnier 5
4) LES APPROCHES SOCIALES
a) L'antipsychiatrie
Le courant antipsychiatrique, qui a émergé en Italie à la fin des années soixante, pose la folie
comme une réponse à l’exigence d’une société hiérarchisée, bureaucratique et mécanisée. Ainsi
les individus les plus fragiles n’ont pas d’autres solutions que d’être les victimes à enfermer dans
les asiles que la société a créés pour eux. La mise en application de la théorie (fermeture des
hôpitaux, arrêts de traitements…) n’a pas amené les améliorations de l’état de santé des patients
espérées. Cette approche est par contre à l’origine des structures de vie alternatives à
l’hospitalisation (foyer, ESAT…).
b) La psychothérapie institutionnelle, la sectorisation
Diverses expériences de soins institutionnels portées par Jean Oury à la clinique de la Borde ou
François Tosquelles à l’hôpital de Saint Alban sur Limagnolles entraînent une réflexion sur les rôles
de l'hôpital. Les années 60 amèneront, outre la diminution notoire du rôle du médecin dans les
soins, une désinstitutionalisation plus ou moins réussie des malades mentaux.
Le point d'orgue de ce mouvement sera la mise en place de la sectorisation psychiatrique. Le
secteur psychiatrique français, qui reste le modèle de l’intervention psychiatrique publique dans
notre pays, est né dans la continuité de la psychiatrie institutionnelle de l’après-guerre. Il s’agissait
bien pour la psychiatrie publique française de déplacer l’intervention des équipes spécialisées de
l’hôpital psychiatrique assimilé aux asiles vers des lieux de soin les plus proches du domicile du
patient afin d’éviter chronicisation et désocialisation.
L’idée novatrice est de rattacher à chaque service hospitalier une aire de recrutement et
d’intervention d’environ 70.000 habitants auxquels seront proposées des consultations
rapprochées dans des Centres Médico Psychologiques (CMP), véritables plaques tournantes de
l’action de soin en psychiatrie publique, mais aussi des interventions infirmières au domicile du
patient (les VAD, visites à domicile). Dans les suites de la circulaire ministérielle de 1960 créant les
secteurs de psychiatrie adulte et les intersecteurs de psychiatrie de l’enfant, tous les
départements seront progressivement découpés en secteurs et intersecteurs. Chaque secteur sera
confié à une équipe médicale et paramédicale prenant en charge toutes les pathologies
psychiatriques de sa zone géographique. Il devra en outre mettre en place des structures
diversifiées de prise en charge : hôpital à temps complet, hôpital de jour ou de nuit, CMP, CATTP
(centres d’accueil thérapeutique à temps partiel), sans parler des possibilités d’intervenir sur les
lieux de vie du patient à son domicile ou à proximité de son lieu de travail. Dans une perspective
d’accès égalitaire aux soins, le secteur devait avoir l’avantage de donner des soins d’égale qualité
quel que soit le lieu de vie du patient dans notre pays. La pénurie actuelle en temps médicaux de
psychiatres et d’infirmiers psychiatriques, très inégalitaire sur le territoire, remet en cause cette
orientation « sociale » de la psychiatrie française.
La conséquence de la sectorisation en France sera la diminution recherchée du nombre de lits en
hospitalisation à temps complet : on est passé de 170.000 lits de psychiatrie en 1970 à 58.000 en
2012 et la durée moyenne de séjour des patients est passée de plus de 250 jours en 1970 à moins
de 30 jours en 2012. Plus de 60% des malades suivis par la psychiatrie publique ne sont jamais
hospitalisés.
 6
6
1
/
6
100%