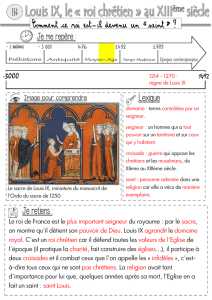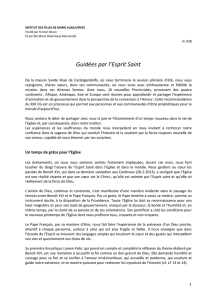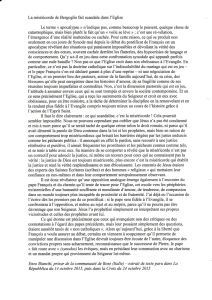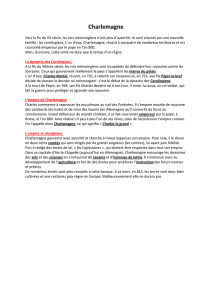1. LA FIN DU MONDE ANTIQUE ET LE PREMIER MOYEN AGE Qu

1. LA FIN DU MONDE ANTIQUE ET LE PREMIER MOYEN AGE
Qu’entendons-nous par Moyen Age?
On appelle Moyen Age une période intermédiaire entre l'Antiquité et la Renaissance. C'est à
cela que renvoie la signification de l'adjectif "moyen". Quant au terme "âge", il implique une certaine
unité de culture, par exemple pour ce qui est de l'outillage technique, comme lorsqu'on dit "âge du
bronze" ou “âge de la pierre”. Mais la période que nous allons étudier ne se caractérise pas par l'emploi
d'un matériel ou d'une certaine technologie. L'unité du Moyen Age n'est pas facile à trouver, car
chaque fois que nous établissons un critère, les limites temporelles vers lesquelles nous entraîne
l’emploi de ce critère vont soit au-delà, soit en-deçà de ce qu'on entend couramment par période
médiévale.
On veut souvent, dans la tradition marxiste, identifier le Moyen Age avec un type de relations
sociales, qui serait le féodalisme. Cependant le féodalisme ne se met progressivement en place qu'au
cours des Xe, XIe et XIIe siècles, et les relations de droit féodal continuent jusqu'en 1790. Les
théoriciens de la Révolution en sont pleinement conscients, et dénoncent le scandale des institutions
féodales au siècle des Lumières. Par conséquent le droit féodal, caractérisé par les relations d'homme à
homme et par le régime de possession des terres, commence en Europe tard après la fin de l'Antiquité
et dure longtemps après le début de l'époque moderne. D'autre part, des relations qui formellement
peuvent être caractérisées comme féodales ont existé aussi en Chine et au Japon. Si pourtant nous
essayons d'extrapoler l'idée d'une unité du Moyen Age à l'échelle du globe, nous nous heurterons à de
graves difficultés de logique.
Le Moyen Age est une époque pendant laquelle toutes les économies européennes sont
dépendantes de la production agricole, qui constitue l'essentiel du produit national. Mais cela est vrai
de l'Antiquité aussi. Sans parler du fait que, encore à la fin de la première Guerre mondiale, la majorité
de la population, dans tous les pays occidentaux, était formée de paysans. A noter aussi que l'industrie,
l'emploi des machines dans la production et même une certaine automatisation, ne sont pas étrangers à
la période médiévale. Sans connaître la théorie de la résistance des matériaux, les maîtres maçons
savent soulever d'immenses poids et la construction des cathédrales, ainsi que l'architecture militaire
(en particulier celle des Croisés en Terre Sainte) donnent une haute idée de leur ingéniosité.
La manière de se nourrir est au Moyen Age assez fruste dans l'ensemble, axée sur les viandes,
le gibier et le poisson chez les riches, fondée sur le pain et les légumes chez les pauvres, mais on
connaît déjà vers le XVe siècle de grands raffinements, qui nous sont conservés par exemple dans le

recueil de recettes de Salins. Le mobilier a peu de grâce plastique, cherchant la robustesse et la
durabilité. Les quelques meubles qui nous restent d’une époque suffisamment ancienne sont nettement
incommodes. Même à l’époque de la Renaissance, et dans le cas des écritoires sur lesquels on
travaillait une bonne partie de la journée, nous pouvons constater que le confort ergonomique est
totalement ignoré. Nous pouvons également dire que l’époque se caractérise par une forte polarisation
entre la vie quotidienne des riches et celle des pauvres, sans oublier que ce contraste était encore plus
marqué dans l’Antiquité. Ce qui donne au Moyen Age occidental une physionomie spécifique de ce
point de vue est la naissance, avec le XIIe siècle, d’une forte classe bourgeoise, et également les
progrès rapides qui ont lieu dans tous les domaines, à un rythme que l’humanité n’avait pas encore
connu jusqu’alors.
L'argent manque typiquement et il y a de grands désordres dans la levée des impôts. Cela veut
dire qu’on paie souvent en nature. Le travail est rude, mais en France on connaît la bonne chère dans
presque toutes les couches de la population, et aussi la disette au temps des mauvaises récoltes. La
main d’oeuvre est bon marché et les gens de service s’abandonnent entièrement aux mains de leurs
maîtres: la notion d’un salaire régulier n’est pas prise très sérieusement et l’employé se nourrit de ce
que son maître lui donne, il s’habille de ce que son maître lui achète. On juge les seigneurs d’après
l’habillement et l’embonpoint de leurs serviteurs. L'espérance de vie est en moyenne assez courte,
cependant on connaît des gens de la classe aisée qui ont vécu plus de 80 ans. La morbidité (l'incidence
des maladies), est élevée, avec une haute fréquence des maladies de la peau, dues probablement aux
textiles grossiers que portait la classe laborieuse, et à l'hygiène insatisfaisante. La lèpre et la peste sont
les fléaux de cette période. Mais les épidémies ne sont pas un mal spécifiquement médiéval. La
Renaissance a enregistré l'impact du syphilis, qui a régné jusqu'au XXe siècle, tandis que les deux
derniers siècles ont connu la terrible tuberculose qui ravageait les agglomérations ouvrières et qui
revient aujourd’hui en Europe de l’Est. Ceci pour dire que le plan de la vie quotidienne de la majeure
partie de la population n'a pas enregistré de très grands changements entre le XIIe et le XVIIIe siècles.
Ce qui change peut-être le plus, c’est le paysage urbain. Les villes médiévales sont des
agglomérations nouvelles, sans rapport avec la ville antique, et même là où la nouvelle ville se
construit près de l’emplacement d’une ancienne (Paris, Lyon), les vieux édifices ne sont jamais
restaurés et la trame urbaine est réinventée. Parfois la ville passe d’une rive à l’autre du cours d’eau sur
lequel elle est située. Les villes en bois, entourées de palissades, de l’époque mérovingienne et
carolingienne ont pour principales fonctions la collecte des impôts, l’administration de la justice, le
commerce et les métiers, la résidence de l’autorité civile et épiscopale. Le paysan vient à la ville pour
vendre ses poulets, pour acheter du drap et du sel, pour demander justice contre un voisin trop

envahissant et, pourquoi pas, afin de voir des choses nouvelles, participer à des fêtes et processions,
assister à l’entrée du comte ou du roi. Tandis que la ville élargit sa circonférence en se dotant chaque
fois de murailles plus longues, les édifices importants sont renouvelés sur le même terrain; une
nouvelle cathédrale se bâtit autour de l’ancienne, plus petite, qui demeure enclose à l’intérieur, et qui
sera démolie une fois le nouvel édifice achevé. Au mur de la cathédrale s’agglutine une foule de
constructions parasites, logis des ecclésiastiques, bâtiments administratifs, boutiques et autres
bicoques. Le tracé des rues principales, malgré leur étroitesse, demeure le même pendant de longs
siècles; ainsi à Toulouse l’actuelle rue du Taur, très ancienne, est censée relier la place du Taur où saint
Sernin (Saturninus), le premier évêque de la ville, a subi le martyre en 252, à la basilique Saint-Sernin
élevée sur son tombeau.
Le Moyen Age n'est pas une époque de monarchie absolue. Dire qu'il se caractérise par le
système monarchique serait méconnaître le spécifique des monarchies antiques et modernes. Tandis
que les mérovingiens pratiquent le partage du royaume entre leurs fils, chez les carolingiens l’idée d’un
territoire unique est beaucoup plus forte, à l’exemple de l’empire romain. Le déclin de la dynastie
carolingienne est marqué par un siècle de morcellement de l’autorité, où il y aura parfois deux rois en
même temps. Les rois capétiens de France, comme tous ceux de l'Occident, s'efforceront de centraliser
l'État, s'éloignant le plus possible du souvenir de l'anarchie qui régnait au Xe siècle. Pourtant une
véritable centralisation ne sera pas possible avant le XVIIe siècle. Le pouvoir des rois repose sur
l’importance symbolique de leur descendance royale, sur leur onction au cadre d'une cérémonie
religieuse, sur le consensus des féodaux et dans une certaine mesure sur les qualités personnelles des
détenteurs du titre, qui demeurent toujours des guerriers et des administrateurs. Ils ne peuvent pas
déchoir de leur qualité, même si d'autres personnes parviennent à gouverner effectivement à leur place.
Charles VI (1380-1422) était atteint de crises périodiques de folie furieuse, mais il a continué pendant
toute sa vie d'être le chef de l'État.
Un autre critère assez spécifique de périodisation de l’histoire européenne est le développement
de la religion. Le Moyen Age est une époque d'adhésion souvent très enthousiaste au christianisme en
Europe, et en même temps une époque de domination autoritaire de l'Eglise de Rome dans les
différents États occidentaux. Examinons la puissance de discrimination de ce critère.
Le christianisme se distingue en tant que religion, en se différenciant du judaïsme, dans les
diasporas juives, dans les villes grecques d'Asie Mineure, en Grèce et en Egypte, et aussi en Italie, à
partir de la seconde moitié du Ier siècle de notre ère. Les Évangiles sont écrits vers les années 70-90.
Mais cette nouvelle religion sera persécutée par les empereurs romains, car elle refusait de respecter la
pluralité des cultes, qui caractérisait l'État romain, et notamment rejetait le culte de l'empereur, seule

obligation religieuse officielle. La persécution cesse en 313, lorsque l'empereur Constantin, suivant le
conseil de sa mère Hélène, reconnaît la liberté des Églises chrétiennes. Ce ne sera que vers la fin du
siècle, sous Théodose, que le christianisme deviendra religion unique dans l'Empire et que les adeptes
attardés du polythéisme feront l'objet de poursuites. Mais déjà l'Empire est sur son déclin et Théodose
le partage entre ses deux fils: désormais on aura en Europe un Orient et un Occident.
Au siècle suivant l'Empire d'Occident s'effondre sous les poussées barbares et le dernier
empereur (qui est le fils d'un ancien secrétaire du roi hun Attila) abdique en 476. L'Empire Romain
d'Orient (dit byzantin) demeure puissant et le restera, contre vents et marées, jusqu'au XIIIe siècle,
après quoi s’ensuivra une longue et douloureuse agonie. L'Église catholique parvient à sortir indemne
de ces épreuves, car les rois barbares d'Occident sont chrétiens. Certes, ils adoptent d'abord l'hérésie
arienne, mais ils finissent par accepter la foi apostolique et romaine. Celle-ci n'est bientôt plus la même
que la foi de Byzance: au VIe siècle, en Espagne, on élabore une adjonction au Crédo, le fameux
Filioque
1
, qui sera adopté par toutes les communautés occidentales: désormais le schisme des deux
Églises est devenu possible; il éclatera dans un épisode transitoire au IXe siècle avec le patriarche
Photius, mais l’état de rupture ne s’installera officiellement qu’en 1054. L’Eglise orthodoxe, mise sous
l’autorité du pape dans les Etats latins d’Orient, sera paradoxalement sauvée par les Turcs, qui vont
subordonner après 1453 tous les chrétiens de leurs sandjaks au pouvoir du patriarche de
Constantinople, afin de simplifier le gouvernement de l’Empire.
Par conséquent, en parlant de Moyen Age, nous devrions nous limiter aux repères
chronologiques de l'Occident. C'est là un sacrifice théorique important et tous les spécialistes ne sont
pas d'accord à le faire. Cependant poursuivons l’évaluation du critère religieux quand il s’agit de
décrire ce que nous entendons par Moyen Age. La religion chrétienne passe par différentes crises
d'identité et finit par se cristalliser sous une forme extrêmement élaborée dans les universités
médiévales, à Paris surtout, dans le cadre du mouvement de pensée que l'on appelle la scolastique.
La scolastique est l’application de l’héritage philosophique de l’Antiquité à la théologie
chrétienne. Cette application, dans son principe, date en fait de l’Antiquité, avec trois moments forts,
saint Paul, l’auteur des Epîtres, au Ier siècle, les saints théologiens dits “Cappadociens” (Grégoire de
Nysse, Grégoire de Nazianze et Basile le Grand), au IVe siècle, et saint Augustin, auteur des
1
Selon les orthodoxes, l'Esprit-Saint procéde seulement du Pére. Le Pére est en relation
d'origine et avec son Fils, et avec le Saint Esprit. C'est come si le souffle de Dieu le
Pére prenait deux formes, le Fils et l'Esprit. Selon les catholiques, l'Esprit-Saint
procéde du Pére et du Fils (en latin Filioque), ce qui veut dire que le Pére et le Fils
respirent en une unité et leur souffle commun est l'Esprit. Dans les deux théories de la
Trinité, la relation entre les trois hypostases (Grecs) ou personnes (Latins) de Dieu est
une relation d'amour; mais ce consensus n'a pas beaucoup aidé à la réunification
doctrinaire du christianisme.

Confessions et de La Cité de Dieu. Mais la scolastique au sens propre s’impose au début du XIIe
siècle, avec Abélard. Le christianisme n’est pas une religion qui consiste seulement en une liturgie
(cérémonie du sacrifice) et en un ensemble d’expériences intérieures, mais il comporte aussi une
explication systématique du monde et de la pensée, qui au Moyen Age doit encore être considérée
comme philosophique, voire scientifique. Ce caractère théorique atteint à son apogée dans la
scolastique, mouvement qui a lieu dans les universités et qui fonde la pensée moderne, quitte à se faire
rejeter plus tard par celle-ci. Il faut dire que le christianisme, du point de vue philosophique, est
redevable à Platon et à Aristote. C'est l'héritage de Platon, par l'intermédiaire du néoplatonisant
anonyme connu sous l’appellatif de Pseudo-Denys l'Aréopagite (début du VIe siècle), qui s'impose
d'abord, en prêtant son lexique à la solution de certains problèmes de théologie. Mais dès la fin du XIIe
siècle, et en grande mesure grâce aux acquis de la falsafa
2
arabe, Aristote devient un personnage de
premier plan dans la pensée des théologiens occidentaux. L'histoire de la scolastique commence par la
simple redécouverte, avec Anselme de Cantorbéry, de la logique, de la dialectique et de la pensée
réflexive. Elle s'épanouit dans l'aristotélisme médiéval. Lorsque le pape Léon XIII a voulu définir
l’identité de la pensée chrétienne, dans l’encyclique Æterni Patris de 1879, il a choisi saint d'Aquin,
un grand aristotélisant du XIIIe siècle, comme exposant de la plus pure religion catholique. Quoique
Thomas d’Aquin ait été traduit en grec au XIVe siècle, l’ensemble de la scolastique a toujours été
perçu avec méfiance par l’Eglise de Byzance.
Le pouvoir temporel de l’Église a souvent été ressenti comme une incongruité par rapport aux
enseignements de Jésus. Pendant tout le Moyen Age, l'Église est contestée, surtout dans ses prétentions
de souveraineté mondaine. Le temps vient où sa théologie même est mise en question. La contestation
radicale des formes extérieures du christianisme telles qu'on les pratiquait jusqu'alors donne naissance
à la Réforme, qui n'est pas une forme d'athéisme ou d'incroyance, mais une nouvelle manière de lire les
Évangiles, se prétendant plus proche de la foi antique. Le signal international de ce mouvement est la
publication, en 1517, des 95 thèses de Luther, clouées sur la porte de la chapelle de Wittenberg, en
Allemagne. Martin Luther est un moine allemand, brillant docteur en théologie. Il ressent le besoin de
dénoncer ouvertement l’immoralité qu’il y avait à vendre des indulgences pour les péchés; en effet,
pressé par des besoins financiers, le pape Léon X cherchait dans cette pratique l’argent nécessaire pour
financer ses immenses dépenses, ainsi que les grands ouvrages d’art commandés à Michel-Ange, à
2
Falsafa est un mot arabe qui vient du grec philosophia. Un faylasuf (philosophe)
est une théologien musulman qui s'efforce de penser sa religion à l'aide des concepts de la
philosophie grecque, qui était à l'époque l'instrument de pensée le plus puissant. Ce
courant "moderniste" a été condamné par la plupart des théologiens de l'Islam et a dû être
abandonné dès le Moyen Age, non sans avoir profité des contributions capitales d'Avicenne
(Ibn Sinna) et d’Averroës (Ibn Roshd).
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
1
/
44
100%