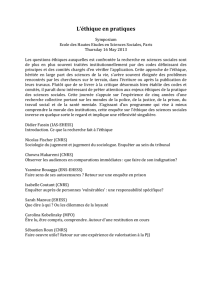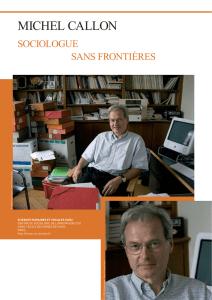Raymond Aron le disait déjà : « Une thèse parfaite, c`est tout sur rien

Raymond Aron le disait déjà : « Une thèse parfaite, c’est tout sur rien ». Il visait ainsi
la « grande thèse » traditionnelle, Le vieil esprit universitaire demeure, néanmoins :
on attend des chercheurs un travail exhaustif sur un sujet limité.
Isoler totalement un objet d’étude est artificiel/ fLes sciences physiques ont
progressé, depuis le XVII° siècle, en isolant des corps ou des objets de leur milieu,
en coupant les liens pour créer des unités « artificielles », sur lesquelles
expérimenter . On a cru, par la suite, que cela pouvait se transposer dans les
sciences humaines. Mais celles-ci sont, en quelque sorte, du vivant. Et l’on sait que
le vivant – même pour les biologistes – est un tissu d’interactions.
Depuis longtemps, je pousse aux travaux plus ouverts, plus risqués. Une bonne
thèse, c’est celle où vous vous lancez à fond dans la recherche et l’organisation de
vos propres idées. Dans notre culture, où les modes de connaissance sont
fragmentés, spécialisés, il faut encourager ceux qui se posent des questions
globales et interdisciplinaires. Avec les PUF et Le Monde, nous favorisons cette prise
de risque. Que le chercheur, quel que soit son domaine – sociologie, esthétique,
histoire, littérature, etc. – n’hésite pas à viser des problèmes fondamentaux dans des
questions contemporaines.
On retrouve votre souci de la « complexité
Le sens banal du mot compléxité, c’est ce qui n peut être’ conçu de façon
simplee,claire, issolable ». Quand on dit « c’est complexe « on exprime son
incapacité de décrire ou expliquer. La compléxité c’est un défi à la connaissance. La
conbnaaissance complexe veur relever ce défi... Avec « Partage du savoir » nous
affrontons le complexus au sens latin du terme : « ce qui est tissé ensemble », mot
qui vient du verbe complecti, « embrasser, comprendre ». Vouloir affronter laa
compléxité, c’est vouloir comprendre, .
On parle souvent, toutefois, d’un reflux des sciences sociales, et plus
largement des sciences humaines. Une perte d’influence continue depuis les
années 1980. Du moins, dans le grand public.
Je pense qu’il y a eu méprise. Dès avant la Deuxième Guerre, on a projeté sur les
sciences humaines et sociales un certain rêve scientiste : on cru qu’on atteignait à

l’objectivité à partir de questionnaires, on a cherché les détereminssmes sociaux, On
y a introduit lee morcellemen t dissciplinaire.. On a isolé la sociologie de l’histoire, de
l’économiee, de la philosophie, de la psychologie. On a cru à la posssibilité dune
scientificité intégrale alors que laa scientificité des sciences humines n epeut qu’être
partieelle Les grands sociologues – notamment Raymond Aron et Georges
Friedmann, par exemple – on t en fait écrit des « essais» avec leur reflexion
pmersonneelle,
Puis il y eut 1968, en France et dans le monde, qui fut une crise radicale de la
sociologie : elle n’avait, dans l’ensemble, rien vu venir ! Du coup, s’ensuivirent les
Cent fleurs, comme l’eût dit Mao. Tout est parti dans tous les sens, ce qui fut une
bonne chose. Mais, le rêve scientiste n’étant pas mort, on a voulu croire que la
sociologie et, plus largement les sciences humaines, nous éclaireraient sur le devenir
de nos sociétés, sur nos comportements. Elles seraient prédictives.
Cette attente a été porté paar une ultime montée d’un marxisme bien dogmaatique,
qui s’est délité au terme des années 1970 quand les illusions soviétiques, chinoises
et autres se sont affaissées. Depuis, je ne pense pas que les sciences humaines
soient en crise – elle sont au contraire plus ouvertes – mais on ne croit plus en elle
comme dans une science totalement rigoureuse et vraiment prédictive. La crise
concerne ce besoin de croire qu’il puisse y avoir des « sciences » humaines sur le
modèlee des sciences physiques du passé .
La fin des années 1970 correspond à vos premières synthèses sur La Méthode.
En 1977 sort le tome I : La Nature de la nature.
La Méthode, est une réflexion sur la connaissance,Le titre d’un des volumes « la
connaissance de la connaissance »pourrait êtrer le titre général. J’ai toujours été un
peu en dehors de la sociologie proprement dite. Je n ai cessé de recourir à l’histoire,
à la philosophie, aux réflexions sur les sciences. Mes derniers travaux sociologiques
ont été La Rumeur d’Orléans (1969) et un projet d’ enquête à Fos-sur-Mer, sans
doute l’ultime projection par l’Etat d’un volontarisme abstrait sur une donnée
concrète. Depuis, je me suis concentrré sur le problème de la complexité, que l’on
rencontre non seulement dans les sciences mis dans toutres connaissances. Cela
dit, mon premier grand travail : L’Homme et la mort, en 1951, portait déjà en lui ce
besoin d’aborder une question sous des angles multiples : biologie, religion,

psychologie, etc. et d’organiser lkes connaissances les plus diverses. Je me suis
affronté à deux paradoxes : comment se fait il que l’homme qui est le seul animal qui
se sache consciemment mortel, est le seul qui croit en une vie après la mort ;
comment se fait il qu’il ait horreur de laa mort et soit capaable pourtant de risquer sa
vie pour une cause ou pour son honneur.. La compléxité, elle est aussi dans ces
paradoxes/
La recherche aujourd’hui est de nouveau en crise, notamment le CNRS où
vous avez fait l’essentiel de votre carrière.
Je n’aurais pas pu me consacrer à mes recherches si j’avais été universitaire. J’ai
trouvé la liberté » au CNRS bien quee et parce que j’étais marginal et déviant, La
machine est toutefois devenue si lourde qu’elle contribue à rétablir ou exagérer ce
cloisonnement. Le statut de fonctionnaire, généralisé par Jean-Pierre Chevènement,
a bien sûr accentué une certaine propension aux routines - mais cela ne doit pas
cacher la liberté que les chercheurs peuvent y trouver, et la fécondité de nombreux
travaux.
On parle aussi beaucoup du système américain, sans toujours le connaître qu’il
serve de modèle ou de repoussoir. J’ai travaillé aux Etats-Unis. J’ai pu en voir les
avantages et les inconvénients. Le statut des chercheurs y est précaire, il dépend de
leurs résultats et joue sur une concurrence : aucun contrat n’est définitif, on est
toujours remis en cause. Du coup, les chercheurs produisent beaucoup, parfois trop,
avec beaucoup de déchet. Et la routine, comme partout, arrive à trouver ses niches !
En revanche, les méthodes d’évaluation sont plus souples et plus diversifiées.
On retrouve donc finalement toujours le même problème : la persistance, en France,
d’un système mandarinal et d’une tendance bureaucratique à cloisonner. On peut
toujours, on doit toujours, réadapter des structures – le CNRS en est une,
particulièrement lourde – mais le véritable verrou n’est pas là. Le verrou, c’est le
mode d’évaluation mono-disciplinaire, le maintien d’une conception rigide et
cloissonnée de la connaissance. Le CNRS, d’une certaine manière, s’est mis peu à
peu à ressembler au système universitaire. Il faudrait évaluer les évaluateurs. Il
faudrait réformer les mentalités ce qui est le plus difficile. Depuis la loi Edgar Faure,
qui suivit 1968, jusqu’à maintenant, toutes les réformes universitaires – CNRS inclus
– ont échoué parce qu’on ne se pose pas le problème de la connaissance. Le

problème clé, pour moi, est qu’il faut réformer la « façon de penser ». D’où la
modeste contribution qu’entend apporter « Partage du savoir » au décloisonnement.
Toujours la « méthode », donc.
Quand j’ai publié Le Paradigme perdu, en 1973, j’avais 52 ans. Près de trente
années de travaux se trouvaient déjà derrière moi. Ce fut un tournant. Très vite je me
suis mis à La Méthode dont les cinq volumes se sont échelonnés de 1977 à 2001.
Comme je n’ai malheureusement pas rajeuni entre temps, je me suis posé un certain
nombre de questions qu’on n’ose pas toujours traiter quand on est jeune ou dans la
force de l’âge, faute de recul. Et mon ultimee livre, dont laa redazction est en cours
s’intitulera «’éthique complexe ».
Depuis 1998, je reviens à des idées relatives à l’éthique, ébauchées ou partiellement
développées un peu partout dans mes travaux. Je me risque ainsi à la « morale » -
mais dans l’optique de Pascal, pour qui la conduite morale a besoin d’êtrre éclairée
pâr le « bien penser »,
Je traite ainsi, au départ, de ce que je nomme une écologie de l’action. pour montrer
que les bonnes intentions nee suffisent paas. Votre action vous échappe parce
qu’elle se mêle au milieu ambiant et peut se retourner contre l’intention de départ.
C’est bien connu en économie (Fos-sur-Mer, par exemple), en politique (la
dissolution opérée par Chiraéc qui porta Jospin au gouvernement, etc.. ), dans nos
relations affectives, etc. Quand il s’agit d’éthique, cela devient particulièrement
délicat : les résultats de l’action contrarient souvent la beauté des intentions .Un
principe d’incertitude demeure.
La difficulté ne réside pas dans la définition du Bien et du Mal – nous y sommes
familiarisés depuis des millénaires. La difficulté c’est l’affrontement simultané
d’impératifs contraires. Aujourd’hui, l’impératif hippocratique (priorité absolue à la vie)
se heurte par exemple au statut des « morts vivants ». Et pas dans le seul cas de
l’euthanasie. Parfois, un « mort vivant » peut devenir une réserve d’organes qui,
greffés, sauvent la vie d’autrui. De même, l’interruption volontaire de grossesse
reste-t-elle un conflit moral, même si la loi semble évidemment une bonne chose : il y
a le droit de la femme, le droit de l’embryon et le droit de la société. Nous avons
privilégié le droit de la femme, mais cela ne résout pas l’ensemble du conflit – pas

plus que ne le résoudrait un primat de l’embryon ou de la société. Je veux dire par là
que, dans tous les domaines, le choix éthique est souvent un compromis provisoire.
Tout serait relatif ?
Non, tout est relationné. Il faut tenir compte du contexte, il faut tenir compte de
questions indécidables : à quel moment est on humain ? A la formation de l’œuf ?
Quand le cœur de l’embryon se met à battre ? Quand il sort du ventre de sa mère ?
Ce qui n’est pas relatif c’est le principe morale énoncé par Kant « fais en sorte de
considérer autrui comme fin, et pas seulement comme moyen ». Mais ce qui est
incertain c’est le résultat : Faust aime Marguerite, il veut son bonheur, mais tout ce
qu’il fait concourt à son malheur. Il ne suffit pas de vouloir le bien d’autrui. Comme
tout ce qui est humain, la morale est une aventure incertaine.
Propos recueillis par Jean-Maurice de Montremy
1
/
5
100%