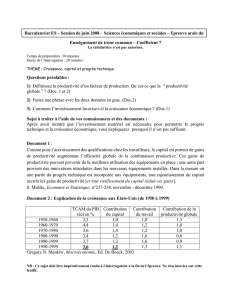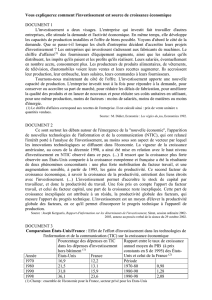planchap1

1
THEME 1 : CROISSANCE, CAPITAL ET PROGRES TECHNIQUE
CHAPITRE 1 : Sources et limites de la croissance
Dictionnaire Hatier « Croissance », p.115 à relire
I. LES SOURCES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
1. La croissance, résultat de la combinaison des facteurs de production et du progrès technique.
Prérequis : facteurs de production, combinaison productive ; productivité :
A lire à la maison Dictionnaire Hatier « Productivité », p.363 + réaliser les questions de la fiche
photocopiée
Objectif : étudier la contribution des facteurs de production à la croissance
Doc.2, p.26+ schéma de l’exercice p.27
A. La croissance peut provenir d’une main d’œuvre plus nombreuse et/ou plus productive
B. L’augmentation de la productivité peut provenir de la division du travail
Nous allons détailler cet aspect dans le chapitre 3
C. Mais elle vient aussi de l’accumulation du capital et du progrès technique
Doc.7, p.29
Doc.18, p.33
Nous allons détailler cet aspect dans le chapitre 2
2. Le rôle des agents économiques dans le processus de croissance
A. Le rôle de l’entrepreneur : améliorer la combinaison productive, investir, assurer les
dépenses de recherche-développement
Doc.12, p.31
B. Le rôle de l’Etat et des institutions : réguler les marchés, gérer les externalités, développer
les infrastructures à travers la politique économique
Doc.16, p.32
C. Le rôle de l’environnement socio-culturel : les valeurs
II. LES LIMITES DE LA CROISSANCE ECONOMIQUE
Schéma + Texte à trous photocopiés : le PIB, un indicateur contesté
1. Peut-on poursuivre indéfiniment le processus actuel de croissance ?
Doc.21, p.34
2 Accroître toujours plus le P.I.B., cela a-t-il toujours du sens ?
Doc.25, p.36

2
La croissance, résultat de la combinaison des facteurs de production et du progrès technique
Pré-requis : revoir chapitre « Représentation du fonctionnement de l’économie » vu en classe entière +
la productivité vue en ½ groupe
1. Définir les facteurs de production
A) Compléter le schéma suivant avec les termes : capital circulant ; capital technique ; travail, capital
fixe et donner un exemple pour chacun des 4 termes
B) Compléter le texte à trous suivants avec les termes : combinaison productive ; travail ; facteurs de
production ;capital
Pour produire, on a besoin d’utiliser du……………………et du ……………………………. Ces deux
éléments se nomment des……………………………………………………………………………………...….
ils sont associés dans la …………………………………………………………………………………………..
que met en oeuvre toute entreprise pour produire.
2. Savoir calculer une productivité
A) Mesurer la productivité du travail en termes physiques.
On souhaite comparer la productivité du travail de deux entreprises textiles, implantées dans deux pays
différents A et B,
Entreprise A
Entreprise B
Nombre de travailleurs
Production de tissu en une semaine
200
82 000 mètres
300
117 000 mètres
Productivité par tête =
____________________
Durée hebdomadaire du travail
Nombre d’heures travaillées par
semaine dans l’entreprise
41 h
39 h
Productivité horaire=
____________________
Compléter le tableau suivant et dégager une conclusion mettant en valeur l’information apportée par les
calculs concernant la comparaison de productivité des deux entreprises
B) Mesurer la productivité du travail en termes monétaires ou en valeur
On suppose qu’un mètre de tissu est vendu 7 euros par les deux entreprises. L’entreprise A achète les
fibres synthétiques nécessaires à la fabrication de tissu à une autre entreprise tandis que l’entreprise B les
produit elle-même.
Entreprise A
Entreprise B
Production vendue (en euros)
Consommations intermédiaires (en
euros)
Valeur ajoutée
246 000
234 000
Nombre d’heures travaillées
8 200
11 700
Productivité horaire =
Production .
Nombre d’heures travaillées
Productivité horaire =
Valeur ajoutée .
Nombre d’heures travaillées
Compléter le tableau suivant et dégager une conclusion mettant en valeur l’information apportée par les
calculs concernant la comparaison de productivité des deux entreprises

3
3. Mettre en évidence les causes et les conséquences des gains de productivité
Document 1
Depuis la Révolution industrielle, la productivité du travail s’est accrue dans tous les pays développés,
pratiquement dans tous les secteurs et sans interruption.
Cette croissance provient de deux séries de facteurs dont les effets se conjuguent: d’une part le recours croissant
à des équipements — outils, machines, automatismes — qui multiplient toujours plus les potentialités du travail
humain, d’autre part des transformations dans l’organisation des entreprises qui ont permis la mise en oeuvre des
équipements, mais aussi ont conduit à intensifier le travail.
Avec la croissance de la production, d’autres gains de productivité ont résulté d’économies d’échelle et du recours
à des équipements plus efficaces. La spécialisation de la production a accentué le phénomène.
Ces évolutions n’auraient pas été possibles sans les progrès de l’éducation et de la formation de la main-d’oeuvre.
Et surtout, après la seconde guerre mondiale, par une meilleure organisation du travail, non seulement dans les
activités de fabrication mais aussi dans celles de conception et de gestion.
D. Teman, « La productivité », Alternatives économiques, n°123, janvier 1995.
Document 2
À l’inverse de ce que l’expérience individuelle semble prouver avec évidence, les progrès de la productivité ne
suppriment pas d’emplois. Les économistes d’Alfred Sauvy à Jean Fourastié ont expliqué que les gains de
productivité créent autant d’emplois qu’ils en suppriment (mécanisme du « déversement »).
Les gains de productivité réalisés dans une entreprise peuvent se répartir de différentes façons : ils peuvent
bénéficier aux salariés sous la forme d’un accroissement des salaires, d’une réduction du temps de travail, ou
encore des deux. Ils peuvent aussi bénéficier à l’entreprise qui augmente sa marge, grâce à la diminution des
coûts salariaux. L’entreprise peut alors soit accroître ses investissements, soit distribuer des revenus
supplémentaires à ses actionnaires. Enfin les gains de productivité peuvent se traduire par une baisse des prix qui
profite aux consommateurs. Cette redistribution de revenu se traduit par une croissance de la demande qui se
répercute sur la demande de travail et vient compenser, au niveau global, la perte engendrée par le gain de
productivité. Ce phénomène peut se faire de multiples façons. Si les gains de productivité sont distribués aux
salariés, c’est l’accroissement de leurs dépenses de consommation ou d’investissement (dans le logement) qui
tirera la demande. Même chose si les revenus sont distribués aux actionnaires. Si les entreprises en profitent pour
accroître leurs investissements, c’est la demande de biens d’équipement qui en profitera. Si enfin, l’entreprise
baisse ses prix, le bénéfice en revient à l’ensemble des consommateurs qui, à revenu égal, peuvent choisir de
consommer plus du bien offert, soit de transférer le pouvoir d’achat ainsi dégagé vers d’autres biens et services,
concourant ainsi à la montée de la demande.
Au total, les gains de productivité sont donc pour chaque entreprise la condition du maintien de sa compétitivité et,
au niveau macro-économique, la condition d’une hausse du niveau de vie et d’une réduction du temps consacré au
travail. P. Frémeaux, « Productivité et emploi », Alternatives économiques, n’°123, janvier 1995.
Document 3
«Porsche a beau envisagé un bénéfice imposable record cette année, plus d’un milliard d’euros, cela ne l’empêche
pas de vouloir supprimer des emplois. [...] “Les postes qui se libèrent dans la production ne seront pas pourvus,
car nous avons énormément amélioré notre productivité” indique le patron de Porsche.
« Porsche supprime lui aussi des emplois malgré des profits record », l’Expansion, 20.10.2004)

4
Document 4
Les gains de productivité ne disparaissent pas dans la nature. D’une manière ou d’une autre, ils contribuent à
réduire les prix de vente, à augmenter les salaires ou les revenus des propriétaires du capital, alimentant ce
qu’Alfred Sauvy appelait le « déversement ». Les ouvriers spécialisés (OS) de l’automobile ont perdu leur place,
remplacés par des robots, mais les techniciens de Renault, mieux payés, sont partis aux sports d’hiver et ont
contribué à créer des emplois dans les stations de ski [...].
Les prix des produits manufacturés ont sensiblement baissé grâce aux gains de productivité : avec son revenu
annuel, un salarié du bas de l’échelle peut aujourd’hui acheter une voiture de type Clio, alors qu’il y a un siècle, il
pouvait tout juste acheter une bicyclette. Et cela a considérablement gonflé la demande. En outre, les innovations
n’ont cessé d’aboutir à de nouveaux objets, dont beaucoup ont tiré la consommation et changé en profondeur
notre mode de vie. D.Clerc, Alternatives économiques, hors série n° 71, 1er trim. 2007
A) expliquez les expressions en italiques des documents 1 et 2 : économies d’échelle, marge,
compétitivité
B) Expliquez la logique de la phrase soulignée dans le document 3
C) Soulignez en rouge les différents facteurs (ou causes) d’accroissement de la productivité et en vert les
différents bénéficiaires des gains de productivité
D) Quels sont les effets des gains de productivité sur :
- la demande
- les emplois
E) Complétez le schéma ci-dessous à l’aide des informations recueillies dans les 4 documents
Nous allons détailler l’impact de la productivité sur l’emploi dans le chapitre 4

5
SCHEMA : le PIB, un indicateur contesté
Le PIB a plusieurs défauts qui amoindrissent sa capacité à rendre compte de la richesse matérielle d’un pays ;
Ainsi, il ne comprend pas :
• les activités dites improductives (mère au foyer) et le bénévolat : le PIB ne compte que les activités qui sont
………………...
• l’économie ……………………… ou informelle : toute une partie de l’activité économique n’est pas déclarée à
l’Etat et donc pas comptabilisée (travail au noir ou activités illicites, comme la vente de drogues, d’armes …).
Le PIB ne prend pas en considération certaines ……………………… telles que les effets de la pollution …
Le PIB ne tient pas compte non plus de la réalité de la vie et des ………………………………….. (comme la
prise en charge gratuite des enfants et des personnes âgées par l’entourage).
Le PIB prend mal en compte la …………………. des biens et services fournis à la population.
Enfin, pour effectuer des comparaisons, il faudrait tenir compte du ……………………………………….. de
chaque pays. Les niveaux de vie étant parfois très différents d’un pays à l’autre, l’évolution des taux de change
entre pays peut entraîner une variation du PIB sans raisons réelles.
Lorsque l’on considère le PIB par habitant, on se rend compte que celui-ci n’est qu’une …………… qui
dissimule les très grandes ……………………………..de répartition au sein de la population étudiée.
La croissance est donc avant tout une étude de l’aspect ……………………….. de la production à long terme et
le PIB est un indicateur exclusivement économique qui ne parvient pas à prendre en considération le mode de vie
de la population, ses conditions de travail, ses qualifications, sa protection sociale … d’où la nécessité de
s’intéresser au ……………………………… qui résulte de la transformation des structures qui accompagnent la
croissance, d’où la nécessité d’étudier l’aspect ……………………….. de la production à long terme.
pouvoir d’achat ; qualité ; quantitatif ; qualitatif ; externalités ; inégalités ; rémunérées ; relations humaines ;
souterraine ; moyenne ; développement
1
/
5
100%