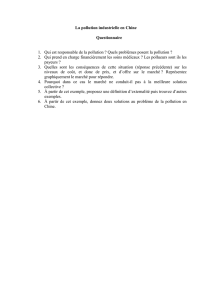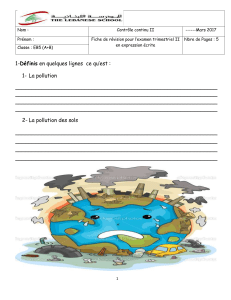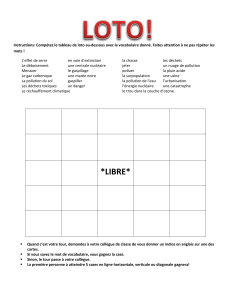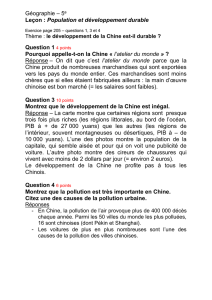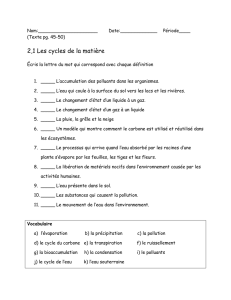Documents sujets de révision

1
Documents sujets de révision
Quelles alternatives au PIB/hab pour mesurer le bien être ?
Sur internet :
A consulter le site de France Stratégie (l’ancien Commissariat au Plan) :
http://www.strategie.gouv.fr/publications/synthese-consultations-dela-pib-un-tableau-de-bord-france
Les travaux de France Stratégie prolonge le Rapport Stiglitz, Sen et Fitoussi. Beaucoup de docs, mais long.
A télécharger sur le site de l’Insee :
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/default.asp?page=dossiers_web/stiglitz/documents-
commission.htm
Il y aussi ce texte de J.M.Harribey :
http://alternatives-economiques.fr/blogs/harribey/2015/10/13/un-indicateur-trompeur-peut-en-cacher-
und%E2%80%99-autres/
Les trois premiers chapitres sont intéressants (des indicateurs complémentaires ; des informations déjà
connues ; le pib, un faux problème), après ça se complique !
Utile pour éviter de dire des bêtises, du style : le PIB ne tient pas compte des activités non marchandes …
Référence biblio : Claudia Senik « L’économie du bonheur », La république des idées
Document 1
Document 2
Source : Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, p.75
Document 3 : la mesure du bien-être
Le fait que dans certains pays (tels que les États- Unis) le PIB soit revenu au niveau d'avant la crise ne rend
compte en aucune manière de la perte de bien-être qui a résulté de celle-ci. Avec près d'un Américain sur six

2
exclu de l’emploi à temps plein – le reste étant confronté à l’angoisse de perdre sa maison ou son salaire – et
les coupes sombres annoncées dans les dépenses publiques et sociales de base, la perte de bien-être est en
réalité considérable. La situation en Espagne est encore pire, avec un taux de chômage supérieur à 20 % en
moyenne et presque un jeune sur deux privé d’emploi. Les événements tragiques survenus au Japon cette
année peuvent être considérés comme une métaphore de nos problèmes de mesure. Certains suggèrent que,
bien que dans le court terme le PIB japonais décline, dans le long terme, il se relèvera suite aux efforts de
reconstruction du pays. La catastrophe nucléaire a non seulement angoissé la population, mais elle pourrait
bien avoir des effets significatifs sur la santé d’un grand nombre de Japonais. Là aussi, les dépenses
nécessaires pour répondre à cette menace pour- raient augmenter le PIB, peut-être même assez pour sortir le
Japon de sa lancinante langueur économique. Mais nul ne prétendra que le Japon est en meilleur état après la
catastrophe de Fukushima. Il faudrait une énorme augmentation du PIB pour compenser la destruction de
capital, de tous les types d'actifs, que l'événement a causée, et pour atténuer l’angoisse face à l’avenir que
tant de Japonais ressentent. Or nous ne sommes pas bien équipés – nos indicateurs ne sont pas correctement
adaptés – pour mesurer la valeur des actifs perdus ou détruits.
Source : Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz, Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011), p.
312-313
Document 4 : les indicateurs de bien être courant et futur
Un autre message clef, en même temps qu’un thème unificateur du rapport, est qu’il est temps que notre
système statistique mette davantage l’accent sur la mesure du bien-être de la population que sur celle de la
production économique, et qu’il convient de surcroît que ces mesures du bien-être soient resituées dans un
contexte de soutenabilité. En dépit des déficiences de nos outils de mesure de la production, nous en savons
davantage sur la production que sur le bien-être. Déplacer l’accent ne signifie pas désavouer les mesures du
PIB et de la production. Issues de préoccupations sur la production marchande et l’emploi, elles continuent
d’apporter des réponses à nombre de questions importantes comme celle de la gestion de l’activité
économique. Il importe cependant de mettre l’accent sur le bien-être car il existe un écart croissant entre les
informations véhiculées par les données agrégées du PIB et celles qui importent vraiment pour le bien-être
des individus. Il faut, en d’autres termes, s’attacher à élaborer un système statistique qui complète les
mesures de l’activité marchande par des données relatives au bien-être des personnes et des mesures de la
soutenabilité.
Source : Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi sur la mesure des performances économiques et du progrès social,
2009
Document 5 : la Commission Stiglitz, Sen & Fitoussi (synthèse)
Source : D.Blanchet, Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011), p. 292
Document 6: les dimensions de la notion de bien être (Commission Striglitz-Sen-Fitoussi)
Pour cerner la notion de bien-être, il est nécessaire de recourir à une définition pluridimensionnelle. À partir
des travaux de recherche existants et de l’étude de nombreuses initiatives concrètes prises dans le monde, la
Commission a répertorié les principales dimensions qu’il convient de prendre en considération.

3
En principe au moins, ces dimensions devraient être appréhendées simultanément :
i. les conditions de vie matérielles (revenu, consommation et richesse) ;
ii. la santé ;
iii. l’éducation ;
iv. les activités personnelles, dont le travail ;
v. la participation à la vie politique et la gouvernance ;
vi. les liens et rapports sociaux ;
vii. l’environnement (état présent et à venir) ;
viii. l’insécurité, tant économique que physique.
Toutes ces dimensions modèlent le bien-être de chacun ; pourtant, bon nombre d’entre elles sont ignorées par
les outils traditionnels de mesure des revenus. » Source : Rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi, p.16
Document 7 : l’IDH du PNUD
L’indicateur de développement humain est un indicateur synthétique développé par la Programme des
Nations-Unies pour le Développement (le PNUD).
Document 8
http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part1/quelles-mesures-pour-quantifier-la-
pauvrete?page=show

4
Document 9 : l’IDHI
http://ceriscope.sciences-po.fr/pauvrete/content/part1/quelles-mesures-pour-quantifier-la-
pauvrete?page=show
Document : cours de F.Bourguignon au Collège de France
***********

5
Avantages et limites du financement intermédié ?
Référence biblio :
J.Couppey-Soubeyran « Monnaie, Banques, Finance », Puf
Braquet et Biasutti « Comprendre le système financier », Bréal (petit livre, très utile et facile à lire)
Il faut vous appuyer sur les documents de la plaquette Module 3 Partie 2 Chapitre 3 que je viens d’envoyer.
Il y a une partie sur les intermédiaires financiers : les banques en particulier, mais aussi les investisseurs
institutionnels et les autres intermédiaires financiers. Ce chapitre porte sur les mouvements de capitaux
internationaux, mais on peut utiliser bcp de choses pour traiter du sujet.
Il faut penser à distinguer les banques des autres intermédiaires financiers. Attention, dans l’intermédiation,
il y a l’idée que les crédits sont la contrepartie des dépôts ; un fonds d’investissement peut investir car des
agents économiques le finance. Cette activité de collecte de dépôt existe bien évidemment pour les banques.
Mais celles-ci ont une activité qui leur est propre : ce sont les seules à pouvoir créer de la monnaie. Or, dans
la création de monnaie, ce sont les crédits qui font les dépôts. Donc les banques n’ont pas besoin de dépôt
pour prêter ; par contre, elles ont une contrainte de liquidité ; elles doivent pouvoir se procurer de la monnaie
banque centrale (la seule monnaie qui leur permet de régler leurs dettes avec les autres banques).
Ceci dit, une fois les prêts réaliser, les banques se retrouvent comme les autres intermédiaires financiers
devant un risque de crédit, qui peut entraîner un risque de solvabilité. Elles peuvent aussi se trouver avec des
dépôts et des crédits qui n’ont pas le même engagement temporel (par exemple des dépôts à vue et des
crédits de long terme), ce qui peut entraîner un risque de liquidité, si tous les agents retirent leurs dépôts en
même temps.
N’oubliez pas non plus que les banques en tant qu’intermédiaires financiers sont les seules à gérer les
moyens de paiements (quand un fonds de pension récolte des dépôts, il ne propose pas en contrepartie des
chéquiers ou de la monnaie manuelle pour régler des dépenses).
Vous avez évoqué les questions d’asymétrie d’info dans le cas des relations de prêteurs/emprunteurs.
Il aurait été intéressant que vous développiez aussi les problèmes posés par la titrisation des prêts
immobiliers aux ménages. La titrisation a conduit à des problèmes d’aléa moraux qui sont au cœur de la crise
des subprimes.
Document 1
Si le passage à un financement par les marchés est souvent présenté comme un passage à la finance directe,
ce n’est pas le sens que l’ouvrage fondateur de Gurley & Shaw (1960) donne à ce terme. Ces auteurs
définissent la finance directe comme le système financier où les agents dont le bilan est excédentaire et
présente une capacité de financement (les prêteurs « ultimes ») financent les agents ayant un besoin de
financement (les emprunteurs « ultimes ») par l’achat des titres émis par ces derniers. Plus concrètement, les
ménages financent les entreprises en achetant les actions et les obligations qu’elles émettent.
Ceci n’est pas le système financier qui s’est établi en France après l’économie d’endettement. Les entreprises
émettent certes des titres dont une partie est acquise par les ménages ou les entreprises, mais les préférences
des agents à excédent vont vers les titres émis par les intermédiaires financiers, qu’il s’agisse de banques ou
d’autres sociétés financières. Les intermédiaires financiers achètent les titres émis par les entreprises et les
font entrer dans la composition de portefeuilles (…). Certains de ces titres combinent le rendement certain
des obligations avec celui plus conjoncturel des actions. Fonds Communs de Placement (FCP) ou SICAV
(Société d’investissement à capital variable) constituent pour les ménages le support de cette finance de
marché intermédiée. Leur épargne est ainsi placée en titres de la finance indirecte selon la terminologie
adoptée depuis Gurley & Shaw. Il ne s’agit donc pas d’un passage à la finance directe mais d’un passage à la
finance de marché intermédiée.
Source : Françoise Renversez « De l’économie d’endettement à l’économie de marchés financiers » in Revue
Regards croisés sur l’économie n°3, mars 2008, p. 60
Document 2 : les banques, acteurs centraux de la finance de marché intermédiée
La montée en puissance des marchés de capitaux à partir des années 1980 dans les pays d’Europe a, au
départ, été perçue et analysée comme une force de convergence vers un système financier davantage fondé
sur les marchés. Dans cette optique, les analyses les plus courantes considéraient qu’on était en train
d’assister à une « désintermédiation », c’est-à-dire une diminution du poids des banques dans le financement
de l’économie. C’était sans compter sur l’adaptation des banques à l’essor des marchés, sur le
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
1
/
70
100%