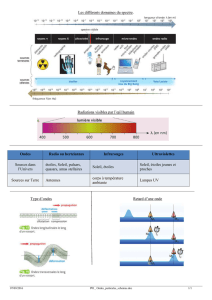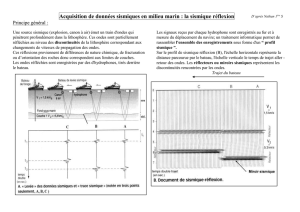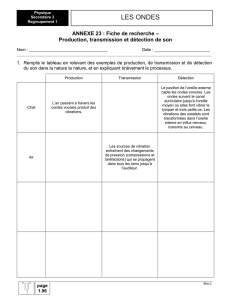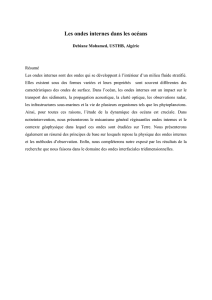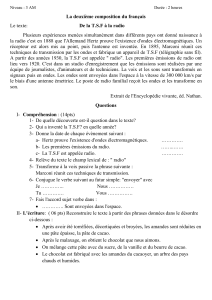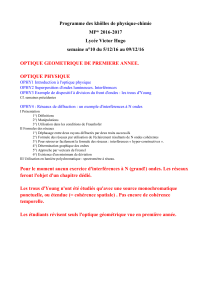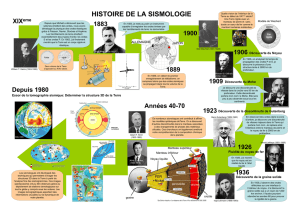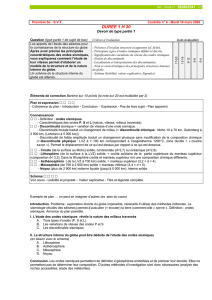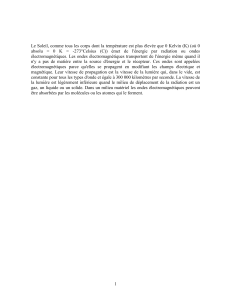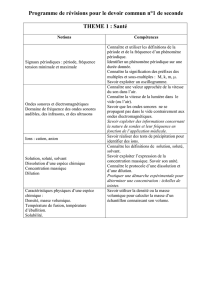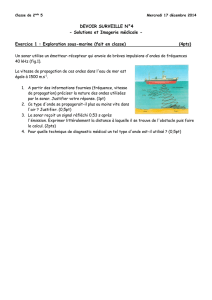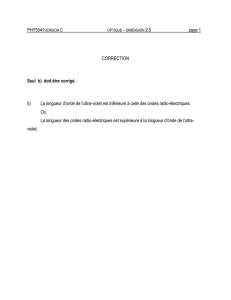Structure et composition chimique de la terre

Structure et composition chimique de la terre
Problématique : comment connaître la structure et la composition de la terre, alors que pour
un rayon de 6380 km les sondages ne dépassent pas 10 km de profondeur
Intro
Les géologues ont beaucoup utilisé une méthode indirecte ; la propagation des ondes
sismiques
I. Les informations apportées par l’étude des ondes sismiques :
( TP1, TP2 )
Un séisme est le résultat de la libération brutale d’une énergie longtemps accumulée et qui
provoque le mouvement relatif de deux plaques lithosphériques. Cette énergie se manifeste
alors sous forme d’ondes sismiques.
1) les différentes catégories d’ondes sismiques (voir TP1, activités 2&3)
Il existe trois sortes d’ondes : P, S et L qui diffèrent entre autre par leurs vitesse de
propagation. Dans un milieu homogène, et pour des températures et pressions constantes, la
vitesse de propagation d’un type d’ondes, est constante. La modification de la vitesse d’un
type d’onde correspond à un changement de nature, de densité, d’état, ou de plusieurs de ces
facteurs réunis.
2) Existence de « zones d’ombres » (voir TP2, activités 1&3)
Les ondes P ne sont pas reçues dans les stations distantes de 11500 à 14500 km de l’épicentre
d’un séisme. Les ondes S ne sont plus du tout reçues au-delà de 11500km. Ce sont des zones
d’ombres. On sait que les ondes S ne se propagent pas dans les liquides, on en déduit qu’il
existe une surface de discontinuité, càd une surface de réfract° séparant deux milieux au
propriétés très différents ; son nom est la discontinuité de Gutenberg. A 2900km, elle sépare
le manteau du noyau externe liquide.
3) la discontinuité de Mohorovicic (Moho) (voir TP2, activité 2)
Pour des stations assez proches de l’épicentre, les ondes P et S arrivent à une vitesse
constante, correspondant à une trajectoire directe. Pour une distance précise, une deuxième
série d’ondes P arrive plus tard, on suppose un phénomène de réflexion sur une surface de
discontinuité. Pour des stations un peu plus éloignées, des ondes sont enregistrées plus tôt,
cela est dû à un phénomène de réfraction dans un deuxième milieu plus dense où les vitesses
sont plus élevées. Cela confirme l’existence d’une discontinuité de Moho qui délimite la
croûte du manteau. Elle se situe à environ 10km sous les océans et 30 km en moyenne sous
les continents.
4) Etude des vitesses de propagation des ondes P et S en fonction des profondeurs (voir TP2
activité 4)
a) Dans la croûte et dans le manteau :
Les vitesses des ondes P et S arrivant des stations situées à distances diverses
de l’épicentre (jusqu’à 11500 km), ne sont pas constantes. Plus les stations sont éloignées,

plus les vitesses de propagat° sont élevées. Les ondes ayant parcourues des profondeurs de
plus en plus élevées, on en déduit que la terre n’est pas homogène et que la densité des
matériaux s’élève avec la profondeur. Les ondes ont une trajectoire courbe, comme les rayons
lumineux.
b) la « zone de faible vitesse » ou LVZ
La lithosphère comporte la croûte, ou écorce terrestre, et la partie la plus
externe du manteau supérieur. Les ondes s’y accélèrent avec la profondeur. La lithosphère est
séparée de la couche sous-jacente (l’asthénosphère) par un ralentissement de la vitesse des
ondes P et S. Ce ralentissement est lié à un changement de condition physiques : température
et pression plus élevée qui fait que les matériaux deviennent moins rigides. La LVZ est située
entre -100km et -200km, mais la plupart des géologues considèrent que l’asthénosphère va
jusqu’à -670km, limite entre manteau supérieur et inférieur.
c) l’existence d’un noyau solide
A 5150 km de profondeur, les ondes P s’accélèrent alors qu’elles avaient brusquement ralenti
à 2900km. Ces ondes S avaient alors disparues. Cela montre l’existence d’une partie rigide du
noyau interne qu’on appelle la graine.
Conclusion
La terre a donc une structure formée de couches concentriques aux propriétés différentes.
Pour les changements les plus importants à la fois physiques et chimiques les séparations
sont appelées discontinuités.
II. COMPOSITION CHIMIQUE DE LA TERRE
1) nature des matériaux directement observables
a) matériaux de domaine continental
(TP 3 activités 1et 4)
Le domaine continental comporte aussi les roches du talus continental, ou plates formes
continentales. Elles sont essentiellement composées de granite et de grès, souvent recouverts
d’une mince couche riche en oxyde de silicium, (si O2) ou silice, ainsi qu’en oxyde
d’aluminium, de sodium et de potassium. Ces oxydes s’assemblent pour former des minéraux
silicatés (ex. Phelspate, Quartz, Micas)
1
/
2
100%