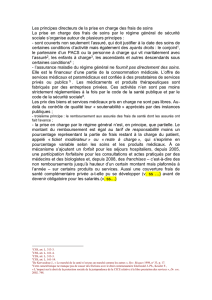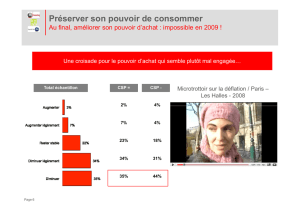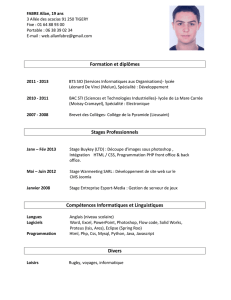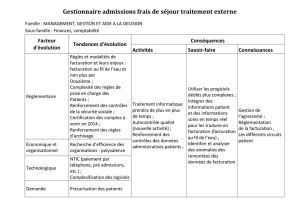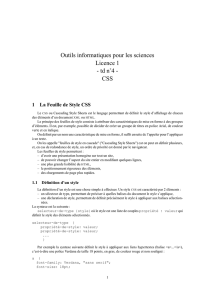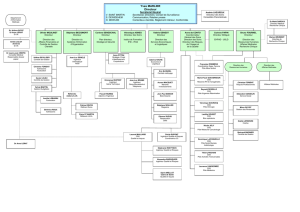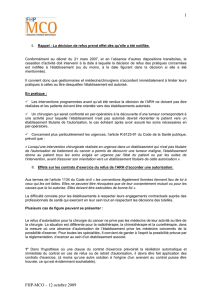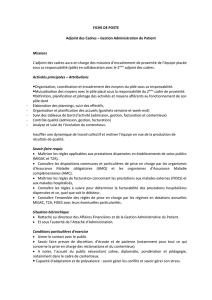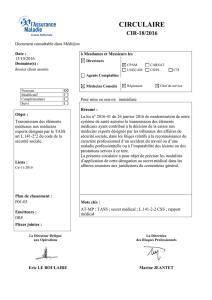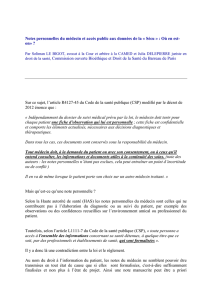Monsieur Michaël ETTEDGUI - Fhp-MCO

Thierry DUGAST
Avocat à la Cour
2, 4 et 6 rue des Deux Ponts
ILE SAINT LOUIS - 75004 PARIS
TELEPHONE 01.44.32.07.00 – TELECOPIE 01.43.29.60.79
tdugast@practavocats.com
FHP MCO
Monsieur Thierry BECHU
81, rue de Monceau
75008 PARIS
Paris, le 13 novembre 2009
AFF. : FHP MCO
Dossier n° 20080196 - TD/AFB
Cher Monsieur,
Vous m’avez interrogé sur les voies de recours ouvertes pour les établissements auxquels
est refusée l’autorisation de cancérologie, et je souhaite revenir vers vous pour préciser à la
fois les voies de recours, et les conséquences de l’éventuelle poursuite d’activité malgré le
refus d’autorisation.
I - VOIES DE RECOURS
Les décisions explicites que prennent, après avis du comité régional de l'organisation
sanitaire, les commissions exécutives doivent être motivées. Ces autorisations sont notifiées
par lettre recommandée avec avis de réception au demandeur de l'autorisation.
Cette notification fait débuter le délai de recours, soit 2 mois à compter de la notification de la
décision ou de sa publication (pour les tiers) comme il est d’usage pour toutes les décisions
relevant du droit public. La décision doit mentionner les délais et voies de recours pour faire
courir ce délai.
Ce délai de deux mois peut être augmenté lorsque la décision est un rejet implicite en
l’absence de réponse à l’issue du délai de six mois d‘instruction de la demande, si
l’établissement demande à connaître les motifs du rejet implicite.
En effet, en application de l’article L.6122-9 du code de la santé publique (CSP), « la
décision de l'agence régionale de l'hospitalisation est notifiée au demandeur dans un délai
maximum de six mois suivant la date d'expiration de la période de réception des demandes.
Cette décision est motivée. Toutefois, l'absence de notification d'une réponse dans ce délai
vaut rejet de la demande d'autorisation. Dans cette hypothèse, et si le demandeur le sollicite
dans un délai de deux mois, les motifs justifiant ce rejet lui sont notifiés dans le délai d'un
mois. Le délai du recours contentieux contre la décision de rejet court alors de cette
notification ».
Il convient d’examiner les différents types de recours qui peuvent être mis en œuvre.
1- recours hiérarchique

2
Ce recours est prévu par l’article L.6122-10-1 CSP.
Cet article mentionne que le SROS et les décisions d’autorisation d'activités ou
d'équipements matériels lourds sont susceptibles d'un recours hiérarchique auprès du
ministre chargé de la santé, qui statue dans un délai maximum de six mois, après avis du
Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.
Cette disposition précise que le recours hiérarchique ne constitue pas un préalable
obligatoire au recours contentieux.
Le recours hiérarchique doit être formé dans le délai de 2 mois suivant la notification de la
décision, la communication des motifs du rejet implicite ou, pour les tiers, à compter de la
publication de la décision, par lettre RAR (article R.6122-42 CSP) ou remise en mains
propres (avec justificatif de réception).
Il appartient au Ministre de la Santé de se prononcer dans les 6 mois suivant la réception du
recours gracieux. Une absence de réponse équivaut à une confirmation implicite de la
décision contestée.
L’exercice de ce recours suspend le délai de recours contentieux.
En cas de rejet de ce recours hiérarchique, il faut saisir le Tribunal administratif dans le délai
de deux mois de la décision ministérielle explicite ou de l’expiration du délai de six mois visé
ci-dessus.
2- recours juridictionnel contre le refus d’autorisation
Le Tribunal administratif peut également être saisi directement à l’encontre de la décision de
rejet de la COMEX, dans le délai de deux mois.
La requête doit être motivée en fait et en droit et adressée au tribunal par l’intermédiaire d’un
avocat.
Il est nécessaire de préciser que la saisine du juge administratif n’a pas de caractère
suspensif à l’égard de la décision de rejet.
3- recours amiable devant la COMEX
Il est possible également, dans le délai de recours contentieux de deux mois indiqué ci-
dessus, de former un recours gracieux devant la COMEX, en demandant au directeur de
l’ARH de revoir la décision de refus.
Ce recours gracieux obéit aux règles générales en matière de droit administratif, selon lequel
l’exercice d’un recours gracieux proroge le délai du recours contentieux. Mais cette règle ne
joue qu’une seule fois, de sorte qu’il est considéré que le recours gracieux suivant un
recours contentieux ne proroge pas le délai.
Lorsque le recours hiérarchique était un préalable obligatoire, il n’était donc pas possible
d’utiliser cette faculté. Mais puisque le caractère de préalable obligatoire à disparu, il serait
possible de demander à l’ARH de revoir sa décision, sans perdre le bénéfice du délai de
recours contentieux.

3
Un arrêt du Conseil d’Etat en date du 3 mars 2008 (n°301643) semble toutefois considérer
que la seule possibilité d’exercer le recours hiérarchique ferme la voie au recours amiable,
du moins sous l’angle de la conservation du délai de recours.
Dès lors l’exercice de ce recours devant l’ARH, plus indiqué en opportunité, oblige malgré
tout les établissements à engager également un recours hiérarchique ou contentieux dans le
délai de deux mois de la notification de la décision de refus. En application de la
jurisprudence (CE 8 juillet 2005 n° 264366), l’exercice du recours hiérarchjque dessaisit
l’ARH, ce qui ramène au point 1 ci dessus.
4- Référé administratif
Aucun des recours mentionnés ci-dessus n’ayant de caractère suspensif, et compte tenu des
incidences qu’emporte pour les établissements et leurs médecins l’arrêt des activités de
cancérologie, il est possible d’envisager une requête en référé suspension.
Le « référé suspension » permet à un juge administratif d’ordonner la suspension de
l’exécution d’une décision administrative. La suspension de la décision de rejet permet doc à
l’établissement de poursuivre ses activités jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la
demande.
Toutefois, les conditions posées par l’article L 521-1 du Code de justice administrative et leur
application par la jurisprudence rendent cette voie assez étroite.
Il est en effet nécessaire de démontrer que l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen
propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en
cause.
L’urgence doit être particulièrement motivée. Il faut faire apparaître concrètement les effets
irréversibles qu’aurait l’arrêt d’activité de cancérologie sur l’activité de l’établissement et des
médecins, avec l’obligation dans certains cas l’obligation de résilier les contrats d’exercice,
voire les conséquences pour les patients.
Le moyen sérieux correspond à une illégalité assez évidente (en l’espèce, il s’agira
essentiellement d’une discussion sur le niveau d’activité, ou d’une remise en cause motivée
de l’absence dans les annexes pour un établissement assurant déjà l’activité de manière
significative).
Théoriquement, une requête en référé n’est recevable que si le tribunal administratif est déjà
saisi d’une requête en annulation de la décision de rejet.
Lorsqu’un recours hiérarchique est obligatoire, le Conseil d’Etat a cependant admis que le
juge pouvait être saisi d’une requête en référé dès lors que l’établissement justifiait avoir
formé le recours hiérarchique (CE section 12 octobre 2001 n° 237376).
Toutefois, ce caractère obligatoire ayant disparu, on peut craindre que la solution ne soit pas
maintenue, de sorte que l’exercice du référé serait retardé en cas de recours hiérarchique.

4
II – SANCTIONS EVENTUELLES
Il résulte du régime issu des décrets 2007-388 et 2007-389 du 21 mars 2007, que les
établissements qui n’ont pas déposé de dossier de demande d’autorisation lors de la période
ouverte à la suite de la révision des SROS ou dont la demande a été rejetée, doivent cesser
leurs activités de traitement des cancers, faute de disposer de l’autorisation prévue pour
l’exercice de l’activité mentionnée au 18 ° de l’article R 6122-25 CSP.
Conformément aux dispositions précitées du décret du 21 mars 2007, et en l’absence
d’autres dispositions transitoires, la cessation d’activité doit intervenir à la date à laquelle la
décision de refus est notifiée à l’établissement.
Il en découle le cas échéant, la nécessité de mettre un terme aux contrats d’exercice des
médecins qui assuraient cette activité (I) ; inversement, la poursuite de l’activité malgré
l’absence d’autorisation exposerait l’établissement à certaines conséquences (II).
1- Rupture des contrats d’exercice.
L’incidence du régime des autorisations délivrées à l’établissement de santé sur l’exécution
des contrats d’exercice des médecins est indéniable, dès lors que les autorisations
conditionnent l’exercice médical.
Toutefois, le principe de l’effet relatif des contrats ne permet pas d’opérer une relation
automatique entre autorisations et contrats, hormis bien sur l’existence de stipulations
contractuelles spécifiques permettant la résiliation automatique et immédiate du contrat en
cas de refus ou de retrait d’autorisations.
En l’absence de telles stipulations contractuelles et à défaut d’usages en la matière
1
, il
convient de faire application des règles générales en la matière.
Un contrat à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par l’une ou l’autre des
parties, si nécessaire en justifiant du motif. Le bien fondé de la résiliation est apprécié par
les tribunaux en cas de contestation, sous l’angle de l’abus de droit. Il a été jugé à plusieurs
reprises que la cessation d’une activité consécutive à une décision de l’ARH n’était pas
abusive et permettait de mettre fin au contrat (notamment Cass Civ I 18 septembre 2008 n°
07-11021 ; 30 octobre 2007 n°06-17227).
Cela étant, cette résiliation doit intervenir en respectant les stipulations contractuelles ou les
usages relatifs au délai de préavis nécessaire, de sorte qu’une résiliation bien fondée mais
non assortie du préavis suffisant entraîne un droit à indemnisation pour le médecin.
La question se pose donc avec acuité pour les établissements dont la demande est
totalement ou partiellement rejetée.
Comme cela est indiqué ci-dessus, la notification de la décision induit l’arrêt de l’activité
antérieurement exercée et ne permet pas l’exercice du médecin pendant une période de
préavis.
1
Ni le CLAHP, ni les contrats types de l’ordre des médecins ne prévoient les conséquences d’un retrait ou d’un
refus d’autorisation sur l’exécution du contrat d’exercice.

5
Pour éviter de devoir payer une indemnité aux médecins concernés, les établissements
pourraient essayer de faire valoir la théorie de la force majeure, qui suppose la réunion de
trois conditions : irrésistibilité, imprévisibilité et extériorité.
Le caractère irrésistible ne fait pas de doute, puisque la décision de l’ARH s’impose aux
établissements.
Le caractère extérieur est également défendable, puisque l’arrêt d’activité résulte de la
décision de la COMEX. Toutefois, il faut observer qu’elle peut résulter d’éléments propres à
l’établissement (insuffisance d’activité, non respect des conditions…), de sorte que ce critère
peut donner lieu à discussion.
Le caractère imprévisible est également discutable, dès lors que certaines décisions
pouvaient être pressenties compte tenu des travaux menés sur les SROS ou compte tenu
des données d’activité des établissements. Cet élément renvoie d’ailleurs à la notion de délai
de préavis.
Il n’est donc pas possible de tirer une règle générale en la matière, d’autant moins que pour
certaines des pratiques (celles relevant de la chirurgie), le refus d’autorisation d’activité de
traitement des cancers n’empêche pas la poursuite de l’activité chirurgicale.
Il reste également le cas particulier des contrats à durée déterminée, dans lesquels la
résiliation n’est en principe pas possible avant le terme convenu. Dans ce cas, outre les
éléments ci-dessus, on peut également essayer de faire valoir la disparition de la cause du
contrat.
2- Conséquences de la poursuite d’activités non autorisées.
2-1 Absence de prise en charge par les organismes sociaux
Conformément à l’article L 162-21 du Code de la sécurité sociale (CSS), « l'assuré ne peut
être couvert de ses frais de traitement dans les établissements de santé de toute nature que
si ces établissements sont autorisés à dispenser des soins aux assurés sociaux ». L’article L
6122-4 CSP dispose pour sa part que l’autorisation délivrée pour l’exercice d’une activité de
soins vaut, sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux.
Il en résulte que l’absence d’autorisation pour une activité de soins ne permet pas aux
assurés sociaux d’être pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’activité
concernée
2
et ne permet pas davantage aux établissements de soins de leur dispenser des
soins remboursables.
Dès lors, le paiement éventuel des frais d’hospitalisation par les caisses leur ouvre le droit
de réclamer le paiement de l’indu, sur le fondement général des articles 1235 et 1376 du
Code civil. Cette action peut être dirigée tant contre les établissements que contre les
médecins, au titre des honoraires médicaux correspondants.
Une situation correspondante était intervenue lors de l’encadrement des quotas d’activité en
chirurgie ambulatoire, conduisant finalement à plusieurs décisions de la Cour de Cassation
validant le principe de la répétition d’indus (notamment Cass Civ II 18 janvier 2005 n°03-
30562 ; 18 octobre 2005 n°04-30.401).
2
Conformément aux articles R 162-32 et R 162-32-1 CSS, l’établissement n’est pas davantage autorisé à
facturer directement les patients.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%