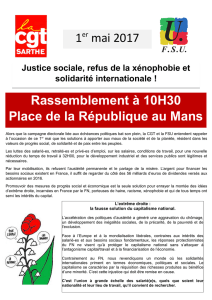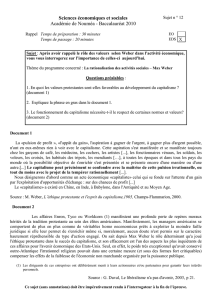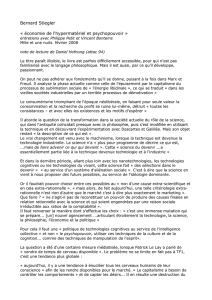Peut-on réguler le capitalisme

Le capitalisme en questions
Qu'est-ce que le capitalisme ?
Aujourd'hui encore, la notion de capitalisme est discutée et source de malentendus. Sa définition se
heurte à au moins quatre difficultés.
Un concept et une idéologie. D'un côté, c'est un concept qui sert à décrire un mode de production.
De l'autre, le suffixe en « isme » l'assimile à une idéologie au même titre que le socialisme auquel il a
été d'ailleurs traditionnellement opposé ; en ce sens, il peut être utilisé comme « mot de combat »
selon la formule de François Perroux.
Une réalité complexe. Pour les uns, le capitalisme est un phénomène essentiellement économique
qui peut être analysé indépendamment de la sphère sociale, comme le pense par exemple F. Perroux
(Le Capitalisme, 1948, Puf, « Que sais-je ? »). En cela, le capitalisme se définirait en opposition avec
le socialisme, caractérisé, lui, par le primat du politique sur l'économique. Pour d'autres, le capitalisme
est loin de se réduire à l'économique. Joseph Schumpeter va jusqu'à suggérer de l'étudier comme une
civilisation. Chez Fernand Braudel, le capitalisme ne couvre pas toute l'économie mais en constitue l'«
étage supérieur », au-dessus de la civilisation matérielle et de l'économie de marché. D'autres encore
nient l'existence d'un capitalisme « comme une réalité sociale existant en soi et pourvue d'une sorte
d'autonomie, de capacité d'autodétermination, obéissant à des lois de fonctionnement et de dévelop-
pement propres ».
Un objet en perpétuel changement. Une autre source de difficultés tient aux changements perma-
nents que connaît le capitalisme. Comme l'explique l'économiste Michel Beaud, « Loin d'être une réa-
lité figée, un cadre rigide, un ensemble de rapports stables, le capitalisme est une dynamique et auto-
transformatrice à l'œuvre de manière incessante ». Cette caractéristique avait été soulignée dès
l'abord par Marx ou Schumpeter. D'où la difficulté d'identifier le capitalisme sous des traits définitifs.
D'où aussi la déclinaison des épithètes qui lui ont été accolés (marchand, industriel, postindustriel...).
Une multitude de réalités. Enfin, le capitalisme recouvre différentes réalités : l'accumulation du capi-
tal mais aussi la propriété privée, la coordination par le marché, les relations marchandes, le salariat...
Tous les penseurs ne s'accordent pas sur l'importance de chacune de ces caractéristiques, même si
l'idée de processus d'accumulation illimitée est dans la plupart des définitions.
Capitalisme et justice sociale sont-ils conciliables ?
Cette question a opposé et continue d'opposer trois grandes traditions de pensée, l'une encline à con-
sidérer que le capitalisme est dans son essence une source d'inégalités et doit donc être dépassé
(socialisme révolutionnaire), l'autre pensant au contraire qu'il profite au plus grand nombre (libéra-
lisme) ; celle enfin pour qui le capitalisme peut être régulé, encadré : la tradition social-démocrate
apparue dans l'entre deux guerres et le libéralisme social. Dès le xixe siècle, des libéraux réformistes
comme J.S. Mill considèrent qu'il est possible de corriger les abus du capitalisme.
De fait, son développement est allé de pair à partir du xixe siècle avec la mise en place progressive
d'une législation sociale. Dès les années 1870, durant l'ère bismarkienne, l'Allemagne adopte les
premières lois sociales. Suivra l'adoption en France de lois limitant la durée du travail des enfants, des
femmes puis des ouvriers. A partir de l'après-guerre, la mise en place d'un Etat-providence aux Etats-
Unis (à travers le New Deal), en Angleterre (rapport Beveridge) puis dans les pays occidentaux, ré-
pond au souci de concilier dynamique du capitalisme avec justice sociale. Les années de croissance
de l'après-guerre s'accompagnent d'une progression généralisée du niveau de vie.
Les débats sur la crise de l'Etat-providence apparue avec les chocs pétroliers et la mise en cause des
politiques keynesiennes dans les années 70-80 ont incliné certains auteurs à penser que l'Etat provi-
dence n'était qu'une parenthèse dans la longue histoire du capitalisme. Ils interprètent le contexte
actuel comme la remise en cause de la grande transformation décrite par Karl Polanyi (voir encadré).
En d'autres termes, dans le contexte de mondialisation, le capitalisme retrouverait sa véritable nature,
essentiellement économique, désencastrée du social.

Toutefois, dans le contexte des années 90 marquées par l'adoption de politique d'austérité et de ré-
duction des dépenses publiques dans les pays occidentaux, certains auteurs tentent de poser en
termes nouveaux le débat. C'est le cas du prix Nobel d'économie, Amartya Sen, qui réfléchit à la pos-
sibilité de concilier réduction des dépenses et justice sociale.
Dans l'optique de l'école de la régulation, d'autres soulignent la nécessité d'imaginer de nouveaux
compromis sociaux. Parmi eux, Michel Aglietta n'exclut pas la possibilité d'articuler ces compromis à
l'actionnariat salarié.
D'autres enfin considèrent que les États et leurs économies nationales ne sont plus les cadres perti-
nents pour penser le rapport entre capitalisme et justice sociale, que les dispositifs doivent être dé-
sormais envisagés à un niveau supranational. Vont dans ce sens : les accords contre le dumping so-
cial ou l'imposition d'une taxe sur les transferts financiers (la fameuse taxe Tobin imaginée par le prix
Nobel américain du même nom et prônée par l'association Attac).
Le capitalisme est-il moral ?
Si la réponse à cette question se fonde sur des constats objectifs (aggravation des inégalités, exploi-
tation d'enfants...), elle est aussi liée à des présupposés culturels et religieux.
Dans les pays à dominante catholique, la défiance à l'égard du capitalisme prendrait sa source dans
une condamnation ancienne : celle de l'usure et de l'enrichissement, déjà présente chez Aristote ou
dans l'Ancien Testament.
Pour la philosophe et spécialiste d'éthique financière Geneviève Even-Granboulan, auteur d'un ou-
vrage récent sur ce thème : « Le catholicisme a longtemps été hostile au capitalisme et malgré une
certaine atténuation de cette condamnation, cette réticence n'a pas été totalement levée. » Elle se
retrouve notamment dans la condamnation des pratiques de spéculations financières.
Les mêmes explications ont été avancées au sujet des pays à dominante musulmane dans lesquels
l'usure est encore une pratique condamnée.
Depuis L'Ethique protestante et l'Esprit du capitalisme de Max Weber, les pays protestants sont au
contraire réputés mieux disposés au capitalisme. L'accumulation n'y est pas considérée comme une
fin en soi mais un moyen d'une vie bonne. En ce sens, le capitalisme devient une discipline de tous
les instants. Mais ce qui est vrai pour le capitalisme des origines l'est-il pour le capitalisme contempo-
rain ? Différents auteurs en doutent en considérant que « les valeurs dont parle Weber (ont) été dé-
truites depuis longtemps par l'envahissement de l'économique dans notre imaginaire ».
Toutefois, pour G. Even-Granboulan : « On fait souvent grief au capitalisme de son immoralité ; de
fait, cette immoralité caractérise des formes imparfaites de capitalisme qui ne sont pas encore parve-
nues à maturité. On serait tenté de citer les exemples contemporains du développement anarchique
du capitalisme mafieux à la russe ; ou encore l'appétit de jouissance d'un pays comme la Chine. Cette
fièvre d'acquisition sans aucun frein moral a beau exister bien souvent, elle n'a pas grand-chose à voir
avec le capitalisme et son "éthos" fondamental. L'esprit du capitalisme est amené à lutter contre ces
pratiques qui constituent autant de déviations regrettable et condamnables. »
Pour d'autres, le capitalisme n'est qu'un processus d'accumulation dépourvu de finalité autre que cette
accumulation. En cela, il n'est ni bon ni mauvais, il est amoral. La question est alors de savoir com-
ment lui donner sens.
Ces dernières années ont ainsi vu des tentatives de moralisation à travers l'édiction dans des secteurs
d'activité professionnelle de règles d'action (déontologie). Elles se traduisent concrètement par la ré-
daction de chartes de déontologie au sein d'entreprises. Certaines d'entre elles ont ainsi affiché leur
refus de commercialiser des produits jugés immoraux (magasins Auchan par exemple), de délocaliser
dans des pays qui exploitent les enfants et les femmes (firme Lévi Strauss) etc. A noter aussi, plus
récemment, le développement de « fonds éthiques ». Destinés à l'origine à gérer les fonds de com-
munautés religieuses, ils se sont diffusés auprès du grand public. Ils consistent à sélectionner les
actions en fonction de critères éthiques. La rentabilité de ces fonds se révèle aussi élevée que les
fonds classiques. Des spécialistes de la finance y voient une piste à ne pas négliger pour moraliser le
capitalisme contemporain.
Allons-nous vers un capitalisme mondial ?
Si tous les penseurs s'accordent sur l'idée d'une extension inéluctable du capitalisme, tous n'en con-
cluent pas à l'imposition d'un seul et même capitalisme mondial.

Le point de vue critique. Déjà, pour les marxistes léninistes, le capitalisme était voué à s'étendre,
par le jeu de l'impérialisme, à l'échelle de toute la planète.
Depuis, les débats intervenus dans les années 80-90 autour de la mondialisation et de la globalisation
financière, de l'essor du commerce mondial, de l'apparition de nouveaux pays industrialisés, etc., ont
banalisé l'idée de l'émergence d'un « capitalisme mondial ».
Dès les années 70, dans Le Capitalisme mondial (Puf, 1976, rééd. Puf, Quadrige, 1998), Charles-
Albert Michalet recommande de substituer le paradigme de l'économie mondiale à l'économie interna-
tionale. Il met en avant le rôle des firmes multinationales et leur essor depuis les années 50. Alain
Caillé parle d'un « mégacapitalisme parfaitement insensible aux attaques effectuées sur une base
seulement nationale ». D'autres auteurs, comme Serge Latouche, mettent en avant l'idée d'un « mar-
ché devenu planétaire » sous l'emprise d'une « mégamachine » liée à la technostructure (Les Dan-
gers du marché planétaire, Presses de sciences po, 1998).
Les approches comparatives. Dans les années 80-90, de nombreuses études comparatives mon-
trent que les sociétés capitalistes les plus avancées continuent à présenter des divergences notables.
Citons, outre le célèbre ouvrage de Michel Albert, les travaux des courants régulationnistes ou institu-
tionnalistes. Ils mettent l'accent sur le poids des institutions, des trajectoires nationales ou des phé-
nomènes d'hybridation. La convergence est alors considérée comme peu probable, chaque système
productif se renouvelant en permanence en adaptant des innovations venues de l'extérieur au con-
texte économique mais aussi social et culturel du pays.
Dans Capitalismes en Europe (La Découverte, 1996), Colin Crouch et Wolfang Streeck écrivent ainsi :
« Contrairement à une idée répandue, les technologies et les marchés sont loin d'être les seuls fac-
teurs déterminants de la vie sociale dans un régime capitaliste, et les sociétés disposent de schémas
variés pour définir la manière de conduire leurs capitalismes respectifs et, par conséquent, la sorte de
sociétés qu'elles veulent développer. Dans certains cas, ajoutent-ils, ces choix ont été faits depuis
longtemps et se trouvent désormais profondément enracinés dans une "culture" établie qui échappe,
du moins à court terme, aux acteurs contemporains. » Cette thèse d'une diversité est toutefois discu-
tée, notamment aux Etats-Unis. Dans L'Economie mondialisée (Dunod, 1993), consacrée au « capita-
lisme du xxie siècle », l'ex-secrétaire d'Etat au travail, Robert Reich, considère que l'extension de la
sphère marchande à l'échelle de la planète remet en question le concept d'économie nationale et rend
obsolètes les particularismes nationaux du capitalisme.
De son côté, Michel Albert suggérait lui-même récemment l'idée d'une convergence entre le capita-
lisme anglo-saxon et le capitalisme rhénan (pour mieux réfuter l'idée d'une substitution du premier sur
le second). Dans leur ouvrage déjà cité, Streeck et Crough reconnaissent à leur tour la remise en
cause de spécificités nationales, sous l'effet notamment de la globalisation financière. «Sauf si une
capacité de gouverner est rétablie au niveau national, ce qui semble fort improbable, la diversité future
du capitalisme ne se situera plus principalement dans des divergences entre pays.» Dans ce contexte,
c'est, selon eux, à l'échelle des entreprises ou des régions que se situeront les spécificités.
L'économie politique internationale.
Du point de vue des spécialistes d'économie politique internationale, il ne fait en revanche plus de
doute que les différences nationales sont appelées à s'estomper voire disparaître. Pour eux, le déve-
loppement de la finance internationale et la position hégémonique des Etats-Unis modifient la donne.
Entre autres constats, l'Américaine Suzan Strange souligne les difficultés croissantes des Etats à gé-
rer de manière autonome leur économie, le poids de la réglementation internationale, la dénationalisa-
tion des firmes, les fusions-acquisitions... Elle met également en avant les effets de la position hégé-
monique des Etats-Unis, notamment en matière réglementaire (normes de pollution automobile, règles
de comptabilité...) dans ce processus d'homogénéisation. «Comme la société devient multinationale
dans son comportement, sinon dans son apparence, explique-t-elle, les capitalismes ne peuvent que
converger, plutôt que diverger.».
Le capitalisme est-il immortel ?
La théorie marxiste.
Pour Marx, il ne faisait pas de doute que le capitalisme devait disparaître à terme. Les causes qu'il
avance sont à chercher dans les contradictions internes au capitalisme : le mode de production capita-
liste engendre une dynamique qui produit des effets contraires à ses principes (la libre concurrence et
la propriété privée). La concurrence pousse à l'innovation, or celle-ci implique des dépenses crois-

santes qui encouragent la concentration et la substitution des machines à la main-d'œuvre. Il en ré-
sulte une baisse tendancielle du taux de profit et une exacerbation des conflits de classes.
Dans cette perspective, la disparition du capitalisme doit être précédée de crises allant en s'aggra-
vant. Toutefois, Marx et les marxistes n'excluent pas la possibilité que des facteurs extérieurs (décou-
verte scientifique, organisation du travail...) contrecarrent momentanément la baisse du taux de profit.
Ce qui a fait dire à des commentateurs que la thèse est infalsifiable ( on peut toujours invoquer un
facteur extérieur) et donc dépourvue de caractère scientifique. Différents auteurs marxistes n'en ont
pas moins entretenu jusqu'à nos jours l'idée d'une fin prochaine du capitalisme. C'est le cas de l'histo-
rien et sociologue Immanuel Wallerstein. L'idée d'une fin du capitalisme est également présente chez
des penseurs non marxistes.
La thèse de Schumpeter.
Elle est développée notamment dans un chapitre de Capitalisme, Socialisme et Démocratie (1942),
intitulé «Le capitalisme peut-il survivre ?». Schumpeter y écrit : «les performances réalisées et réali-
sables par le système capitaliste sont telles qu'elles permettent d'écarter l'hypothèse d'une rupture de
ce système sous le poids de son échec économique, mais le succès même du capitalisme mine les
institutions sociales qui le protègent et crée "inévitablement" des conditions dans lesquelles il ne lui
sera pas possible de survivre et qui désignent nettement le socialisme comme son héritier présomp-
tif».
Si sa conclusion rejoint les marxistes, les explications diffèrent. Pour lui, la cause de son autodestruc-
tion n'est pas économique mais sociale : elle tient à la disparition des classes sociales qui lui sont
utiles (les entrepreneurs) ainsi qu'à l'affaiblissement des valeurs bourgeoises et familiales.
La thèse de la société postcapitaliste.
Les transformations liées à la tertiarisation, aux nouvelles technologies, les débats autour du déclin
des Etats-nations ont accrédité, à partir des années 60, l'idée de l'émergence d'une société postindus-
trielle, immatérielle ou de l'information.
Certains auteurs en ont conclu à la fin du capitalisme. C'est le cas du célèbre gourou Peter Drucker.
Dans un ouvrage paru en 1993 (Post-Capitalist Society, Harper Business), il annonce, avec la révolu-
tion du management, l'émergence d'une société post-capitaliste fondée sur le savoir. « Maintenant,
tout le monde sait que la société à venir sera tout sauf marxiste. Mais beaucoup d'entre nous savent
aussi, ou du moins pressentent, que là où vont les pays développés, on ne parlera plus de ce qui
s'appelle capitalisme. Certes le marché restera, en pratique, l'instrument de l'intégration économique.
Mais dans les pays développés, la société, elle, est déjà entrée dans l'ère postcapitaliste. »
La thèse du renouveau.
D'autres penseurs considèrent au contraire que c'est à l'émergence d'un nouveau capitalisme à la-
quelle on assiste. Dans la dernière édition de son Histoire du capitalisme (Point Seuil, 1999), l'écono-
miste Michel Beaud écrit : «nous pensons que le capitalisme est plus puissant et plus vivace que ja-
mais ; ce qui s'inaugure, c'est un nouvel âge du capitalisme, caractérisé par la mobilisation croissante
de la technoscience par les firmes pour l'innovation, la création de nouveaux produits et de nouveaux
procédés et la lutte permanente, dans la compétition, pour recréer des situations monopolis-
tiques.» «Dès lors, poursuit-il, au delà du passage de l'industrie au tertiaire, le phénomène essentiel
en cours est le double mouvement de recul relatif du capitalisme industriel (...) à un capitalisme pos-
tindustriel (...)». Dans une perspective régulationniste, Michel Aglietta analyse de même la situation
actuelle comme le passage d'un capitalisme fordiste à un capitalisme de type patrimonial, fondé sur
l'actionnariat salarié et la corporate governance, les fonds de pension...
En somme, si le capitalisme est voué à mourir, c'est pour mieux renaître de ses cendres, sous
d'autres formes.
L'esprit du capitalisme.
Reste à savoir pourquoi le capitalisme a survécu et pourquoi il est susceptible de connaître encore de
beaux jours. Pour expliquer cette longévité, les sociologues Luc Boltanki et Eve Chiappelo ont avancé
des hypothèses originales. Si le capitalisme a survécu, et survivra manifestement, disent-ils en subs-
tance, c'est en raison de sa capacité d'esquiver les critiques qui lui sont adressées et de les intégrer,
qu'elles émanent des mouvements sociaux ou qu'elles soient le fait des milieux intellectuels et artis-
tiques. « Les dangers que court le capitalisme quand il peut se déployer sans contrainte en détruisant
le subtrat social sur lequel il prospère trouvent un palliatif dans la capacité du capitalisme à entendre
la critique qui constitue sans doute le principal facteur de la robustesse qui a été la sienne depuis le

xixe siècle. » Les auteurs montrent ainsi comment le discours managérial des années 80-90 a intégré
les aspirations des années 60 (responsabilisation, autonomie, mobilité...).
Existe-t-il des alternatives à l'économie de marché ?
L'effondrement de l'URSS, dans les années 80-90, la mondialisation, la contestation de l'intervention-
nisme étatique, etc., ont accrédité l'idée d'un triomphe de l'économie de marché. Dans son célèbre
article sur « La fin de l'histoire », paru en 1989, l'Américain Francis Fukuyama annonçait le triomphe
de la démocratie libérale et de l'économie de marché. Vraie ou fausse, cette idée n'a pas empêché le
développement de courants de réflexion visant à dépasser l'alternative classique entre coordination
spontanée par le marché et coordination par l'Etat.
La « troisième voie ».
Jusqu'à présent, les débats autour des politiques économiques opposaient les libéraux et ultralibé-
raux, partisans d'un désengagement de l'Etat, des privatisations des entreprises voire des services
publics, aux socio-démocrates, partisans d'une intervention de l'Etat. Introduite aux Etats-Unis dès les
années 80 par les « nouveaux démocrates » (tourner la page du New Deal) puis en Europe par An-
thony Giddens et le blairisme, la troisième voie vise à concilier efficacité du marché avec justice so-
ciale.
L'économie solidaire.
Depuis les années 70-80, des sociologues et des économistes promeuvent l'économie solidaire con-
sistant à mettre l'économique au service du lien social, sur la base du bénévolat et de la solidarité.
Elle désigne concrètement l'ensemble des entreprises et associations concourant à la réinsertion par
l'économique des sans-emplois, ou favorisant les échanges non marchands, les services de proximi-
té... Tout en s'inscrivant dans l'économie sociale, elle la dépasse en s'efforçant de trouver des solu-
tions aux sociétés confrontées au chômage de masse et à la fracture du lien social. Pour l'un de ses
principaux promoteurs, le sociologue Jean-Louis Laville, elle permet de palier les insuffisances de
l'interventionnisme de l'État tout en évitant la logique marchande pour résoudre le problème du chô-
mage de masse. Elle ne cherche donc pas à se substituer ni à l'État ni au marché mais à réaliser avec
elle une hybridation, à partir de dynamiques de projet. Ce faisant, elle entend dépasser aussi la con-
ception d'une économie séparée du social et du politique. Elle a été consacrée récemment avec la
création en France d'un secrétariat d'État de l'Économie solidaire (placé sous la tutelle du ministère de
l'Emploi).
Une économie sans argent.
Autour de la Revue du Mauss animée par Alain Caillé, des anthropologues et des socio-économistes
poursuivent une analyse critique de l'économie marchande et de la doctrine utilitariste en opposition à
la logique du don contre don à l'échange marchand. Dans un esprit similaire, d'autres courants de
réflexion militent en faveur de nouvelles formes d'échanges non marchandes qui coexisteraient avec
les formes classiques de l'échange marchand. Vont dans ce sens les initiatives en faveur des sys-
tèmes d'échange local (SEL).
L'histoire d'un mot
Si les termes de capital et de capitaliste sont anciens, celui de capitalisme est en revanche relative-
ment récent. Le mot capital apparaît dès le xiie siècle dans le sens de « fonds », masse d'argent à
faire fructifier ; le mot capitaliste apparaît pour désigner un détenteur de richesses avant de désigner à
partir du xxe siècle l'entrepreneur. Le mot capitalisme apparaît à la fin du xixe siècle, en Allemagne.
La paternité en revient aux socialistes allemands (Engels notamment) ; il sera ensuite utilisé par les
économistes puis les « capitalistes » eux-mêmes. K. Marx ne parle pas de capitalisme ; il parle en
revanche de « capital », de « capitaliste », de « mode de production capitaliste ».
L'un des premiers livres à arborer le mot capitaliste en couverture est l'ouvrage de Werner Sombart :
Der moderne Kapitalismus, publié en 1902. En France, le premier article à mentionner le mot capita-
lisme serait celui de Henri Hauser, « Les origines du capitalisme moderne en France », publié dès
1902, peu après l'ouvrage de W. Sombart, dans la Revue d'économie politique. Quatre ans plus tard,
Henri Sée fait paraître Les Origines du capitalisme moderne.
 6
6
1
/
6
100%