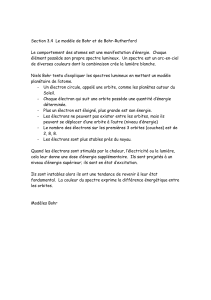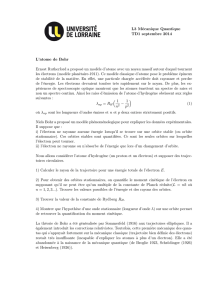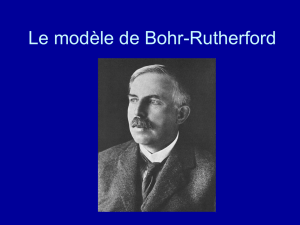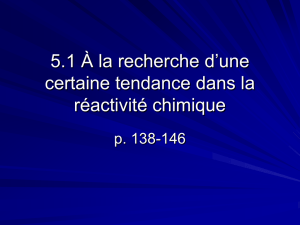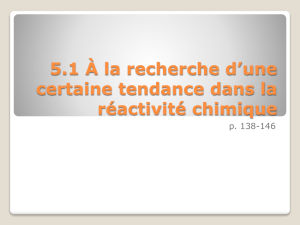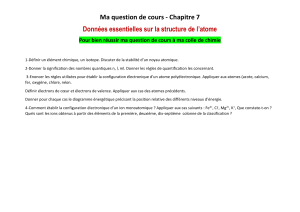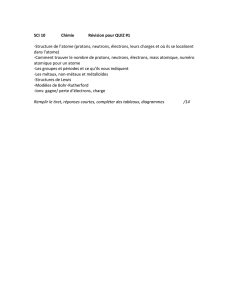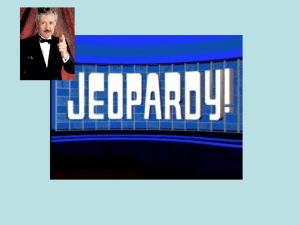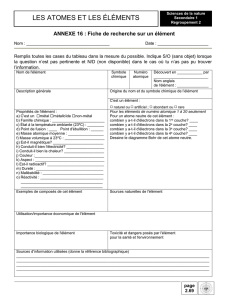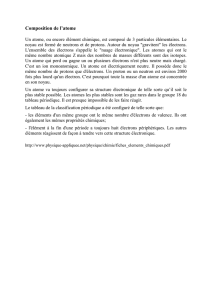Feuille de styles Documents FESeC

Modèle de l’atome et feu d’artifice
Auteur : Marleen Vanoverschelde (dans le cadre du cours d’agrégation du professeur
Soumillion, UCL)
Il s’agit d’une séquence permettant aux élèves de mettre en application le modèle atomique qui aura
été présenté préalablement par le professeur.
Exemple de structuration
A. Couleurs émises par quelques composés lors de la combustion
1
Couleur
Éléments
Composés
Formule
Violet
Potassium
Nitrate de potassium
Chlorate de
potassium
KNO3
KClO3
Bleu
Cuivre
Zinc
Chlorure cuivreux
Sulfate de cuivre
Poudre de zinc
CuCl
CuSO4
Zn
Vert
Baryum
Nitrate de baryum
Chlorure de baryum
Chlorate de baryum
Ba(NO3)2
BaCl2
Ba(ClO3)2
Jaune
Sodium
Oxalate de sodium
Oxyde de sodium
Nitrate de sodium
Na2C2O4
Na2O
NaNO3
Orangé
Calcium
Nitrate de calcium
Ca(NO3)2
Rouge
Strontium
Nitrate de strontium
Hydroxyde de
strontium
Chlorure de strontium
Oxyde de strontium
Carbonate de
strontium
Sr(NO3)2
Sr(OH)2
SrCl2
SrO
SrCO3
Blanc
Magnésium
Aluminium
Poudre de
magnésium
Poudre d'aluminium
Mg
Al
Argenté
Titane
Aluminium
Poudre de titane
Poudre d'aluminium
Ti
Al
1
Attention ! Certaines substances citées dans ce tableau ne peuvent pas, pour des raisons de sécurité, faire l'objet des
manipulations proposées. C'est le cas, en tout cas, de KNO3 et de NaNO3.

Étincelles
Aluminium
Granules
d'aluminium
Al
On remarque que deux sels contenant le même cation (ion positif) produisent la même couleur.
Exemple : CuCl et CuSO4 produisent tout deux une couleur bleue.
On peut donc, dans une certaine mesure, prévoir la couleur que produira un sel dans la flamme pour
autant que l’on connaisse déjà la couleur caractéristique du cation.
B. Emission d’énergie par les atomes
a) Un principe physique fondamental et d’observation courante veut que :
niveau fondamental
niveau excité
perte d’énergie
apport d’énergie
« TOUT SYSTEME PHYSIQUE TEND À PERDRE L’ÉNERGIE QU’IL CONTIENT DE MANIERE À SE
RETROUVER DANS UN ETAT DE PLUS GRANDE STABILITÉ. »
b) Lorsqu’un électron a acquis de l’énergie, il tend à rendre cette énergie. L’émission d’énergie se fait
sous la forme de lumière.
c) La quantité d'énergie transportée par la lumière est variable: elle dépend de la couleur de la
lumière.
C. Réponse à la situation-problème
Lors de l’absorption d’énergie, les électrons des atomes sont propulsés vers des orbites électroniques
plus externes.
Lors de la ré-émission d’énergie, les électrons retombent sur des orbites plus proches du noyau en
émettant de la lumière.
Chaque type de lumière colorée correspond à une transition énergétique dans l’atome. La grandeur
de la transition énergétique détermine la couleur de la lumière émise.
Ainsi, lors d’un feu d’artifice, en fonction de l’élément métallique que la poudre contient, l’artificier
arrive à obtenir des couleurs bien précises.
Il utilisera un sel de sodium pour obtenir une couleur jaune-orangée, un sel de cuivre pour obtenir une
couleur bleue …
Chaque atome possède des électrons disposés sur des orbites ou des niveaux d’énergie différents.
Chaque atome excité émet certaines couleurs caractéristiques de l’élément. Il s’agit toujours d’un
mélange de couleurs. Dans certains cas, l’une ou l’autre domine par son intensité.

Références bibliographiques
http://phys.free.fr/modbohr.htm (site visité le 7 novembre 2010) : c’est sur ce site que se trouve le
schéma en 3D du modèle de l’atome de Bohr.
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/theorie/pyrotechnie.html (site visité le 7 novembre 2010) :
sur ce site, beaucoup d’informations sur les feux d’artifice (dont le tableau des couleurs émises par les
substances lors de leur combustion et une bibliographie).
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/theorie/atomebohr.html (site visité le 7 novembre 2010) :
ce site présente la théorie atomique de Bohr.
A propos des feux d'artifice … et des mesures de sécurité indispensables
http://economie.fgov.be/fr/binaries/fireworks_fr_tcm326-35867.pdf ssite visité le 7 novembre 2010) : ce
site émane du gouvernement fédéral de Belgique. Il expose les principales mesures de prévention et
de sécurité à prendre pour la mise en œuvre d'artifices de joie (dénomination officielle des feux
d'artifice).
Documents pour les élèves
Mode opératoire
Dissoudre un sel dans un peu d’eau et verser cette solution dans un vaporisateur. Projeter un nuage
de cette solution dans la flamme du bec Bunsen et observer.
Les métaux sont introduits, à l’aide d’une pince, directement dans la flamme.
Observer la réaction.
Questions
1. Quel est, pour chaque couleur, observée l’élément responsable de celle-ci ?
2. Situez ces éléments sur le tableau périodique.
3. Qu’est-ce qui pourrait justifier selon-vous cette différence de coloration ?
4. Est-il possible de prévoir la coloration de ces différents sels mis dans la flamme ? Pourquoi ?
Documents pour le professeur
Modèle de l'atome selon Bohr
2
Les électrons ne peuvent pas circuler sur n'importe quelle orbite: leur trajectoire est fixée à des orbites
bien déterminées.
Les orbites électroniques
Bohr imagine que les électrons circulent sur des orbites circulaires, bien déterminées autour du
noyau. Des expériences quantitatives lui permettent de déterminer la taille de ces orbites.
Chaque orbite est désignée par un numéro ou par une lettre (K, L, M, N, O, P, Q).
Dans l'atome d'Hydrogène, l'orbite K se trouve à une distance R1 du noyau = 0,529.10-10 mètres.
Les orbites suivantes sont à des distances telles que:
Rn = R1.n2 où n est le numéro de l'orbite.
2
Ce modèle est un exemple pertinent d'un modèle considéré actuellement comme incomplet mais qui permet de rendre compte
d'un certain nombre de phénomènes. C'est l'occasion de signaler aux élèves les limites des modèles scientifiques ainsi que leur
aspect provisoire.

Le modèle de Bohr de l'atome
1) Selon le modèle de Bohr, l'électron tourne autour du noyau, sur une couche électronique bien
définie.
2) Sous l'effet de l'énergie thermique (chaleur) ou électrique, l'électron est excité par cette
énergie qu'il absorbe et saute sur une couche électronique plus énergétique.
3) L'électron est sur une couche électronique plus énergétique. Cette situation est instable et le besoin
de stabilité l'amène à perdre cette énergie pour se rapprocher du noyau.

4) L'électron revient sur sa couche électronique, à son état fondamental. Lors de son retour, il libère,
sous forme d'énergie lumineuse (photons), l'énergie thermique ou électrique qu'il avait absorbée.
5) L'électron est à nouveau sur sa couche électronique définie.
Quelques règles pour la construction des atomes
Un atome est formé d’un noyau autour duquel circulent un certain nombre d’électrons. La façon dont
les électrons sont agencés autour du noyau est importante pour la chimie.
Le nombre d’électrons par niveau d’énergie est bien fixé.
Chaque orbite électronique peut contenir un nombre d’électrons bien défini. Plus l’orbite est grande,
plus le nombre d’électrons qu’elle peut accueillir est grand.
Le modèle établi par la branche théorique de la chimie (la chimie quantique) permet de connaître le
nombre de places pour les électrons sur chaque orbite. Cette théorie dépasse largement le niveau de
ce cours, aussi nous contenterons-nous d’en noter les résultats.
Dans une représentation simple, on pourrait dire que la place disponible sur une petite orbite est
relativement limitée ; on ne pourra donc pas y disposer beaucoup d’électrons. Inversement, une
grande orbite permet d’accueillir beaucoup d’électrons.
Le nombre maximum d’électrons par orbite est égal à 2.n2 où n désigne le numéro de l'orbite.
1
/
5
100%