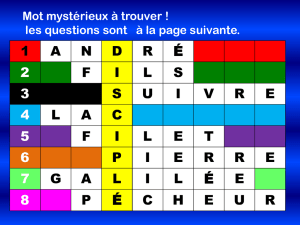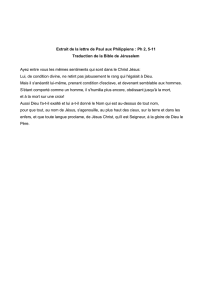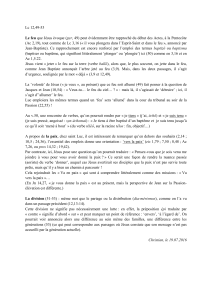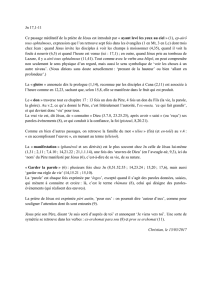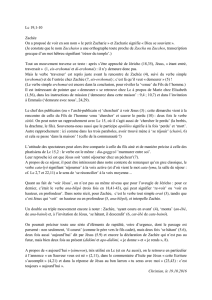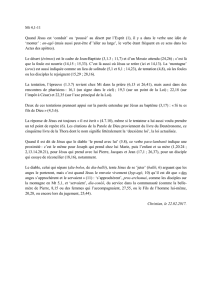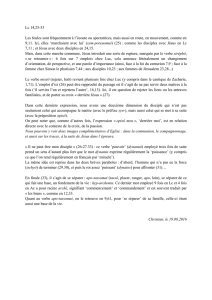Téléchargement Conférence du P. Jean-Charles Nault

Retrouver le goût du service de Dieu et des frères
Pèlerinage des Élus Chrétiens
Lourdes
Vendredi 8 avril 2011
Tout d'abord, je voudrais vous dire combien je suis heureux, mais aussi impressionné, de me
trouver avec vous, ce matin, à Lourdes, pour un moment de méditation spirituelle. Je remercie le
Père Matthieu Rougé de m'avoir ainsi convié à vous dire quelques mots, même si je le fais « avec
crainte et tremblement ». C'est aussi, pour moi, l'occasion d'exprimer publiquement ma
reconnaissance et celle de l'abbaye envers Monsieur Charles Revet, pour l'amitié, le soutien et l'aide
précieuse qu'il a toujours témoignés à notre égard, depuis de nombreuses années.
En proposant, comme titre de cette intervention, « Retrouver le goût du service de Dieu et
des frères », le Père Matthieu Rougé semble nous indiquer que nous avons « perdu » quelque chose.
Il s'agit de « retrouver » un goût, une saveur, que nous avons perdus. Comment ne pas penser
immédiatement à ce « dégoût spirituel », ce « dégoût des choses de Dieu » auquel la tradition
spirituelle a donnée, depuis le IV° siècle, un nom étrange : l'acédie ?
Ce n'est ni le lieu ni le moment de faire ici une présentation approfondie de ce phénomène à
la fois complexe et redoutable qu'est l'acédie. Nous pourrons en parler à un autre moment, si vous le
souhaitez. J'ai pensé, cependant, articuler mon propos, ce matin, autour de 3 attitudes spirituelles
fondamentales (la joie, la liberté et la fidélité) dont on peut dire qu'elles sont comme le contre-pied
des trois manifestations principales de l'acédie qui sont : la tristesse, le sentiment d'étouffement et
l'infidélité. « La joie d'être sauvés », « La liberté des enfants de Dieu », « La fidélité du serviteur »,
voilà trois attitudes qui, parmi beaucoup d'autres, peuvent nous permettre, je pense, de « retrouver le
goût du service de Dieu et des frères ».
I. La joie d'être sauvés
Acédie, akèdia en grec, signifie littéralement « manque de soin pour son salut ». L'acédie est
donc le fait de ne plus se préoccuper de sa vie spirituelle, considérée comme un fardeau ou une
exigence qui nous attriste en ce sens qu'elle nous oblige à des renoncements. L'acédie se manifeste
alors comme une véritable tristesse de Dieu (saint Thomas dit « tristesse du bien divin »). Face à
cela, nous sommes appelés à retrouver la joie du salut.
Pour illustrer cette première attitude, je voudrais partir d'un épisode bien connu de l'évangile
de Luc, qui me semble particulièrement bien adapté au temps liturgique que nous vivons : le
carême. Il s'agit de la conversion de Zachée, le chef des collecteurs d'impôts, au chapitre 19 de saint
Luc. Cet épisode se présente comme un texte très bien construit, fait de deux parties bien agencées.
Dans la première, Zachée cherche à voir qui est Jésus et il en prend les moyens. Il réussit à
surmonter son handicap pour obtenir ce qu'il veut : il monte sur un sycomore et attend Jésus qui doit
passer par là.
Dans la deuxième partie, non seulement Zachée réussit à voir Jésus, mais il peut aussi lui

parler. Mieux encore, il le reçoit dans sa maison, il lui offre le gîte et le couvert. Alors, debout,
solennellement, Zachée fait à Jésus sa déclaration de conversion. Il fait un gros don aux pauvres et
répare les torts qu'il a pu commettre. Par la grâce de Dieu, les richesses du publicain deviennent
alors charité et justice. La leçon est claire : il n'y a pas de faute à être riche ; ce qui importe, c'est de
savoir bien user de ses richesses.
Pourtant, une lecture plus attentive peut nous permettre d'entrer plus profondément dans le
mystère du salut, car c'est bien de cela qu'il s'agit.
Zachée semble au centre du récit. Saint Luc n'a guère l'habitude de donner des détails
concernant les personnages qu'il évoque. Mais ici, il nous fait une description assez précise du chef
des publicains, nous révélant qu'il est petit de taille et grand par ses richesses. Bien plus, il nous
indique son nom, Zachée, qui signifie « le pur », « l'innocent ». Est-ce une ironie de Luc? En tout
cas, les habitants de Jéricho ont certainement saisi l'inconvenance de ce nom. Leur réaction violente
en voyant Jésus entrer chez Zachée le montrera bien.
Zachée est monté dans un arbre, pour voir sans être vu, mais Jésus l'interpelle par son nom.
Il descend alors aussi vite qu'il est monté et accueille Jésus chez lui, avec joie. On peut rapprocher
ce texte d'un passage du livre de la Genèse, où Abraham donne l'hospitalité à trois hommes qui lui
apparaissent au chêne de Mambré (Gn 18, 1-14). Dans les deux récits, se trouve un arbre, un chêne
ou un sycomore, tous deux des arbres sacrés. Dans les deux récits, on retrouve le même
empressement à accueillir l'hôte qui s'invite lui-même ; enfin, dans les deux récits, cet hôte
mystérieux est identifié au « Seigneur ». Zachée, comme Abraham, reconnaît dans son hôte la visite
de Dieu.
Car c'est bien la rencontre avec le Seigneur qui provoque la déclaration de conversion, non
pas une belle déclaration de principe, mais bien plutôt une déclaration d'impôts... Zachée reste un
homme d'argent au coeur même de sa conversion : il ne se paie pas de mots, mais de chiffres! Ses
paroles sont des pourcentages : il donnera « la moitié », il rendra au « quadruple ». Le coeur de
Zachée change, mais son argent, lui aussi, change de mains. Zachée, dans le salut qui arrive
aujourd'hui, reconnaît le passé (il a volé) et s'engage pour l'avenir (il va réparer).
On découvre alors la signification profonde de son nom. En effet, Zachée peut se traduire
aussi par « déclaré innocent », « acquitté ». Zachée est sauvé, est innocenté, il est rendu à la dignité
de « fils d'Abraham ».
Mais il faut aller plus loin. Car, en réalité, ce n'est pas Zachée le centre du récit, c'est Jésus.
En effet, deux personnages sont à la recherche l'un de l'autre : si Zachée, le chef des publicains
« cherche » à voir qui est Jésus, Jésus, lui, « Le Fils de l'homme », déclare être venu « chercher » ce
qui est perdu, les publicains et les pécheurs. Cherchant à voir Jésus, Zachée fait ce qu'il faut pour
renverser la situation : il n'hésite pas à monter dans un arbre pour voir celui qu'il cherche. Mais
arrivé sous le sycomore, il n'est pas dit que Zachée voit Jésus mais l'inverse ; c'est Jésus qui « lève
les yeux » vers lui, car lui aussi le cherche. Jésus prend l'initiative. Il se fait mendiant pour donner
sans blesser. Il s'adresse au publicain comme un simple prédicateur ambulant en quête de son dîner :
« Zachée, descends vite ». Il y a dans cette hâte du Christ une sorte d'humour plein de tendresse, un
peu comme si le Seigneur voulait lui dire : Zachée, j'ai faim, dépêche-toi, comme il avait dit à la
Samaritaine ; j'ai soif, donne-moi à boire! En réalité, je suis surtout impatient de me trouver dans ta
demeure pour que s'accomplisse en toi le mystère de salut que je suis venu apporter au monde.
Jésus lève les yeux, comme il le fait lorsqu'il s'adresse à son Père. Et le premier mot qu'il
prononce, c'est le nom de Zachée. Jésus le rétablit dans sa dignité d'homme, il le remet « debout »,
l'attitude de la prière et de la familiarité avec Dieu. Le chef des publicains se perdait dans
l'anonymat de la foule, il est rétabli dans sa dignité de « fils d'Abraham », héritier de la promesse.
La foule empêchait Zachée de voir Jésus. Elle voudrait maintenant empêcher Jésus d'aller loger
chez Zachée. Mais Jésus réfute publiquement l'opinion soutenue par les Rabbis selon laquelle les
pécheurs publics ne peuvent prétendre au salut. « Aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette
maison ». C'est Jésus, le salut en personne, qui est entré chez Zachée, Jésus, celui qui « est venu

pour sauver ». Le salut pour Zachée, certes, mais aussi, par voie de conséquence, pour les pauvres et
ceux qui avaient été dépouillés. Zachée cherchait à voir Jésus ; toute l'action de Jésus consiste à lui
ouvrir les yeux sur les autres. Renvoyé à lui-même, il est aussi renvoyé à ses frères, les pauvres, il
est envoyé en mission.
Tel est le mystère bouleversant de notre salut. Nous cherchons à voir Jésus, mais nous
découvrons que c'est Jésus lui-même qui nous cherche, qui nous poursuit de son amour. Nous
voulons monter pour rencontrer Dieu, mais nous découvrons que c'est Dieu lui-même qui est
descendu pour planter sa tente parmi nous. Comme l'écrivait saint Irénée de Lyon, au II° siècle,
« Le Verbe de Dieu qui a habité parmi l'homme, s'est fait fils de l'homme pour habituer l'homme à
recevoir Dieu, et pour habituer Dieu à demeurer parmi l'homme, selon le bon plaisir du Père ».
À chacun de nous, Dieu dit : « Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi ». Dans
l'Eucharistie, Jésus vient frapper à la porte de notre coeur : « Voici que je me tiens à la porte et que
je frappe : si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de
lui et lui près de moi » (Ap 3, 20). Si nous ouvrons la porte de notre coeur, Jésus viendra vraiment
« demeurer » chez nous. Mais Jésus est aussi le vrai Temple, le seul et unique sanctuaire, d'où coule
la fontaine de l'eau vive jaillissant pour la vie éternelle, c'est lui qui vient sanctifier notre demeure
lorsque nous ouvrons notre coeur pour accueillir sa Parole et que nous le recevons dans
l'Eucharistie.
Jésus, c'est toi le vrai Zachée, c'est toi, le Pur et l'Innocent, qui es mort pour les coupables
que nous étions et qui n'attends qu'une chose : que nous te recevions avec joie.
II. La liberté des enfants de Dieu
Au IV° siècle, Evagre le Pontique insiste sur la double dimension de l'acédie : une
dimension spatiale (le sentiment d'être à l'étroit) et une dimension temporelle (le sentiment que le
temps s'est arrêté). Arrêtons-nous, pour l'instant, sur la dimension spatiale. L'acédie se présente
comme un sentiment d'étouffement, un sensation d'être à l'étroit dans le lieu – qu'il soit
géographique, psychique ou spirituel – où l'on se trouve. L'acédie engendre alors la tentation de
quitter le lieu, mais aussi de transgresser les limites, d'acquérir une liberté conçue comme une
absence de contraintes.
Face à cette acédie, nous sommes appelés retrouver la véritable liberté, la liberté des enfants
de Dieu. Ici, peut nous éclairer le texte de Rm 8, 14-15 : « Tous ceux qui sont mus par l'Esprit de
Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Aussi bien n'avez-vous pas reçu un esprit d'esclaves pour retomber
dans la crainte ; vous avez reçu un esprit de fils adoptifs, qui nous fait nous écrier : Abba, Père ! ».
Cette question de la liberté me semble d'une telle importance et d'une telle actualité, que je
souhaiterais m'y arrêter un peu.
On peut dire que l'un des plus grands bouleversement de la pensée chrétienne a pour origine
la question de la liberté. C'est, en effet, au XIV° siècle que le franciscain Guillaume d'Ockham
(1300-1350) élabore, en opposition à saint Thomas d'Aquin, une nouvelle conception de la liberté,
qu’il appelle « liberté d’indifférence » (libertas indifferentiæ). Pourquoi ce nom ? Parce que, selon
lui, l’homme est dans une indétermination totale, dans une indifférence totale, face au bien ou au
mal.
Il faut bien réaliser que nous sommes, aujourd'hui, tellement marqués par cette conception,
que nous avons de la difficulté à nous représenter la liberté autrement que comme la possibilité de
choisir entre des contraires. Or cette nouvelle conception élaborée par Ockham est une véritable
révolution par rapport à la conception classique de la liberté. Pour la tradition philosophique et
théologique, et saint Thomas d'Aquin en particulier, la liberté est le pouvoir qu’a l’homme –
pouvoir qui appartient conjointement à l’intelligence et à la volonté – d’accomplir des actions de
qualité, des actions bonnes, des actions excellentes, des actions parfaites, quand il veut et comme il

veut. La liberté de l’homme est donc, selon lui, la capacité qu’il a d’accomplir facilement,
durablement et joyeusement, des actes bons. Cette liberté est définie par l’attrait du bien.
Guillaume d'Ockham, lui, fait de la liberté un moment « antérieur » à l’intelligence et à la
volonté. L’homme n’est plus du tout attiré par le bien. Il se trouve dans une indifférence totale face
au bien et au mal. Pour qu'il puisse choisir entre bien et mal, il va donc falloir l’intervention d’un
élément extérieur, qu'Ockham identifie avec la loi. Désormais, selon cette conception, c'est
l'obéissance à la loi qui va définir le bien : « c'est bien parce que la loi me le demande » et non plus
« la loi me le demande parce que c'est bien ». Nous sommes ici en présence d'une véritable
révolution.
S’il n’y a plus d’attrait qui nous pousse vers le Bien, cela veut dire que l’homme n’a plus en
lui ce que saint Thomas appelait les « inclinations naturelles » et dont il faisait une pièce maîtresse
de sa doctrine morale. De par sa création à l'image et à la ressemblance de Dieu, l’homme
naturellement est orienté vers le Vrai, vers le Bien, vers Dieu, vers l’union au sexe opposé, vers la
conservation de la vie. Ockham, lui, rejette les inclinations naturelles. Elles lui semblent porter
atteinte à sa liberté. Il pense que si l’homme est naturellement orienté vers le Bien, alors il n’est plus
libre.
Qu’est-ce qui va désormais amener l’homme à choisir ? Il faut un élément extérieur,
extrinsèque, qu'Ockham identifie avec la loi de Dieu. Cependant, selon lui, cette loi de Dieu n'a pas
de relation intrinsèque, intérieure, avec le bien. Elle est le fruit de la liberté divine, qui est le
summum de l’indifférence. Pour Ockham, Dieu a décrété des commandements dans le Décalogue
par indifférence. Il aurait pu dire autre chose. Il aurait pu dire : « tu dois tuer », « tu dois commettre
l’adultère », et c’est cela qu’il aurait fallu faire. Ici naît la morale de l’obligation. Puisque la bonté
de l’agir n’est plus à l’intérieur de cet agir, il faut un élément extérieur qui vienne le pousser à
choisir. Cet élément, c’est la loi de Dieu. L’homme agit en fonction d’une loi qui n’est plus inscrite
en lui, qui lui est totalement extérieure, qui est totalement arbitraire et que l’homme ne doit
accomplir que par décret de Dieu.
Qu’y a-t-il de pervers dans ce raisonnement ? Au début, rien ne change concrètement. On
continue de suivre la loi du Décalogue. Ce qui change, c’est la raison pour laquelle on le fait. On ne
suit pas le Décalogue parce qu’il y a une bonté interne au commandement. On suit le Décalogue
simplement parce que Dieu le commande, indépendamment d’une valeur bonne en elle-même. Mais
le jour où l’autorité de Dieu est remise en cause, tout s’arrête : qui est Dieu pour m’imposer cela,
finalement ?
La morale kantienne poussera encore plus loin le point de vue d’Ockham : la bonté de l’acte
vient uniquement de son caractère obligatoire, au point que si jamais l’homme trouve un peu de
plaisir dans ce qu’il fait, l’acte n’est plus moral. Plus c’est obligatoire, plus ça contrarie les
aspirations profondes de l’homme, meilleur c’est. Le jansénisme vient très facilement s’engouffrer
là-dedans.
A l'apparition du positivisme, la Loi de Dieu sera remise en cause : « Qui donc est Dieu pour
m'imposer sa Loi ? » Le critère du bien deviendra alors la loi civile. Plus tard encore, lorsque la loi
civile sera elle-même remise en cause, on se mettra autour d'une table et on essaiera de trouver un
« consensus ». Vous voyez comment les questions de bio-éthique sont au cœur de cette
problématique.
Face à cette perversion de la liberté, considérée comme la possibilité de choisir et la
possibilité de « transgresser » , il nous faut redécouvrir la vraie liberté des enfants de Dieu, qui est
la liberté de faire le bien, c'est-à-dire une liberté de qualité.
Selon cette conception de la liberté, la loi n'est plus le critère du bien, mais elle est un
pédagogue qui aide à faire le bien. Bien plus, l'homme possède en lui une autre Loi, une loi de
liberté, qui est l'Esprit Saint lui-même. L'Esprit Saint vient nous guider de l'intérieur vers la vérité
tout entière. Dans ce cas, il n'y a plus de contradiction, d'opposition, entre liberté et loi. La loi
intérieure n'est pas là pour contraindre ma liberté, mais pour m'aider à devenir vraiment libre.
En commentant Rm 8, 14 que je vous citais tout à l'heure, saint Thomas d'Aquin a des

phrases magnifiques. Voici ce qu'il dit, substantiellement. La traduction de Rm 8, 14 qu'il avait sous
les yeux disait ceci : « Qui Spiritu Dei aguntur, hi sunt filii Dei », c'est-à-dire : « Ceux qui sont agis
par l’Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu ». Saint Thomas s’intéresse au passif « aguntur ».
Quels sont ceux qui « sont agis » ? se demande-t-il. Il répond : ce sont les animaux, qui sont agis,
mus, par leurs instincts. Ils ont faim, ils mangent. Ils ont soif, ils boivent. Ils ont envie de se
reproduire, ils se reproduisent. L’homme au contraire, en tant qu'être créé à l'image et à la
ressemblance de Dieu, est maître de ses actes. Les hommes « agunt », ils agissent. Mais les saints,
les spirituels, s'ils agissent (agunt) en tant qu’hommes, de nouveau ils sont agis (aguntur), mais
cette fois ils le sont par un instinct qui n’est plus charnel, mais par l'instinct du Saint-Esprit
(instinctus Spiritus Sancti). Celui-ci nous configure au Fils, pour que nous soyons fils dans le Fils.
Toute notre vie morale, c’est donc de nous laisser agir par l’Esprit. Et c’est le don de la sagesse qui
nous aide à le faire, nous donnant une « connaturalité » avec le bien qui nous permet de sentir les
choses comme Dieu les sent. N'est-ce pas magnifique ?
Pour illustrer encore cela, je voudrais vous dire quelques mots sur la Vierge Marie, puisque
nous sommes à Lourdes, plus particulièrement sur le mystère de l'Immaculée Conception. Depuis
des siècles, nous respirons, dans l'air ambiant, ce soupçon qu'une personne qui ne pèche pas du tout
est au fond ennuyeuse ; que quelque chose manque à sa vie ; on nous fait croire subtilement qu'être
véritablement hommes comprend également la liberté de dire non, de descendre au fond des
ténèbres du péché et de vouloir agir tout seuls ; on veut nous faire croire que si nous faisons
toujours le bien, nous perdons notre liberté.
Cependant, le mystère de l'Immaculée Conception nous fait comprendre, au contraire, que
l'homme qui s'abandonne totalement entre les mains de Dieu ne devient pas une marionnette, une
personne consentante et ennuyeuse, qui perdrait sa liberté. Car, en réalité, seul l'homme qui se remet
totalement à Dieu trouve la liberté véritable, découvre l'ampleur vaste et créative de la liberté du
bien. L'homme qui se tourne vers Dieu ne devient pas plus petit, mais plus grand, car grâce à Dieu
et avec Lui, il devient vraiment lui-même. Plus encore, il est appelé à devenir Dieu par
participation. Et c'est lorsqu'il sera totalement participant de la nature divine, qu'il sera pleinement
lui-même, qu'il sera pleinement libre. D'autre part, l'homme qui se remet entre les mains de Dieu ne
s'éloigne pas des autres en se retirant égoïstement dans le bien ; au contraire, ce n'est qu'alors que
son coeur s'éveille vraiment et qu'il devient une personne sensible et donc bienveillante et ouverte à
tous.
Plus l'homme est proche de Dieu et plus il est proche des hommes. Nous le voyons
précisément en Marie. Le fait qu'elle soit totalement auprès de Dieu est la raison pour laquelle elle
est également si proche de tous les hommes. La gloire de Dieu dont elle est participante abolit toute
distance et a pour effet de la rendre présente à chacun de nous, à tout moment de son existence,
comme si chacun de nous était pour elle unique au monde.
Telle est la liberté à laquelle nous sommes appelés : la liberté des enfants de Dieu.
III. La fidélité du serviteur
La deuxième dimension de l'acédie est une dimension temporelle, nous l'avons dit. Selon
cette dimension, l'acédie se présente comme une incapacité de durer, de persévérer. L'esprit
d'acédie, démon de midi, vient nous faire regretter de nous être engagés. Au milieu de la journée, ou
au milieu de la vie, nous sommes tentés de désespérer devant l'apparente infécondité de notre
« matinée ». Arrive alors la tentation de remettre en cause notre engagement et de penser qu'il est
encore temps de « faire autre chose ». Face au découragement et à la tentation d'infidélité, nous
sommes appelés à redécouvrir la fidélité de Dieu et, en particulier, la fidélité du serviteur.
Pour illustrer cette troisième attitude, je voudrais revenir sur un texte fondamental qui, là
encore, est particulièrement adapté à la période que nous vivons liturgiquement : il s'agit du récit du
lavement des pieds, au chapitre 13 de l'évangile de Jean.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%