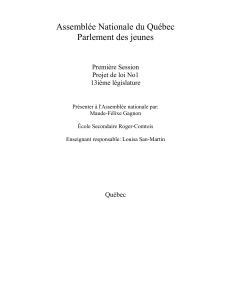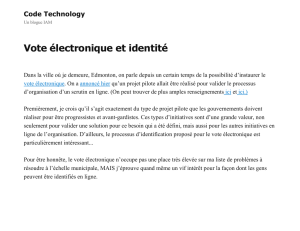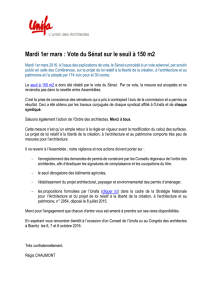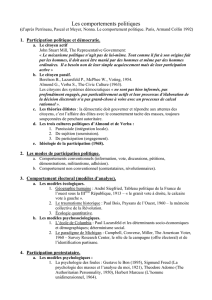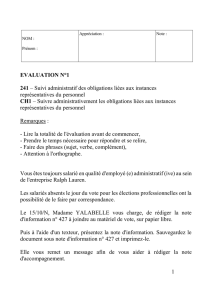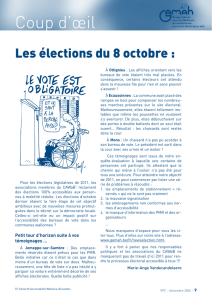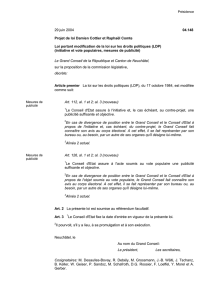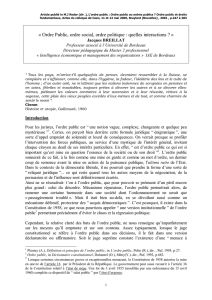Document 1 – Les avantages du vote républicain : « La IIIème

Document 1 – Les avantages du vote républicain :
« La IIIème République (1875-1940) a mis en place une « entreprise d'acculturation qui vise à récuser certaines formes populaires du
politique issues d'un passé sans âge. […] L'école publique jouera ici un rôle primordial. En dénonçant certaines manifestations de violence comme
des stigmates d'une mentalité "archaïque" ou "primitive", les manuels scolaires vont contribuer à faire du vote la seule expression politique
compatible avec l'exigence de dignité citoyenne. L'entreprise de rationalisation des comportements ainsi engagée apparaît donc comme le
prolongement inévitable de l'impératif politique d'échapper à la violence.
« Le souci de promouvoir une expression électorale sincère et rationnelle se confond dans la littérature scolaire avec la volonté d'inculquer
au futur citoyen une image valorisante de ses devoirs d'électeur. Cet apprentissage vise in fine à modifier le comportement des enfants et de leurs
parents afin de les sensibiliser à la gravité d'une telle procédure. […] La participation politique attendue du citoyen se résume donc à une activité
spécifique : celle par laquelle les membres de la Nation prennent collectivement part à la sélection des dirigeants et participent indirectement à la
formation des politiques publiques.
« Le vote devient, ce faisant, la forme légitime sinon exclusive de la participation citoyenne. Les républicains n'ont de cesse de le présenter
comme un acte pacifique, organisé, régulier et prévisible ; un acte en tout point opposé aux formes "primitives" de participation politique définies
elles comme violentes, inorganisées et irrégulières. Ce renversement a une valeur symbolique exemplaire qu'illustre la substitution imaginée entre le
fusil et le bulletin de vote. […] "Dans la République, le gouvernement est confié pour un temps à des hommes élus par leurs concitoyens et
responsables de leurs actes. Si le pays est content d'eux, il les maintient au pouvoir ; s'il n'en est pas content, il les change, sans bruit, sans violence,
par le seul effet de ses suffrages. Dans une monarchie, on n'arrive à se débarrasser d'un maître, oppresseur ou injuste, qu'au moyen d'une révolution ;
le fusil est l'instrument de la délivrance. Dans une république, l'arme toute puissante au moyen de laquelle on arrive à conquérir toutes les libertés et
réaliser tous les progrès, c'est le bulletin de vote". […]
« En stigmatisant une violence devenue illégitime, les manuels diffusent ce que l'on pourrait appeler l'idéologie du consensus majoritaire :
le suffrage universel et, en particulier, la règle majoritaire, fondent seuls désormais la légitimité des gouvernants. La possibilité d'une alternance
régulière est présentée comme devant inciter les citoyens à la patience. Investi de toutes les espérances, le bulletin de vote devient "l'arme" par
excellence du changement social ». Y. Déloye & O. Ihl, « La civilité électorale : vote et forclusion de la violence en France »
in Braud P., La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, 1993
Question 1 : Par quelle institution les citoyens français ont-ils été principalement socialisés au vote ?
Question 2 : Quelles sont les caractéristiques politiques, c'est-à-dire relatives à la communauté, du vote ?
Question 3 : Quels sont les avantages du vote relativement aux autres formes de participation politique, comme la rébellion armée ?
Document 2 – Les lois sur la protection sociale qui accompagnent la condition ouvrière :
NB : entre 1883 et 1889, le chancelier allemand Bismarck met en
place un système de protection sociale fondé sur l’assurance des
risques des ouvriers.
1898 : Loi sur les accidents du travail.
1910 : Loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Des caisses de
retraite sont organisées par l’Etat mais l’âge légal de la retraite est
fixé à 65 ans alors que l’espérance de vie moyen des ouvriers est de
50 ans.
1928-1930 : Loi sur les assurances sociales pour couvrir notamment
les risques liés à la maladie, la vieillesse, la maternité. Ces assurances
sociales fonctionnent par l’achat de titres financiers. Le crash de
1929 qui touche la France vers 1932 fera diminuer radicalement le
montant des revenus de transfert.
1932 : Création des allocations familiales gérées par l’Etat.
1938 : Mise en place du Code de la famille.
Document 3 – Les lois sur la protection sociale accompagnant la condition salariale :
NB : en 1942, le chercheur anglais William Beveridge publie un
rapport défendant le principe d’une Sécurité sociale universelle
constituant un filet de sécurité minimal pour la population, rapport
qui sera mis en œuvre à partir de 1945 par le parti travailliste
nouvellement élu
1945-1946 : Lois et ordonnances créant la Sécurité Sociale (maladie,
maternité et famille, retraite)
1947 : Extension des lois de Sécurité Sociale aux fonctionnaires.
1948 : Régime d’assurances vieillesse pour différentes professions
d’indépendants (artisans, professions industrielles et commerciales,
professions libérales)
1958 : Régime chômage (UNEDIC)
1967 : Création de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE)
1975 : Généralisation de l’assurance vieillesse à toute la population
active
1976 : Allocation de parent isolé (API)
1988 : Revenu Minimum d’Insertion (RMI)
Document 7 – Les gains privés et publics d’un système universel de crèches :
NB : Les calculs ont été faits à partir des caractéristiques fiscales du Danemark.
G. Esping-Andersen, Trois leçons sur l’Etat-Providence, 2008

Document 4 – La « nouvelle question sociale » :
« On peut interpréter la question sociale telle qu’elle se pose aujourd'hui à partir de l’effritement de la condition salariale. La
question de l’exclusion qui occupe le devant de la scène depuis quelques années en est un effet […]. La salariat a longtemps campé
aux marges de la société [, du Moyen-Âge à la Révolution Industrielle] ; il s’y est ensuite installé en demeurant subordonné [, c’est la
condition prolétarienne] ; il s’y est enfin diffusé [, c’est la condition ouvrière], jusqu’à l’envelopper de part en part pour imposer
partout sa marque [, c’est la condition salariale]. Mais c’est précisément au moment où les attributs attachés au travail […]
paraissaient s’être imposés définitivement au détriment des autres supports de l’identité, comme l’appartenance familiale ou
l’inscription dans une communauté concrète, que cette centralité du travail est brutalement remise en question. […] La nouveauté, ce
n’est pas seulement le retrait de la croissance ni même la fin du quasi-plein-emploi, à moins qu’on n’y voie la manifestation d’une
transformation du rôle de ‘‘grand intégrateur’’ joué par le travail. Le travail, on l’a vérifié tout au long de ce parcours, est plus que le
travail […]. Aussi la caractéristique la plus troublante de la situation actuelle est-elle sans doute la réapparition d’un profil de
‘‘travailleurs sans travail’’, lesquels occupent littéralement dans la société une place de surnuméraires, d’inutiles au monde ».
Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, 1995
Document 6 – Les effets redistributifs des services publics :
« Globalement, les deux approches [utilisées] mettent en évidence un certain nombre de tendances générales qui cadrent, à
quelques exceptions près, avec celles constatées lors de recherches antérieures. Les dépenses publiques au titre des services sociaux
aux ménages (santé, éducation et logement social) réduisent sensiblement les inégalités […]. La contribution globale des services
publics à la réduction des inégalités dans la distribution des ressources économiques des ménages tient essentiellement à une
répartition relativement uniforme de ces services entre quintiles de revenu, qui se traduit par une majoration plus importante des
ressources au bas de la distribution qu’en haut de celle-ci. [… De plus,] la réduction des inégalités attribuable aux services publics en
nature est, en moyenne, inférieure à celle résultant de l’effet combiné des prélèvements fiscaux et des transferts monétaires publics,
même si ce n’est pas le cas dans tous les pays [comme en France notamment]. OCDE, Croissance et inégalités, 2008
Montant moyen des transferts en nature par équivalent adulte :
Bonnefoy et al. « La redistribution en 2009 », France. Portrait social, Edition 2010
Question 1 : A partir de ce document et du documents 6 page 221, dressez le constat des effets redistributifs des services publics
(santé, éducation, logement social). Pour ce faire, n’hésitez pas à citer les textes ou à citer des chiffres du document.
Document 5 :
Goutard & Pujol, « Les niveaux de vie en
2006 », INSEE Première n°1203, 2008
Document 9 – La tendance contemporaine à l’ ‘‘activation’’
des politiques publiques :
« La troisième voie, dans laquelle s’inscrit le projet d’un État social actif,
se présente comme une voie qui transcende l’opposition gauche-droite, comme une
critique simultanée de l’État-Providence qui survit en Europe continentale et d’une
vision libérale de l’État telle qu’elle s’est développée dans les pays anglo-saxons.
La thèse est, en résumé, la suivante : s’il s’agit de maintenir en Europe l’ambition
d’une protection sociale, il faut acter l’incapacité de l’État-Providence à résoudre le
problème du chômage et de l’exclusion sociale […]. Dans ces conditions, pour
éviter qu’une logique d’assurance cède progressivement le pas à une logique
d’assistance, la promotion de l’emploi doit devenir l’objectif principal de la
politique sociale. La méthode privilégiée pour y parvenir est celle de l’
“activation”. Pas de droit sans responsabilités, tel serait le principe fondamental de
la troisième voie. Il se fonde sur l’opposition, popularisée depuis de nombreuses
années par l’OCDE, entre les politiques d’emploi “passives” et “actives”. Tandis
que les premières désignent les politiques traditionnelles d’indemnisation des
chômeurs, les secondes se rapportent aux multiples dispositifs visant
l’augmentation du taux d’emploi : orientation et formation professionnelle,
subsides à l’emploi, abaissement du coût du travail par abattements des cotisations
patronales de sécurité sociale.
I. Cassiers, « De l’Etat-Providence à l’Etat Social Actif :
quelles mutations sous-jacentes ? », Regards Economiques n°36, 2005
Question 1 : Définissez la tendance actuelle des politiques publiques à partir de ce
texte. N’hésitez pas à faire un relevé précis des termes employés par l’auteur pour
désigner les évolutions.

Document 8 – Effet global des prélèvements fiscaux et de la redistribution
par le biais des revenus de transferts publics et de prestations en nature :
INSEE, France : Portrait Social, 2008
Question 1 : Etant donné l’ordre de succession des lignes, essayer de supposer comment est calculé le revenu net ? Le revenu disponible ? Le revenu
ajusté ? Le revenu final ?
Question 2 : Calculez le rapport interquintile pour chacun de ces niveaux de revenu. Que concluez-vous sur la redistribution et ses différentes étapes
en France ?
Document 10 – Quel est l’implicite politique de l’activation des politiques publiques ?
« Le caractère relativement imprécis des catégories auxquelles se réfère le discours sur l’Etat Social Actif incite à s’interroger sur ses
fondements théoriques implicites, et en particulier sur les représentations économiques qui sous-tendent ce projet. […] Si la globalisation financière
est actée, elle n’est tenue pour responsable ni de l’apparition d’une crise de l’État-Providence, ni de l’abandon des politiques keynésiennes. […]
L’accentuation des pressions de la concurrence est perçue comme un fait inéluctable des sociétés contemporaines. Il n’appartient pas aux pouvoirs
publics de chercher à les limiter, fussent-elles génératrices d’inégalités fortes. Le principe d’une égalité de résultat est d’ailleurs abandonné au profit
de celui d’une égalité des chances. Le rôle de l’État ne serait pas tant d’assurer une redistribution des revenus que de garantir à chaque individu une
même “employabilité”, la participation au marché du travail étant perçue comme le fondement de l’inclusion dans la société. […]
« Cet examen des fondements implicites tant du discours sur l’ESA que des pratiques qu’il engendre suggère que ce projet adhère de facto
à la doctrine d’une des deux voies qu’il prétend transcender, ce qui explique sans doute les résistances rencontrées dans sa mise en application […]
En considérant la globalisation financière comme une donnée, en acceptant comme inéluctable ou souhaitable la passivité dans d’autres registres de
la politique économique, en concevant l’activation de la politique sociale comme une mise en conformité des personnes vis-à-vis des exigences du
marché, l’ESA ne contribue-t-il pas à consacrer la primauté de l’économique sur le politique ? ».
I. Cassiers, « De l’Etat-Providence à l’Etat Social Actif : quelles mutations sous-jacentes ? », Regards Economiques n°36, 2005
« L'exemple du RSA est sur ce point particulièrement significatif. Pour réduire le chômage de longue durée, dont de nombreux allocataires
des minima sociaux sont victimes, on postule qu'il est souhaitable pour eux de pouvoir cumuler un petit revenu d'activité et une allocation
d'assistance. On crée donc officiellement un nouveau statut : celui de travailleur précaire assisté. Si l'on peut espérer que, pour certains, ce statut ne
sera qu'un pis-aller temporaire avant d'accéder à un emploi stable non assisté, on peut déjà craindre que le RSA participe à un mode généralisé de
mise au travail des plus pauvres dans les segments les plus dégradés du marché de l'emploi. […] Ce qu'il faut redouter, c'est l'institutionnalisation par
les pouvoirs publics d'un sous-salariat déguisé. […] Cette mesure apparaît plus légitime car elle concerne des pauvres dont on pense qu'ils ont intérêt
à se satisfaire de ce nouveau statut, mais n'est-ce pas une façon de les obliger à entrer non pas dans le salariat, mais dans ce que l'on appelle
aujourd'hui de plus en plus le « précariat » ? On officialise ainsi l'abandon de la notion de plein-emploi, remplacée ainsi de façon manifeste par celle
de « pleine activité ». […] Il existait avant le RSA des travailleurs pauvres obligés de recourir ponctuellement — ou, parfois même, de façon
régulière — à des aides de l'assistance, mais désormais ce statut intermédiaire n'aura plus ce caractère d'exception. Il sera pleinement reconnu,
d'autant qu'aucune limitation de durée n'a été prévue pour pouvoir en bénéficier ». S. Paugam & N. Duvoux, La régulation des pauvres, 2008
Question 1 : A partir des 2 textes, montrer quels sont les acteurs économiques (APU, entreprises, ménages) à qui on demande un effort particulier
dans les politiques d’activation.
1
/
3
100%
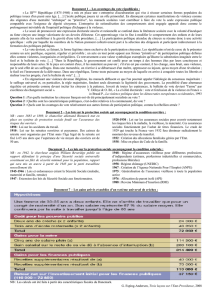
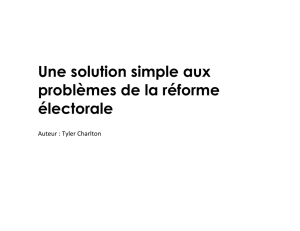
![[Bureau] Compte rendu du 12-06-2014](http://s1.studylibfr.com/store/data/007048285_1-042dc82a502a1186b6515db43dedac7a-300x300.png)