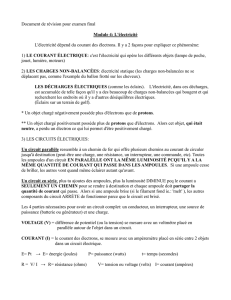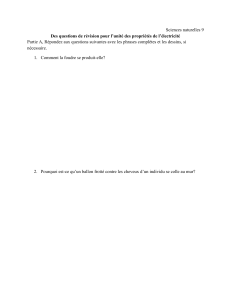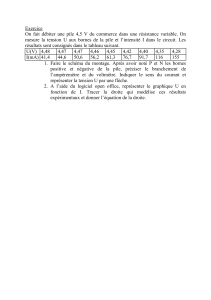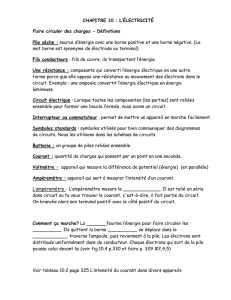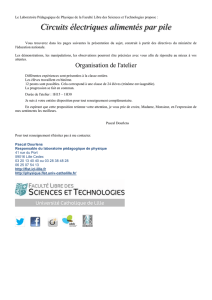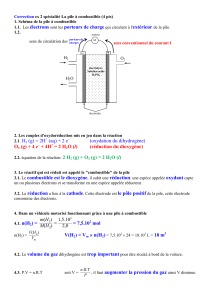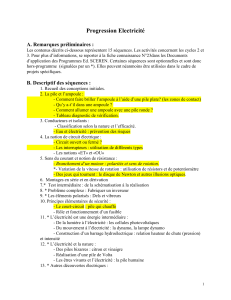L`électricité, c`est avant tout une histoire de charges

L’ELECTRICITE, QU’EST-CE QUE C’EST ?
L'électricité, c'est avant tout une histoire de charges. Il existe deux types de charges, les
charges positives et les charges négatives. Les charges de signe contraire s’attirent et celles de
même signe se repoussent. Toute matière contient des charges. Lorsqu'un corps possède
autant de charges positives que négatives, on dit qu'il est neutre. Si l'on modifie cet équilibre,
il devient chargé. Il acquiert alors des propriétés attractives ou répulsives et interagit avec les
corps chargés qui l'entourent. L'électricité décrit l'ensemble des phénomènes causés par les
charges.
On distingue généralement l'électricité statique ou électrostatique, qui traite de l'interaction de
charges en équilibre, de l'électrocinétique qui traite de charges en mouvement dans un circuit
électrique. Historiquement, la première avait déjà été mise en évidence par Thalès au VI°
siècle avant JC tandis que la seconde ne connaîtra un véritable essor qu'après l'invention de la
pile par Volta en 1800.
L'électrostatique
Contrairement à ce que pourrait
laisser entendre son nom,
l’électrostatique n’est pas une
électricité statique. Bien au contraire,
les charges sont sujettes à l’influence
électrique de leurs semblables. Sous
l’effet de cette influence, les charges
se repoussent ou s’attirent suivant
leur nature. Au brushing nos cheveux
se dressent sur la tête, parce que
chacun est un isolant de même charge
qui repousse son voisin. Certains
vêtements accumulent des charges
statiques; dès qu'on touche
un conducteur métallique (ou une
autre personne), elles s'évacuent, ce
qui crée un courant que nous
percevons comme une décharge
électrique (pas dangereux, mais plutôt
désagréable !) Des charges
s'accumulent aussi parfois entre deux
conducteurs plats séparés par une
couche d'isolant : cela constitue un
condensateur qui peut stocker une
petite quantité d'électricité.

Électrocinétique
L'électrodynamique que l'on associe communément à l'électricité, met en jeu des charges mais
cette fois, en mouvement dans un circuit électrique de façon permanente. Elles forment alors
un courant électrique. Pour que ce courant puisse exister, il faut que le circuit soit fermé et
contienne au minimum un matériau conducteur pour guider les charges, un générateur (une
pile, une dynamo, le secteur..) pour les animer et un récepteur pour les utiliser. Le générateur
possède au moins deux pôles, un pole négatif et un pôle positif. Ces deux pôles mettent en
mouvement des charges dans le circuit. Avec un générateur et un fil conducteur, on peut faire
fonctionner toute une gamme de récepteurs : des ampoules, des appareils électroménagers,
des puces d'ordinateurs, des transistors…
A l'échelle atomique
On peut aussi essayer de comprendre l'électricité en scrutant la matière à une échelle
microscopique, celle de l'atome. Au centre de chaque atome, on trouve un noyau qui contient
des particules appelées protons dont la charge est positive. Autour de ce noyau, tournoie un
nuage d'électrons chargés négativement. Les protons et les électrons s'attirent, c'est ce qui
maintient ces derniers dans le giron du noyau. Les électrons les plus faiblement liés sont
susceptibles de sortir de cette " sphère d'influence ". Ils se déplacent alors dans la matière, se
regroupent dans une direction privilégiée et peuvent parfois sauter jusqu'à l'atome voisin. La
charge ou la répartition de charges du corps est alors modifiée. C'est ce déplacement de
charges que nous nommons l'électricité....

QUELQUES INVENTIONS
La pile a été inventée par le savant italien Alessandro Volta en 1800. Cette date constitua un
tournant pour le siècle, mais également pour l’histoire de l’électricité. La pile de Volta est en
effet la première source d’électricité qui permet d'avoir dans un circuit du courant continu.
Elle doit son nom à sa forme originelle, un empilement régulier de disques de cuivre et de
zinc séparés par un carton imprégné d’eau salée. Les disques de cuivre et de zinc sont appelés
électrodes de la pile et la solution de sel, l’électrolyte. Ce sont les réactions chimiques entre
ces différents composants qui vont donner naissance à de l’électricité.
Comment cela se passe-t-il ?
En contact avec la solution, l’électrode de cuivre perd des électrons et devient donc chargée
positivement. C’est le pôle plus. À l’inverse, l’électrode de zinc se dissout dans la solution et
garde des électrons. Cette électrode devient alors chargée négativement. C’est le pôle moins.
Il existe une tension entre les deux pôles de la pile. Celle-ci est ainsi capable d’engendrer un
mouvement continu d’électrons. Les électrons passent du pôle moins au pôle plus par le
circuit électrique puis à l'intérieur de la pile du pôle plus au pôle moins par le biais de la
solution qui constitue l'autre partie du circuit. La boucle est alors bouclée et l’électricité créée.
La cathode se recompose en permanence car elle récupère des
électrons amenés par le circuit pour reconstituer le cuivre ayant
réagi avec la solution. Seule l’électrode de zinc est
consommée. Le processus peut donc continuer jusqu’à ce que
cette électrode soit complètement dissoute.
La tension aux bornes de la pile dépend de la nature des
éléments utilisés. En superposant plusieurs disques, Volta
réussit à obtenir 24V.
En 1866, le chimiste Georges Leclanché va améliorer ce
système en substituant l’électrode de cuivre par une tige de
charbon, et la solution de sel par une gelée d’oxyde de
manganèse et de grains de charbon. La pile est ainsi plus
compacte et surtout transportable. La pile moderne est née.
Elle subira différents avatars : la pile ronde avec une tige de
graphite au centre, les piles alcalines qui utilisent l’oxyde de
mercure comme électrolyte, ou encore la pile bouton qui
équipe nos montres et nos calculatrices
Le télégraphe fut une des premières applications industrielles de l’électricité. Les premiers
télégraphes s’apparentent à un gigantesque circuit électrique alimenté par une simple batterie.
Un interrupteur permet d’ouvrir ou de fermer le circuit. Lorsque le circuit est fermé, le
courant passe et se propage dans les fils. À l’autre bout de la ligne, un système de détection
prévient l’opérateur du passage du courant. Le père de cette invention, Samuel Morse, mit
également au point le célèbre alphabet de traits et points qui garda son nom. En voici un
échantillon :

On doit cette brillante et lumineuse invention à l’américain Edison et à
l’anglais Swan. Les ampoules les plus courantes (celles des lampes de
poche) sont dites "à incandescence". Un filament de tungstène (métal), long
et fin, est chauffé par le passage d’un courant électrique. Lorsque sa
température atteint 3000°C, il brille en émettant de la lumière. Ce filament
est protégé de l’air, au contact duquel il brûlerait très rapidement, par une
ampoule de verre scellée dans laquelle on a fait le vide puis introduit un gaz
inerte comme l’argon ou le krypton, permettant d’éviter la détérioration du
filament. En moyenne, une ampoule classique peut briller pendant mille
heures. Sa puissance électrique se mesure en Watt. Plus le nombre est élevé,
plus la lumière émise est forte, et la consommation d’électricité importante.
On peut également produire de la lumière avec un tube fluorescent. Celui-ci
na pas de filament mais enferme une petite quantité de gaz qui conduit
l’électricité. Si on applique une tension aux bornes de ce tube, le gaz émet
une lumière ultraviolette invisible qui éclaire une mince couche d’enduit
luminescent (généralement du phosphore) déposée sur la paroi interne du
tube. Sous l’effet de cette irradiation, l’enduit émet alors de la lumière.
Pour répondre à la consommation croissante d’électricité, il a
fallu inventer et construire des usines capables de produire de
l’électricité en grande quantité. En France, les trois principaux
modes de production sont les centrales nucléaires, les
centrales thermiques à combustibles fossiles (charbon, pétrole,
gaz) et les centrales hydroélectriques. La turbine et
l’alternateur sont les deux pièces maîtresse de ces générateurs
d’électricité. Dans le cas des usines thermiques, la turbine est
entraînée par la vapeur produite dans les chaudières où l’on
brûle les combustibles, alors que dans le cas des usines
hydroélectriques, la turbine est animée par la force de l’eau.
La turbine est couplée à un alternateur, un grand aimant cerclé
dune bobine, qui va produire un courant alternatif en tournant.
Une fois le courant produit, il doit être amené jusque chez le
consommateur À la sortie de la centrale, un premier
transformateur, un survolteur, augmente la tension du courant
à 400 ou 800 000V. Ceci permet de minimiser les pertes
d’énergie pendant le transport. Près du point de livraison, un
deuxième transformateur, un sous volteur, fait l’opération
inverse : il abaisse la tension du courant pour la mettre aux
normes du réseau domestique.

Il existe d’autres manières de
produire de l’électricité : les
panneaux solaires transforment
la lumière du soleil en
électricité, les éoliennes
utilisent la force du vent, les
usines marémotrices celle des
marées, la géothermie exploite
les gisements d’eau chaude
stockés dans le sous-sol
terrestre (géothermie), tandis
que les usines à biomasse
utilisent les déchets comme
source d’énergie
En 1911, le physicien néerlandais Heike Kamerlingh Onnes découvrait que, pour certains
métaux, un changement brusque de leurs propriétés physiques se produit quand on les
refroidit à des températures extrêmement basses, à peine quelques degrés au-dessus du zéro
absolu (correspondant à - 273 °C). En particulier, la résistance électrique de ces matériaux
devient inférieure à toute valeur mesurable, de sorte qu'un courant électrique continu peut y
circuler sans dissipation d'énergie, donc quasi indéfiniment. On dit qu'il y a transition de l'état
normal (c'est-à-dire conducteur) à l'état supraconducteur. Cette transition intervient à une
température qualifiée de " critique ".
Dans un métal normal, les atomes, régulièrement disposés au sein d’un réseau, libèrent les
électrons qui leur sont les moins liés, chaque atome devenant de ce fait un ion positif. Ces
électrons, appelés électrons de conduction, peuvent se déplacer de façon assez libre à
l’intérieur du solide. Leur mobilité leur permet de transporter un courant électrique au sein du
métal, ce qui ne se fait pas sans perte. Une résistance électrique existe, qui provient des
collisions que ne manquent pas de subir ces électrons avec le réseau. Les atomes vibrent
autour de leur position moyenne, de sorte que le réseau est parcouru d'ondes de vibration. Or
la physique quantique attribuant à ces ondes, comme à toutes les autres, un aspect
corpusculaire, on peut leur associer des corpuscules, appelés photons (qui sont aux ondes de
vibration de ce que les photons sont aux ondes électroniques). C'est avec ces corpuscules
associés aux ondes de vibration du réseau que les électrons de conduction entrent en collision
et échangent de l'énergie.
Mais dans un métal à l'état supraconducteur, tout se passe comme si les électrons se trouvaient
soudainement libérés de toute interaction avec le réseau, la résistance électrique devenant
nulle.
Les physiciens ont vite été convaincus que la supraconductivité ne pouvait être qu'un
phénomène d'origine quantique. En 1950 fut émise l'idée que les électrons de conduction dans
un métal pouvaient interagir entre eux par le biais du réseau atomique. Il fallut sept années
d'efforts pour construire autour de cette idée une théorie microscopique satisfaisante de la
supraconductivité. Elle s'appelle la théorie BCS, d'après les initiales de ses inventeurs : John
Bardeen, Leon N. Cooper et John Schrieffer (tous trois prix Nobel de physique en 1972).
Cette théorie explique qu'à très basse température, les électrons s'apparient, en quelque sorte
se mettent en couple. On dit qu'ils forment des paires de Cooper. Cet état, sinon conjugal, du
moins ordonné résulte de l'existence d'une attraction entre électrons par l'intermédiaire de
vibrations du réseau atomique, qu'on peut schématiser ainsi : un électron de conduction se
déplaçant dans le métal provoque sur son passage une déformation locale et momentanée du
réseau par l'attraction qu'il exerce sur les ions positifs. Ces ions se déplaçant, ils créent un
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%