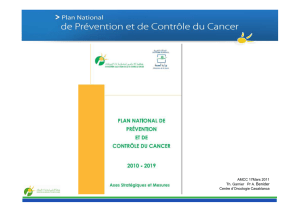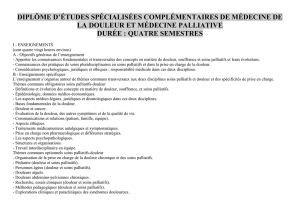Proposition d`un cadre d`analyse des pratiques professionnelles des

Proposition d'un cadre d'analyse des pratiques professionnelles
des équipes de soutien et conseil en soins palliatifs au domicile
Jean-Christophe Mino (photo), Marie-Odile Frattini
[1] DIES, filiale de la Fondation de l'Avenir pour la Recherche Médicale Appliquée, Paris,
France Lert, INSERM, Hôpital National, Saint-Maurice.
Keywords: evaluation, palliative care, home care, healthcare network, mobile team
Mots-clés : évaluation, soins palliatifs, domicile, réseau de soins, équipe mobile
INTRODUCTION
Dans le prolongement des options antérieures, la politique de développement des soins
palliatifs fait l'objet en France d'un programme national ministériel 2002-2005 [1], encadré
par la circulaire du 19 février 2002 [2]. Pour rendre effective la diffusion des pratiques de
soins palliatifs dans tout le système de soins, les pouvoirs publics renforcent l'accent mis sur
les équipes professionnelles dont le rôle est de conseiller, soutenir et former les
professionnels de soins [3]. Nous appellerons ces nouveaux types de structures du terme
générique d'équipes de soutien et conseil en soins palliatifs.
Dans le secteur ambulatoire, ces équipes prennent la forme de coordinations de réseaux de
soins, d'équipes mobiles ou d'équipes de liaison. Ces structures sont encore récentes ou en
cours de constitution. Elles sont régies par un cadre légal encore largement expérimental et
dérogent, pour une part, aux modes de fonctionnements classiques du système de soins :
règles de financement et de rémunération, règles professionnelles, division du travail entre
soignants, types de pratiques. Leur création a reposé sur des dispositifs incitatifs variés et
non spécifiques (Fonds d'Aide à la Qualité des Soins de Ville (FAQSV), mesures en faveur des
réseaux de soins, enveloppes diverses). Elles sont soumises le plus souvent à une obligation
d'évaluation. Cette évaluation présente des traits particuliers pour plusieurs raisons. Ces
équipes ambulatoires ont un fonctionnement non stabilisé et sont pour beaucoup encore en
cours de structuration ; leurs objectifs très ambitieux reposent sur des moyens très limités ;
elles sont hétérogènes dans leur composition, leurs pratiques, leur organisation et leur mode
de fonctionnement ; les exigences des bailleurs en termes d'évaluation sont elles aussi
hétérogènes et parfois mal définies. Ceci dans le contexte français, où l'évaluation en
médecine est un domaine récent, dont les stratégies et les méthodes sont en cours de
formalisation, notamment quant à l'organisation des soins.
Notre doctrine d'évaluation est compréhensive et réflexive.
Le cadre d'analyse et la stratégie d'évaluation proposés dans cet article visent à faciliter la
démarche d'(auto) évaluation des équipes de soutien et conseil en soins palliatifs. Ce cadre
s'attache à être suffisamment flexible pour s'adapter à des organisations variées. Son
objectif est double : au niveau de chaque équipe, il doit permettre d'une part de rendre
compte de l'activité eu égard aux objectifs et répondre ainsi à l'impératif d'évaluation, d'autre
part d'identifier les facteurs de fragilisation de l'équipe qui peuvent compromettre sa
pérennité et l'aider à stabiliser son fonctionnement. Utilisé par plusieurs équipes au niveau
d'un secteur géographique, d'une région ou même de la France entière, l'outil proposé
pourrait servir à agréger des données et contribuer ainsi au pilotage et à l'évaluation de la
politique de santé au niveau local, régional voire national.

MATERIEL ET METHODE
La construction de cet outil repose sur un matériel de monographies de divers types
d'équipes de soins palliatifs, réalisées en réponse à des demandes d'évaluation au cours des
cinq dernières années [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11]. Ces études ont reposé sur une description
fine et compréhensive du travail et apportent des éléments empiriques qui permettent
aujourd'hui de proposer certains axes pour un cadre d'analyse des pratiques.
En termes de méthodologie, nous avons procédé en deux temps. Dans un premier temps,
nous nous sommes consacrés à une approche systémique, c'est-à-dire identifiant et mettant
en rapport les éléments constitutifs du système social des soins palliatifs au domicile. En
l'absence d'une définition claire d'objectifs d'évaluation au niveau national, il s'agissait de
resituer les équipes de soutien et conseil dans leur contexte général et local, de caractériser
les conditions de la fin de vie au domicile, le rôle de ces équipes dans le dispositif de soins et
de définir une typologie de leurs interventions. Ces éléments constituent la première partie
du cadre d'analyse, ils ont orienté la rédaction de la grille de recueil de données.
Dans un second temps, une grille de recueil de données a été élaborée en mobilisant les
méthodes de l'évaluation et de l'accréditation des organisations de soins au domicile,
notamment les résultats des travaux de l'ANAES [12], du CREDES et du groupe Image [13]sur
les réseaux de soins. L'activité des équipes est envisagée comme la réponse d'un dispositif
organisé aux besoins d'une population de patients en fin de vie dans un environnement local
défini. Cette grille comporte quatre parties : des données descriptives générales, la
documentation d'événements sentinelles, un référentiel dont la forme des items est proche
des manuels d'accréditation et un bilan final. La formulation et l'utilisation ont été pensées
dans l'optique d'une démarche d'(auto) évaluation accompagnée et participative.
Ce choix a été fait parce que notre doctrine de l'évaluation est compréhensive et réflexive, et
non prescriptive.
Plus qu'une adéquation à une norme de bonne pratique, qui au demeurant n'existe pas
aujourd'hui et relève des professionnels du champ, le cadre d'analyse se propose de
favoriser un retour réflexif et une évaluation interne (ou endo-formative), à savoir : pour
l'équipe, réfléchir sur ses ressources, son organisation et ses pratiques, mieux structurer ses
activités et son mode de fonctionnement afin de pouvoir régulièrement se situer et s'ajuster
à la fois au modèle des soins palliatifs et à la réalité de l'espace social (culturel,
réglementaire, pratique, organisationnel). On s'intéressera donc ici aux conditions
d'existence pérenne, de fonctionnement réaliste et d'efficacité des actes autour des
situations au domicile, à l'interdépendance avec les autres professionnels, à la structuration
du temps de travail. En effet, les équipes de soutien et conseil doivent éviter la redondance
avec les autres professionnels et l'empiétement sur leurs prérogatives, les risques de
glissement du fonctionnement quotidien vers un investissement immodéré dans le travail
source d'épuisement et d'instabilité des professionnels et la démesure entre les objectifs
ancrés dans la référence du mouvement des soins palliatifs et les ressources si souvent
modestes dont elles disposent.
RESULTATS
Une approche systémique des soins palliatifs au domicile

Cette première partie du cadre d'analyse situe les activités de l'équipe de soutien et conseil
au cœur d'une analyse systémique des différents niveaux de leur travail eu égard à leurs
objectifs et au modèle des soins palliatifs. Elle identifie leur place dans le contexte local et
général, décrit les conditions particulières de la fin de vie au domicile, précise leur rôle et
suggère le contenu possible de leurs interventions.
Les équipes de soins palliatifs sont replacées dans leur contexte local et général
Les équipes de soins palliatifs au domicile sont au service de la population des personnes en
fin de vie et de leurs proches dans une aire géographique délimitée. Le système des soins
palliatifs au domicile est constitué de trois pôles principaux dont les acteurs sont en
interaction : l'équipe de soins palliatifs, les patients et leur entourage au domicile, les
professionnels de soins locaux. Ces trois pôles sont respectivement sous l'influence directe et
indirecte de l'univers des normes des soins palliatifs et de la médecine, des normes et
pratiques culturelles en fin de vie, de l'univers des règles du système de soins
La structuration de l'équipe doit être suffisamment robuste pour assurer une qualité
et une intensité d'activités suffisante eu égard aux demandes de prise en charge dans
l'aire géographique qu'elle dessert et être en même temps assez souple pour s'ajuster
aux cas individuels (gestion des entrées et décès, des aléas, de l'urgence, de la
singularité des situations). L'univers des soins palliatifs, et plus largement celui de la
médecine, est une « matrice » pour la forme que prennent les équipes et la manière
dont elles mettent en oeuvre leurs activités.
Les équipes sont également dépendantes de l'offre locale du système sanitaire et
social (ses acteurs, ses services, ses cultures, ses compétences, ses organisations, les
formes de travail coopératif antérieures…). Cette offre constitue les ressources
disponibles, ou non, pour les professionnels, les patients, les familles.
Plus largement, les règles d'organisation, les modes de financement et la culture du
système de soins modulent les interventions. L'ensemble des acteurs du système est
soumis à ces règles (par exemple, le paiement à l'acte, les délais d'attente pour les
ressources financières et humaines, les règles de la formation continue) qui peuvent
faciliter ou gêner leur travail. Il s'agit à ce niveau de favoriser une réflexion sur
l'adéquation objectifs/moyens.
Les normes culturelles et les pratiques sociales en fin de vie (en particulier le tabou
de la mort pour les proches et le silence des professionnels sur le pronostic fatal)
inscrivent dans certaines limites les actes, les paroles et l'accompagnement que
propose le modèle des soins palliatifs. Ce que chacun sait et ne sait pas du
diagnostic, du pronostic et de ce que les autres savent conditionne les relations entre
l'équipe, le malade, son entourage et les professionnels.
Les conditions de la fin de vie
La trame de la fin de vie constitue un arrière-plan de l'activité du système des soins palliatifs
qui définit des caractéristiques particulières de l'évaluation des équipes, qui n'ont plus pour
objectif de guérir, réhabiliter ou allonger la durée de vie, mais d'accompagner par des
pratiques adaptées l'ensemble des acteurs, patients, entourage et professionnels jusqu'au
décès.

Les conditions particulières essentielles que nous avons identifiées pour construire la grille de
recueil d'information, et particulièrement le référentiel, sont les suivantes :
la composante majeure de la prise en charge du patient au domicile que constitue le
travail des profanes (proches et bénévoles) ;
la vulnérabilité et la fatigue extrême du patient et de l'entourage avec le risque
d'effondrement de leur résistance et leur capacité à faire face ;
le caractère aléatoire et imprévisible de l'évolution clinique avec la grande fréquence
des situations d'urgence ;
l'inéluctabilité de dilemmes décisionnels plus ou moins aigus face à ces aléas ;
la multitude de soignants (plusieurs infirmiers, plusieurs aides-soignants, plusieurs
médecins, kinésithérapeutes, pharmaciens…) et d'intervenants sociaux (assistantes
sociales, aides à domicile…) auprès du patient, compte tenu de la nécessaire
permanence des soins et de leur durée ; cette situation ayant pour corollaire des
compétences et des engagements de niveau différent, une diversité d'attitudes quant
à la conduite à tenir en fin de vie.
Le rôle des équipes de soins palliatifs
Les soins palliatifs au domicile nécessitent un fonctionnement coordonné de ces acteurs qui
jusqu'à maintenant ont des difficultés à coopérer. Si l'intervention, au cas par cas auprès des
patients, mobilise une expertise spécifique, la présence d'une équipe dans une aire
géographique donnée ne peut être efficace que dans un processus progressif d'appropriation
par les services et les soignants du domicile, ce qui demande un projet et une organisation
spécifique. Les équipes de soins palliatifs proposent des pratiques et des modes
d'organisation qui visent à faciliter la mise en oeuvre de soins palliatifs de qualité par ces
acteurs.
Les équipes suivent un « principe de subsidiarité ».
Les équipes de soutien et de conseil n'exécutent pas elles-mêmes d'actes de soin mais
réalisent des tâches qui potentialisent l'activité des proches et les pratiques des
professionnels de santé ou des travailleurs sociaux qui prennent en charge directement les
patients. On peut donc assigner comme rôle aux équipes, au travers de fonctions nouvelles
et originales, d'optimiser la mobilisation des ressources médicales, sociales et profanes pour
assurer une prise en charge des patients orientée par les normes des soins palliatifs. L'enjeu
est de déterminer leur fonctionnement et leurs principes de travail pour que ce système
fonctionne au bénéfice du patient et de son entourage, c'est-à-dire pour contrôler les
symptômes, optimiser le mode de prise en charge globale et tenir compte du désir et des
capacités des proches et du patient.
La gamme des interventions réalisables dans la prise en charge palliative à
domicile
Pour remplir ce rôle au niveau de la prise en charge au cas par cas, les équipes de soins
palliatifs conseillent et soutiennent les soignants et les familles en apportant une expertise
spécifique, en supervisant la logistique, en assurant ou en facilitant la communication entre
les acteurs et la coordination de leur travail, en proposant des aides auxiliaires, etc. Elles
peuvent aussi assurer des prestations habituellement peu utilisées au domicile : soutien par

un psychologue, intervention d'un travailleur social. Au niveau de l'amélioration des
compétences collectives du système de soins local, elles organisent des formations, des
échanges destinés à transmettre des connaissances, une information permettant d'améliorer
la lisibilité de leur rôle et de leurs actions. Les modes d'intervention ainsi identifiés
correspondent à l'étape actuelle de développement des soins palliatifs au domicile en France.
Ce domaine encore très neuf reste en devenir et évoluera sans doute au fur et à mesure.
En pratique, l'activité des équipes a pour préalable la volonté du patient et l'accord de la
famille pour une prise en charge à domicile. Lorsqu'elles répondent à une demande
d'intervention, les équipes cherchent à connaître, par une évaluation directe ou en croisant
les informations de chaque acteur de la prise en charge, l'état clinique du patient, les
compétences familiales dans différents registres (mobiliser le patient, dispenser les soins,
faire face psychologiquement, matériellement et financièrement, aménager l'espace et les
emplois du temps, etc.), ainsi que les compétences en soins palliatifs des soignants qui
interviennent au domicile. L'évaluation de la situation au domicile doit être pensée non en
termes de besoins individuels du patient, mais en termes de charge pour l'ensemble des
protagonistes de la « configuration au domicile », charge qui varie relativement aux
ressources internes (familiales) et externes (professionnelles).
Dans un objectif de continuité de la prise en charge, la démarche de l'équipe s'inscrit dans la
durée. L'évaluation ne peut pas être faite en une seule fois et nécessite d'observer de façon
directe ou indirecte, sur plusieurs jours, la famille et les soignants évoluer autour du patient,
et de faire émerger leur point de vue sur la situation. Cette démarche d'observation inclut
l'appréciation qu'en ont les professionnels soignants. Par ailleurs, compte tenu de l'évolutivité
de la situation, l'évaluation doit être répétée pour tenir compte des modes d'ajustement et
éventuellement de la survenue de ruptures ou d'effondrement des capacités de l'entourage
et du patient à y faire face.
Les équipes cherchent donc à déterminer les ressources ainsi que ce qui est nécessaire pour
permettre au patient de vivre la phase palliative et souvent l'agonie au domicile. La
compétence des équipes est de définir leurs interventions en suivant un « principe de
subsidiarité » : compte tenu des capacités et des compétences de chacun, à chaque étape
de la situation, aider chaque protagoniste dans sa contribution. Éventuellement là où elle
identifie des manques, l'équipe peut effectuer des actes directs pour faire face à la « charge
physique (faire pour), mentale (penser pour) et psychique (se faire du souci pour) ».
Leurs interventions se déploient alors dans plusieurs axes de travail : clinique (médical,
soignant), vie quotidienne (social, vie pratique), relations et affects du patient et des proches
(relationnel et psychologique). La plupart des activités sont transversales à ces trois axes :
évaluation de la situation, conseils aux soignants et autres professionnels de proximité (voire
aux bénévoles), anticipation, planification et gestion du temps, aide à la logistique
(équipements, traitements, aides), communication et partage des informations, formation
des proches, disponibilité, suivi et surveillance, autres activités.
La grille de recueil de données
La grille de recueil de données répond à trois types d'enjeux. Elle doit permettre de porter
un regard compréhensif et (auto) critique sur les équipes. À cette fin, elle propose un recueil
d'informations minimal et un référentiel destiné à guider de manière réflexive l'analyse de
l'organisation et des pratiques. La construction de cette grille tient compte des ressources
limitées que les équipes peuvent consacrer à la documentation des données nécessaires à
l'évaluation en routine. En effet, ni les moyens humains ni les moyens financiers ne
permettent aux équipes de mettre en oeuvre un système d'informations détaillées sur leurs
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
1
/
25
100%