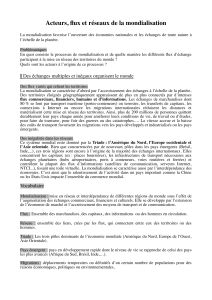Ch.1_dynamique_mondialisation_documents

LA DYNAMIQUE DE LA MONDIALISATION
DOCUMENTS COMPLEMENTAIRES
Doc. 1
Qu’est-ce que la mondialisation ? De façon étonnante, compte tenu de la profusion des discours et des écrits, la ré-
ponse à la question n’est jamais vraiment donnée. Ou plutôt, les partisans comme les adversaires de la mondialisation
partagent confusément la même référence implicite : le paradigme de l’économie internationale traditionnelle. Ce der-
nier, pourtant, étroitement cantonné à l’analyse du commerce entre les pays, ne couvre qu’une dimension du phéno-
mène de la mondialisation (…) La mondialisation est un phénomène économique complexe. Complexe, car il est mul-
tidimensionnel. Complexe parce que ses différentes dimensions fonctionnent simultanément dans des relations
d’interdépendance (…) La mondialisation englobe, à la fois, la dimension des échanges de biens et services, la dimen-
sion des investissements directs à l’étranger et la dimension de la circulation des capitaux financiers. La dimension des
échanges est celle des flux d’exportation et d’importation entre les pays. Ils sont enregistrés dans les transactions cou-
rantes de la balance des paiements. La dimension productive repose sur les investissements directs à l’étranger (IDE).
Ils sont effectués par les firmes et sont les vecteurs de l’expansion multinationale de leurs activités. Ils entraînent la
mobilité des activités de production des biens et des services, souvent désignée comme la délocalisation de la produc-
tion. Les IDE sont enregistrés dans la balance des capitaux à côté des mouvements de capitaux longs correspondant à
des investissements de portefeuille (ou financiers). La mobilité des capitaux financiers constitue la troisième dimension
de la mondialisation. Il ne faut surtout pas confondre les investissements directs et les investissements de portefeuille.
Ces derniers ont pour finalité la rentabilité et non pas la gestion directe des sociétés dans lesquelles sont prises des
participations. Ils sont volatils, leurs déplacements obéissant aux variations anticipées des rendements sur les diffé-
rentes places. Réduire l’analyse de la mondialisation à la seule sphère du commerce international est un choix insoute-
nable. C’est pourtant encore aujourd’hui celui qui domine, aussi bien dans la littérature économique que dans les ar-
ticles de journaux, les rapports officiels ou les discours politiques (…) Définir la mondialisation comme
l’intensification des échanges qui accroît l’intégration des nations est devenu un lieu commun, entre autres dans les
analyses produites par les institutions internationales (OMC, FMI, Banque Mondiale). Cette interprétation parait très
insuffisante. Partielle, elle oublie les deux autres dimensions de la mondialisation, qui sont complémentaires des
échanges. C’est précisément cette interdépendance multidimensionnelle qui permet de comprendre l’originalité de
l’intégration actuelle des économies nationales dans l’économie mondiale.
Charles-Albert Michalet, Qu’est-ce que la mondialisation ?, La Découverte, 2004.
Doc. 2
« Avant, les évènements qui se déroulaient dans le monde n’étaient pas liés entre eux. Depuis, ils sont tous dépendants les uns des autres. »
La constatation est banale, hormis le fait que celui qui la formule, Polybe, vivait au IIe siècle avant J.-C. ! La mondiali-
sation, cette création d’un espace mondial interdépendant, n’est donc pas nouvelle. Certains la font même remonter à
la diffusion de l’espèce humaine sur la planète…
Dès l’Empire romain, une première mondialisation s’est organisée autour de la Méditerranée. Mais il faut attendre les
grandes découvertes, au XVe siècle, pour assurer la connexion entre les différentes sociétés de la Terre et la mise en
place de cette « économie-monde » décrite par l’historien Fernand Braudel. Une mondialisation centrée sur l’Atlantique
culmine au XIXe siècle : entre 1870 et 1914 naît un espace mondial des échanges comparable dans son ampleur à la
séquence actuelle. Ouverture de nouvelles routes maritimes, avec le percement des canaux de Suez et de Panama, dou-
blement de la flotte marchande mondiale et extension du chemin de fer, multiplication par 6 des échanges, déverse-
ment dans le monde de 50 millions d’Européens, qui peuplent de nouvelles terres et annexent d’immenses empires
coloniaux…, la naissance de la mondialisation telle que nous la connaissons aujourd’hui a commencé il y a un siècle et
demi.
Mais le processus n’est pas linéaire : la Première Guerre mondiale puis la grande dépression des années 1930 suscitent
la montée des nationalismes étatiques, une fragmentation des marchés, le grand retour du protectionnisme. La mondia-
lisation n’est plus à l’ordre du jour jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. La guerre froide et la constitution des blocs
figent ensuite le monde pendant près d’un demi-siècle. Pourtant, la mondialisation actuelle est déjà en train de se
mettre en place. Jacques Adda la définit comme « l’abolition de l’espace mondial sous l’emprise d’une généralisation du capitalisme,
avec le démantèlement des frontières physiques et réglementaires ». Selon l’OCDE, elle recouvre trois étapes :
• L’internationalisation, c'est-à-dire le développement des flux d’exportation ;
• La transnationalisation, qui est l’essor des flux d’investissement et des implantations à l’étranger ;
• La globalisation, avec la mise en place de réseaux mondiaux de production et d’information, notamment les NTIC
(nouvelles technologies d’information et de communication).
La mondialisation actuelle, ce « processus géohistorique d’extension progressive du capitalisme à l’échelle planétaire », selon la for-
mule de Laurent Carroué, est à la fois une idéologie – le libéralisme –, une monnaie – le dollar –, un outil – le capita-
lisme –, un système politique – la démocratie –, une langue – l’anglais.

A chaque phase de mondialisation, on retrouve les mêmes constantes : révolution des transports et des moyens de
communication, rôle stratégique des innovations (les armes à feu au XVe siècle, la conteneurisation après la Seconde
Guerre mondiale, Internet depuis les années 1990), rôle essentiel des Etats mais aussi des acteurs privés, depuis le
capitalisme marchand de la bourgeoisie conquérante à la Renaissance jusqu’aux firmes transnationales et aux ONG
aujourd’hui.
C’est le « doux commerce », selon la formule de Montesquieu, qui fonde la mondialisation : ce que les Anglo-Saxons ap-
pellent globalisation (le terme mondialisation n’a pas son équivalent anglais) est né d’un essor sans précédent du com-
merce mondial après 1945. Depuis cette date, les échanges progressent plus vite que la production de richesses. Ils
sont dopés par la généralisation du libre-échange, avec la mise en place du Gatt (l’accord général sur les tarifs et le
commerce) en 1947 et la création de l’OMC (Organisation mondiale du commerce) en 1995.
La mondialisation actuelle est d’abord et avant tout une globalisation financière, avec la création d’un marché planétaire
des capitaux et l’explosion des fonds spéculatifs. La fin de la régulation étatique qui avait été mise en place juste après
la Seconde Guerre mondiale s’est produite en trois étapes : d’abord, la déréglementation, c’est-à-dire la disparition en
1971 du système des parités stables entre les monnaies, qui se mettent à flotter au gré de l’offre et de la demande ;
ensuite, la désintermédiation, possibilité pour les emprunteurs privés de se financer directement sur les marchés finan-
ciers sans avoir recours au crédit bancaire ; enfin, le décloisonnement des marchés : les frontières qui compartimen-
taient les différents métiers de la finance sont abolies, permettant aux opérateurs de jouer sur de multiples instruments
financiers. Grâce aux liaisons par satellite, à l’informatique et à Internet, la mondialisation se traduit par l’instantanéité
des transferts de capitaux d’une place bancaire à une autre en fonction des perspectives de profit à court terme. Les
places boursières du monde étant interconnectées, le marché de la finance ne dort jamais. Une économie virtuelle est
née, déconnectée du système productif : au gré des variations des taux d’intérêt des monnaies et des perspectives de
rémunération du capital, la rentabilité financière des placements devient plus importante que la fonction productive.
Les investisseurs peuvent choisir de liquider une entreprise, de licencier ses salariés et de vendre ses actifs pour rému-
nérer rapidement les actionnaires.
Comment en est-on arrivé là ? Le tournant décisif se produit dans les années 1980. En 1979, l’arrivée au pouvoir de
Ronald Reagan aux Etats-Unis et de Margaret Thatcher en Grande-Bretagne signifie l’avènement des doctrines libé-
rales. La même année, le Sénégal inaugure le premier « plan d’ajustement structurel » : la crise de la dette vient de
commencer pour les pays en développement, obligés d’adopter des « stratégies de développement favorable au marché », selon
la formule des institutions financières internationales (Banque mondiale et FMI). Cette unification des modèles éco-
nomiques gagne non seulement le monde en développement mais aussi les pays de l’Est : c’est en 1979 toujours que la
Chine libéralise son agriculture. Cinq ans plus tard, en 1984, elle ouvre ses premières zones économiques spéciales.
Cinq ans après encore, la disparition du mur de Berlin annonce celle de l’Union soviétique en 1991, année où l’Inde,
jusque-là nationaliste, protectionniste et autarcique, se libéralise à son tour.
En dix ans, la face du monde a résolument changé. La fin de la guerre froide crée l’illusion qu’une communauté inter-
nationale est née, qui va enfin percevoir « les dividendes de la paix ». Le capitalisme paraît avoir triomphé, au point que
Francis Fukuyama annonce « la fin de l’histoire ». Les firmes transnationales amorcent un vaste mouvement de redé-
ploiement de leurs activités. La décennie 1990 est jalonnée par de grandes conférences internationales où les acteurs
traditionnels de la diplomatie, les Etats et les institutions internationales, se voient bousculés, interpellés par de nou-
veaux acteurs, qui privilégient la démocratie participative. Filles de la mondialisation, dont elles utilisent un des ressorts
essentiels, le pouvoir des médias et de la communication, les ONG se fédèrent en réseaux planétaires grâce à
l’utilisation d’Internet. Elles imposent la vision nouvelle d’un monde interdépendant, où les grandes questions – pau-
vreté, santé, environnement – doivent être appréhendées de manière globale. Le Sommet de la Terre (Rio,1992) inau-
gure ainsi l’ère du développement durable.
Mais l’apparente unification de l’espace planétaire cache de profondes disparités. A l’espace relativement homogène
d’avant la révolution industrielle s’est substitué un espace hiérarchisé entre des territoires qui comptent dans
l’économie mondiale et d’autres qui sont oubliés. « Le monde de la globalisation est un monde de la concentration, de toutes les
concentrations : la moitié de l’humanité réside sur 3 % des terres émergées, et la moitié de la richesse mondiale est produite sur 1 % des terres
», explique Olivier Dollfus . La mondialisation a à la fois des centres d’impulsion et des périphéries, intégrées ou au
contraire délaissées. Les espaces moteurs de la mondialisation appartiennent à l’« archipel métropolitain mondial », une toile
de grandes mégalopoles, essentiellement localisées au sein de la Triade (Etats-Unis, Europe, Japon), qui sont reliées
entre elles par des réseaux.
La logique du réseau évince celle du territoire : réseaux de transport (des hommes, des marchandises, des matières
premières, de l’énergie), mais aussi réseaux de télécommunications et réseaux relationnels. Malgré les extraordinaires
progrès des technologies, il n’y a donc aucune abolition du temps et de l’espace, mais la distance n’est plus métrique :
elle s’apprécie en fonction de l’équipement des lieux en réseaux, qui définit leur accessibilité et leur attractivité. Les
effets de centralité se renforcent, au détriment des territoires ou des populations qui n’ont pas d’« avantage comparatif
» dans la mondialisation, pas de pouvoir d’achat ou pas de matières premières par exemple. Ceux-là disparaissent dans
des trous noirs, sauf quand l’enclavement leur confère précisément la valeur d’un isolat, culturel ou naturel. Le tou-
risme, première industrie mondiale, peut ainsi parfois renverser la hiérarchie des lieux en muséifiant de prétendus para-
dis perdus.
La mondialisation renforce donc les inégalités. Sur un plan spatial, puisque l’accentuation de la rugosité de l’espace
s’observe à toutes les échelles : planétaire, régionale, nationale, locale. Mais aussi sur le plan social : l’écart entre ceux
qui peuvent saisir les opportunités offertes par la mondialisation et ceux qui ne trouvent pas leur place, entre riches et
pauvres, se creuse à toutes les échelles. Un cinquième de l’humanité seulement consomme (et produit) les quatre cin-

quièmes des richesses mondiales. Sans régulateur, la mondialisation engendre la marginalisation des plus faibles et la
prolifération des activités illicites, voire criminelles. Sans contrepouvoir, le capitalisme finit par aboutir à des situations
de concentration et de monopole qui ruinent la concurrence et remettent en question les mécanismes du marché. Face
à ces logiques comme à l’émergence de multiples passagers clandestins, il faut des régulateurs.
Loin d’abolir le rôle des Etats, la mondialisation leur redonne au contraire tout leur sens : seule la puissance publique
peut réguler la mondialisation en fixant des normes, en redistribuant les richesses, en aménageant le territoire. Tenta-
tions du protectionnisme, fermeture des frontières, mise en oeuvre de législations contraignantes, la mondialisation
s’accompagne paradoxalement du grand retour des Etats. Le libre-échange est contesté dès lors qu’il compromet cer-
taines questions jugées essentielles, comme l’emploi, la sécurité, la santé ou l’accès à l’énergie.
Les zones d’influence se reconstituent par le biais des accords bilatéraux. Entre le dirigisme des pays émergents, le «
socialisme de marché » de la Chine et du Viêtnam, les dictatures d’Asie centrale, et le grand retour du nationalisme en
Amérique centrale, le libéralisme est loin de régner sur la planète, y compris et surtout dans sa patrie d’adoption, les
Etats-Unis, qui le remettent en question depuis que le centre de gravité du monde s’est déplacé de l’Atlantique vers le
Pacifique avec la montée en puissance de la Chine.
Loin d’abolir l’espace, la mondialisation redonne au contraire toute leur force aux singularités locales. « En tant que
changement d’échelle, c’est-à-dire invention d’un nouvel espace pertinent, la mondialisation crée inévitablement des tensions sur les configura-
tions locales préexistantes en les menaçant d’une concurrence par sa seule existence. » L’incertitude face aux mutations du monde, la
rapidité des changements suscitent en réaction une réaffirmation des identités locales, une réactivation des communau-
tés d’appartenance : recherche de socles identitaires, montée des communautarismes, la mondialisation fragmente
paradoxalement le monde. Jamais les combats mémoriels et l’intolérance religieuse n’ont été aussi aigus.
Absence d’une gouvernance et de régulateurs mondiaux, grand retour des Etats et du local, la mondialisation est ainsi
en train de se muer imperceptiblement en « glocalisation », juxtaposition à l’infini de politiques locales, visant à décliner à
leur façon une économie mondiale qui s’inscrit d’abord et avant tout dans des lieux, un « espace vécu », pour reprendre la
formule du géographe Armand Frémont. « Le local n’est plus le foyer d’une socialisation rassemblée dont la communauté villageoise
était la forme la plus aboutie, mais le point de rencontre, voire de confrontation entre des groupes dont chacun possède son propre espace
d’action et de référence. »
En ce début de XXIe siècle, la mondialisation se trouve ainsi, paradoxalement, en recul. Comme si elle n’avait consti-
tué qu’une phase historiquement datée dans l’histoire de l’humanité.
Sylvie Brunel – Sciences Humaines – mars 2007
Doc. 3
On sait que la mondialisation économique contemporaine se caractérise, depuis environ trente ans maintenant, par un
triple mouvement, d’intensification des flux de marchandises (biens et services) entre nations d’une part, de libéralisa-
tion quasi planétaire des mouvements de capitaux d’autre part, de transformation radicale des localisations géogra-
phiques des firmes enfin. L’ensemble de ces caractéristiques témoigne d’une indiscutable liberté accordée aux forces de
marché et aux intérêts privés, sur un espace désormais planétaire. Mais au-delà de cette description factuelle d’un pro-
cessus complexe se pose la question plus délicate de l’interprétation, après une génération, de ce mouvement qui a
transformé la fin du 20e siècle tout en accumulant de lourds nuages en ce début du 21e. Par interprétation il faut en-
tendre ici l’établissement d’un bilan provisoire et surtout la réponse à quelques questions cruciales. Qu’est-ce qui s’est
fondamentalement réalisé ? Quelles transformations structurelles ont eu lieu ? Sur quelles conséquences, éventuelle-
ment inattendues, a débouché ce processus ? Il ne s’agira donc plus ici d’analyser « à plat » les caractéristiques intrin-
sèques à la mondialisation économique ou de révéler la logique fonctionnelle (ou les contradictions) des synergies en
cours… L’objectif sera, de manière beaucoup plus libre, d’en proposer une représentation synthétique, de montrer ce
qu’il convient, finalement et pour l’instant, d’en retenir.
Si l’on accepte cette problématique, il est sans doute possible de retenir quatre interprétations à la fois concurrentes
(quant à leur pertinence relative) et pourtant non exclusives. La mondialisation économique serait alors tout à la fois
« création d’un marché mondial » et approfondissement du capitalisme, affaiblissement mais aussi supranationalisation
des classiques régulations étatiques territorialisées, montée des inégalités internes à peu près partout alors que l’inégalité
globale tendrait à décliner, ré-émergence de quelques puissances asiatiques… Au total, hormis la première interpréta-
tion qui était sans doute intentionnelle et politiquement assumée dès le début des années 1980 (par ailleurs bien appré-
hendée par l’analyse économique), les trois autres se réfèrent à des résultats partiellement non anticipés ou dont la
dimension s’est trouvée négligée, des constructions contingentes qui auraient pu être autres, des changements de rap-
ports de force que leurs propres auteurs n’ont que partiellement dirigés. Évoquons-les tour à tour.
La mondialisation économique est bien la création d’un marché mondial des biens, des services, des capitaux, voire des
travailleurs. Ce marché se manifeste d’abord par un processus d’unification des prix des biens et services, aux coûts de
transport (d’ailleurs de plus en plus faibles) près. Mais il se manifeste aussi par la tendance de long terme à l’égalisation
des salaires entre travailleurs d’un niveau donné de qualification : ce rattrapage partiel est par exemple flagrant, dans le
cas chinois, depuis quatre ou cinq ans. Quant au prix des capitaux, il converge aussi vers un niveau moyen, phénomène
cependant encore entravé par les incontournables différences de risque : il n’en reste pas moins que le marché mondial
des capitaux est devenu une réalité qui marginalise l’idée de marchés financiers encore nationaux. Par ailleurs les mar-
chés se sont largement sophistiqués au plan technique et les systèmes de marchés sont de plus en plus complets avec
les nombreuses possibilités d’effectuer des transactions à terme (marchés d’options, de futures) ou de se défausser de

ses engagements (dérivés de crédit, subprime, etc.). Il ne faudrait pas cependant considérer qu’il s’agit là d’un résultat
tout à fait nouveau. Déjà à la fin du 19e siècle ce marché « mondial », en tout cas « atlantique », avait nettement pro-
gressé. Mais plus généralement, il semble que l’on puisse postuler un lien étroit entre l’expansion géographique des
échanges et la création/approfondissement de l’économie de marché. Ces économies de marché ont d’abord émergé,
sur une base nationale, dans les pays d’Europe qui tiraient parti d’échanges dynamiques et de grande extension (Pays-
Bas au 17e siècle, Grande-Bretagne au 18e). A partir de la seconde moitié du 19e, la nouvelle expansion internationale
des échanges a non seulement favorisé l’économie de marché états-unienne mais encore stimulé l’unification relative
du marché mondial [O’Rourke et Williamson, 2000]. En ce sens, l’économie de marché globale stimulée par la mondia-
lisation contemporaine ne serait peut-être que le quatrième avatar d’un même processus récurrent.
La mondialisation contemporaine a tout autant bouleversé le panorama des régulations économiques [Norel, 2004] et,
dans beaucoup de ces champs, le retrait de l’État national devient une évidence. C’est évidemment le cas pour ce qui
est des pratiques de stabilisation conjoncturelle de l’économie (relance en cas de chômage ou refroidissement en cas
d’inflation) : en trente ans on est passé, notamment en Europe, d’une régulation par les États nationaux à une régula-
tion d’abord internationale puis de plus en plus supranationale. En clair, la zone Euro a confié cette régulation au mé-
canisme abstrait du traité de Maastricht puis à la banque centrale européenne, organisme supranational de droit. De
leur côté, bien des États ont dû accepter une influence de plus en plus forte du Fonds monétaire international dans
leurs décisions, sachant que ce dernier est de moins en moins un organisme inter-étatique. De la même façon, les pra-
tiques de supervision des marchés nationaux concrets, notamment pour éviter les abus de position dominante, sont
largement passées, avec la déréglementation, aux mains de commissions ou autorités administratives indépendantes,
quand elles n’ont pas été largement démantelées comme aux États-Unis. Enfin, les régulations internationales menées
par des organismes inter-étatiques dans le cadre de ce qui s’est appelé des « régimes internationaux » ont elles aussi été
transformées : le GATT a cédé la place à une OMC qui est toute puissante sur le règlement des différends commer-
ciaux, les questions monétaires internationales sont désormais du ressort d’un FMI qui s’est historiquement mué en
institution au-dessus des nations. Et si l’on évoque une gouvernance globale comme ensemble de pratiques se substi-
tuant aux anciens régimes internationaux, c’est pour mieux marquer le recul des États, au profit des intérêts privés,
sans doute aussi pour une part de la société civile…
Troisième interprétation, l’évolution contrastée de l’inégalité globale, avec une hausse de cette dernière jusque vers
1990, un recul assez marqué depuis. Parallèlement, c’est bien le fait que cette récente diminution de l’inégalité globale
s’accompagne d’une remontée des inégalités internes qui est particulièrement frappant. Comme si un certain lissage de
l’inégalité entre nations et une baisse concomitante des inégalités globales devaient se payer par une reprise des vieilles
inégalités sociales à l’intérieur des nations. Sauf que cette fois, l’inégalité historique ne concernerait pas tant une hypo-
thétique classe ouvrière qui perdrait du terrain face à la bourgeoisie, que l’opposition de travailleurs sédentaires (secteur
public, services, secteur privé non concurrencé internationalement) à des travailleurs nomades (produisant des biens et
services sur un marché international ouvert). Les menaces et opportunités concernant les emplois nomades d’un pays
ont des répercussions sur le volume et le revenu de ses emplois sédentaires. Dans cette conjecture, par ailleurs com-
plexe, Giraud [2012] montre que la baisse de l’inégalité interne ne peut survenir que si la proposition des emplois no-
mades dans le total progresse d’une part, que la préférence pour les biens et services locaux augmente d’autre part. Sur
ce plan donc, la mondialisation débouche sur une situation socialement dangereuse mais qui peut aussi être regardée
comme un enjeu véritable de politique socio-économique encore partiellement dans les mains des gouvernements…
La quatrième interprétation est bien connue des lecteurs de ce blog et des familiers de l’histoire globale… Et si
l’émergence récente de la Chine (à un moindre degré de l’Inde), voire plutôt leur ré-émergence, constituait finalement
le résultat le plus structurel et le plus durable de la mondialisation contemporaine… Dans le cas chinois, il est au-
jourd’hui reconnu que son essor a commencé sous la dynastie Tang (618-907) et a peut-être connu son apogée aux 12e
et 13e siècles avec les Song du Sud. L’économie est alors parmi les plus productives au monde (notamment dans la
fabrique de la fonte) mais se caractérise aussi par une remarquable capacité exportatrice, notamment en permettant à
ses ateliers textiles ruraux d’écouler leur produit sur les marchés extérieurs ; c’est aussi la période où la Chine spécialise
régionalement son agriculture et invente le papier-monnaie. À l’époque la Chine dispose certainement d’excédents
commerciaux réguliers, diffuse ses produits phares sur toute l’Eufrasie, draine des montants importants de métaux
précieux depuis l’Europe au titre du paiement, un peu comme aujourd’hui… De ce point de vue, la mondialisation
contemporaine serait peut-être d’abord et avant tout un retour de l’importance et de l’influence passées. Non que cette
mondialisation soit un pur outil au service du renouveau chinois bien sûr : ce n’est pas la Chine qui l’a impulsée mais
plutôt les États-Unis en libéralisant les premiers les mouvements planétaires de capitaux. Mais le résultat est au-
jourd’hui bien présent : la Chine a réussi à instrumentaliser de façon durable un processus qu’elle n’a pourtant nulle-
ment créé.
Bibliographie
Giraud P.-N. [2012], La Mondialisation. Émergences et fragmentations, Paris, Éd. Sciences Humaines.
Norel P. [2004], L’Invention du Marché. Une histoire économique de la mondialisation, Paris, Seuil.
O’Rourke K., Williamson J. [2000], Globalization and History, Cambridge, The MIT Press.
Philippe Norel – décembre 2012
http://blogs.histoireglobale.com/interpretations-de-la-mondialisation-economique-contemporaine_2327

Doc. 4 - L'unification progressive des économies-mondes
Les grandes découvertes du XVe siècle, celles de Christophe Colomb (1492), de Vasco de Gama (1497-1498), de Fer-
nand de Magellan et d'El Cano (1519-1521) en tête, ont constitué un moment essentiel du grand mouvement d'unifica-
tion économique de l'espace mondial. Ce processus a cependant des racines beaucoup plus lointaines. C'est dès la
préhistoire que l'on peut commencer à repérer l'amorce du décloisonnement généralisé des sociétés, qui mène à la
constitution d'espaces économiques de plus en plus vastes et de plus en plus intégrés.
Si les archéologues peuvent retrouver lors des fouilles des objets dont la facture et la matière ne correspondent pas aux
ressources ou aux technologies locales, il s'en faut cependant de beaucoup qu'ils puissent retracer des parcours com-
merciaux ou conclure à l'existence de routes commerciales fixes et de bassins d'échanges. Jean Guilaine, l'un des meil-
leurs préhistoriens français, invite à une grande prudence sur le sujet: "Il n'est pas toujours aisé de démontrer la circulation de
certains matériaux et, par-là même, de se faire une idée des contacts entretenus par les populations préhistorique". Dans une synthèse
toute récente, Jean-Pierre Mohen et Yvette Taborin décrivent un monde de la fin du paléolithique où l'origine de plus
de 95% des objets retrouvés dans les sites ne dépasse pas un horizon de 5 kilomètres, les 5% restants venant de 80 à
100 kilomètres.
Des espaces structurés par les échanges
Il faut attendre des temps relativement récents (entre 15 000 et 10 000 environ avant notre ère) pour que les informa-
tions deviennent moins difficiles à interpréter et que l'analyse d'espaces structurés par des échanges sorte de la brume
du temps. Ainsi, on peut repérer une "route de l'obsidienne", qui englobe le bassin méditerranéen et le Proche-Orient
(de l'Anatolie à l'Euphrate) dès avant 10 000 av J.-C. Même si les quantités restent limitées (un millier de pièces décou-
vertes à Pescale, en Italie centrale, par exemple, originaires semble-t-il de Sardaigne), elles montrent qu'il faut "en finir
avec l'idée que les premières communautés agricoles vivaient dans une sorte d'autarcie frileuse (…): ces groupes troquaient bien des objets,
utiles ou "inutiles", c'est-à-dire symboliques, dans ce dernier cas, chargés d'une valeur codée".
En restant toujours dans cet exemple mieux étudié de l'obsidienne dans l'aire méditerranéenne, les archéologues pen-
sent pouvoir déduire des fouilles l'existence de groupes spécialisés dans la fabrication de ces objets ou dans leur trans-
port: "Aller chercher de l'obsidienne à Melos [île grecque des Cyclades] n'était pas une partie de plaisir, mais une opération mettant en
jeu de multiples savoirs. Il semble donc peu probable que les utilisateurs aient eux-mêmes réalisé de telles expéditions, car ils auraient dû
posséder de solides connaissances maritimes. Les déplacements par mer ne pouvaient donc être effectués que par des spécialistes."
On peut retrouver des éléments analogues dans d'autres espaces culturels: la Chine, l'Inde, l'Europe du Nord, l'Afrique
de l'Ouest, l'Amérique centrale connaissent, elles aussi, des échanges commerciaux à long rayon d'action dès les socié-
tés préhistoriques. Ainsi, l'Europe du Nord voit se mettre en place, pendant le premier millénaire avant Jésus-Christ,
une "route de l'ambre" particulièrement active: elle relie et traverse les groupes protohistoriques de la Baltique jusqu'à
la mer Noire. Quant au grand ensemble commercial connu sous le nom de "route de la soie", il se met en place dès le
premier millénaire avant notre ère.
Économies-mondes et impérialisme colonial
C'est cependant avec la naissance des grandes civilisations centralisées, urbaines et étatiques que l'on voit véritablement
apparaître ce que nous appelons, à la suite de Fernand Braudel, les "économies-mondes". Ce sont de véritables frag-
ments du monde, de très grandes échelles, autonomes et dépassant largement les structures politiques comme les
royaumes et les empires, même vastes, qui en sont le coeur. "Il y a eu des économies-mondes depuis toujours, pour le moins depuis
très longtemps (…). En descendant le cours de l'histoire avec des bottes de sept lieux, nous dirions de la Phénicie antique qu'elle fut (…)
une économie-monde. De même Carthage au temps de sa splendeur. De même l'univers hellénistique [et] Rome".
Avec la chute de l'Empire romain, le monde arabo-musulman du XIIe siècle forme à son tour une économie-monde.
C'est la Méditerranée au temps de Philippe II, roi d'Espagne, au XVIe siècle. Divisée politiquement, culturellement et
socialement, elle accepte pourtant une certaine unité économique construite par les villes dominantes du bassin: Gênes,
Venise, Florence…, mais aussi Tunis, Tripoli et Alexandrie. C'est la Chine des Ming (XIVe-XVIIe siècles) qui organise
aussi bien l'ouverture de routes commerciales vers l'Insulinde et l'Afrique, que le transfert de la capitale à Pékin et la
restauration de la Grande Muraille. Ce sont les grands ensembles précolombiens aussi bien Aztèque qu'Inca.
Après les grandes découvertes, les différentes phases de l'impérialisme européen (XVIe-XIXe siècles) vont transformer
cet ensemble d'économies-mondes juxtaposées et autonomes - s'ignorant souvent les unes les autres - en un espace
économique à la fois d'échelle mondiale et traversé par des processus planétaires. D'abord par la projection des comp-
toirs économiques sur l'ensemble de la planète entre le XVIe et le XVIIIe siècle (voir page 47): colonies américaines,
comptoirs esclavagistes en Afrique, comptoirs hollandais, anglais et français en Inde (avec la création de ces véritables
firmes multinationales avant l'heure que sont les compagnies maritimes des Indes françaises et hollandaises).
Ensuite par les différentes phases de la colonisation territoriale: la première consacre l'extension de l'influence euro-
péenne en Amérique (XVIe-XVIIe siècles) et la seconde (celle du XIXe siècle) l'étend à l'Afrique, à l'Asie du Sud et du
Sud-Est (colonisation des Indes par le Royaume-Uni et contrôle des routes terrestres et maritimes vers l'Inde), au dé-
coupage de la Chine et du Moyen-Orient au début du XXe siècle, voire à la colonisation menée par l'Empire russe à
l'intérieur de son propre territoire.
Les historiens actuels n'hésitent d'ailleurs plus à voir dans cette période qui s'étend de 1870 à 1914 une "première mondia-
lisation", pour reprendre l'expression de Suzanne Berger, ne serait-ce que par la masse des investissements extérieurs
partant d'Europe vers la Russie (pour la France) et l'Inde (pour le Royaume-Uni). La guerre de 1914-1918 y a mis fin.
Elle a vu la naissance de l'Empire soviétique et s'est prolongée avec la crise de 1929 et la Seconde Guerre mondiale,
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%