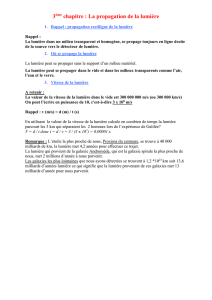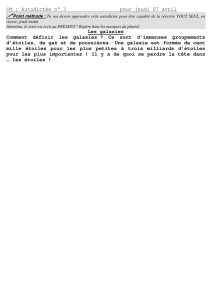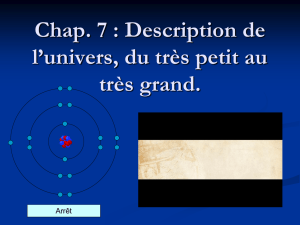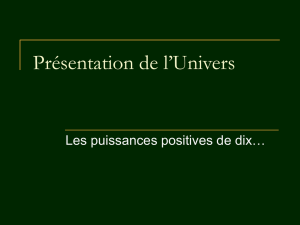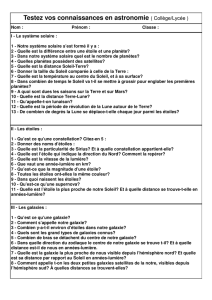la voie lactee - LaCaverneD`AliBaba

1
GALAXIES
Les galaxies sont des systèmes constitués de centaines de milliards d’étoiles et de
gaz situé entre les étoiles, appelé milieu interstellaire. Ces gigantesques systèmes
sont nés, quelques temps après la naissance de l’Univers, à partir d’énormes
nuages de gaz, à l’intérieur desquels se sont formés, par effondrement
gravitationnel, des amas d’étoiles.
La forme d’une galaxie est variable. Il existe des galaxies elliptiques, spirales et
irrégulières. Notre étoile, le Soleil, se trouve à l’intérieur d’une galaxie spirale
appelée Voie Lactée.
Il y a une centaine d’années, les astronomes pensaient que notre Galaxie était la
seule galaxie de l’Univers. Avec le perfectionnement des instruments et des
moyens d’observation, le nombre des galaxies que l’on connaît n’a cessé de croître.
On estime qu’il existe au moins cent milliards de galaxies.
LA VOIE LACTÉE
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
La Voie Lactée, qui est notre propre Galaxie, est une galaxie spirale plutôt
ordinaire, présentant des bras de matière tournant autour d’un noyau central. Si l’on
prend le Soleil comme référence, la luminosité de notre Galaxie est comparable à
celle de vingt milliards de soleils mis ensemble, et sa masse est égale à environ
150 milliards de fois la masse solaire.
FORME ET DIMENSIONS
La Galaxie a la forme d’un gigantesque disque très écrasé (le plan galactique),
d’environ 100 000 années-lumière de diamètre. Le
se trouve à peu près à mi-chemin de son centre. Sur le bord, l’épaisseur du disque
ne dépasse pas 3 000 années-lumière, tandis qu’au centre du disque, la distribution
s’élargit et l’on observe un renflement sphérique, le noyau, composé presque
exclusivement d’étoiles. L’épaisseur du bulbe atteint 15 000 années-lumière. Les
gaz et les poussières forment une mince couche à l’intérieur d’un disque plus épais
peuplé d’étoiles. C’est là que se trouvent les nuages géants d’hydrogène
moléculaire, qui donnent lieu à la formation de nouvelles étoiles.
Le disque galactique est enveloppé par ailleurs par un grand volume sphérique, le
halo galactique. Son diamètre est d’environ 100 000 années-lumière, et il apparaît
presque entièrement privé de nuages de gaz et de poussière, mais peuplé d’étoiles
isolées et d’amas sphériques brillants, les amas globulaires. Constitués d’étoiles
beaucoup plus vieilles que les étoiles présentes dans le disque, ces amas sont
considérés comme les résidus des tout premiers stades de formation de la Galaxie.
Celle-ci se caractérise en outre par ses grands bras. Il s’agit de concentrations
d’étoiles et de gaz interstellaire, qui partent de son centre et s’enroulent en spirale.
Les bras contiennent la plupart de l’activité de formation stellaire. Le bras le plus
long de la Galaxie a une longueur totale d’environ 125 000 années-lumière.

2
Si nous pouvions l’observer par la tranche, la Galaxie nous apparaîtrait comme un
énorme fuseau brillant entouré d’une vague luminosité et coupé en son centre par
une bande sombre, qui la divise en deux grands fleuves d’étoiles parallèles. Cet
effet est dû à l’absorption de la lumière des étoiles par la poussière interstellaire
concentrée dans le disque. Vue de face, en revanche, avec ses grands bras
spiraux, la Galaxie ressemblerait plutôt à une gigantesque roue à vent, légèrement
colorée de jaune orangé dans la zone centrale, le bulbe, constitué d’une population
d’étoiles relativement vieilles, et coloré de blanc bleuté dans les bras spiraux où des
milliards d’étoiles bleues et blanches plutôt jeunes et massives se regroupent.
LE CENTRE DE LA GALAXIE
La poussière interstellaire qui se concentre dans le plan de la Voie Lactée nous
cache presque entièrement le cœur de la Galaxie. À cause du phénomène de
l’extinction stellaire, les grains de poussière représentent un obstacle insurmontable
pour les rayonnements à certaines longueurs d’onde, comme l’est précisément le
rayonnement émis dans le spectre visible. Ce dernier ne parvient pas à atteindre
l’observateur. Pour explorer le centre de la Voie Lactée, il est nécessaire par
conséquent de procéder à des observations à des longueurs d’onde plus grandes
que le domaine visible (infrarouge et radio), mais aussi à des longueurs d’onde très
courtes comme les domaines X et . Les informations disponibles sur le noyau
galactique, la zone qui s’étend sur plusieurs milliers d’années-lumière à partir du
centre, proviennent des électrons (ondes électromagnétiques) qui se déplacent à
des vitesses proches de la vitesse de la lumière (c’est le rayonnement synchrotron),
de l’émission infrarouge de poussières et d’atomes ionisés de température très
élevée, et de l’émission en micro-ondes de nombreuses molécules, parmi
lesquelles le monoxyde de carbone.
Il ressort de l’ensemble de ces informations que la région centrale de la Galaxie est
occupée par un disque de gaz moléculaire animé d’une rotation rapide et par une
grande concentration d’étoiles. La densité des étoiles dans cette zone est en effet
au moins un million de fois plus grande qu’à proximité du Soleil. La masse totale
des étoiles contenues dans ce volume est d’environ dix milliards de masses
solaires, c’est-à-dire un vingtième de la masse galactique totale.
Si l’on se déplace vers le centre dynamique de la Galaxie, à 6 années-lumière
environ, on distingue une certaine quantité de matière qui pourrait être constituée
de nuages de gaz ionisé, présentant un mouvement de chute vers un point
particulier, situé dans la constellation du Sagittaire, connue sous le nom de
Sagittarius A. Sagittarius A est une source radio compacte (de diamètre inférieur à
20 Unités Astronomiques) qui coïncide avec le centre dynamique de la Galaxie.
On ne sait pas encore ce qu’est cette mystérieuse source ni ce qui se cache au
centre de la Galaxie, où tant de matière est violemment attirée. Toutes les mesures
semblent indiquer la présence d’une concentration exceptionnelle de masse. Peut-
être un trou noir, mais cela reste à démontrer. Pour l’instant, la nature du cœur de
la Galaxie demeure un mystère.
MASSE GALACTIQUE ET COURBES DE ROTATION
Par analogie avec le mouvement des planètes autour du Soleil, on a cru longtemps
que dans notre Galaxie les parties les plus proches du centre tournaient plus

3
rapidement que les parties situées à la périphérie, autrement dit que la vitesse de
rotation diminuait proportionnellement à l'éloignement du centre.
Cette conviction s’appuyait sur l’hypothèse que la masse d’une galaxie était
concentrée pour la plupart dans le noyau central.
En mesurant la courbe de rotation de la Galaxie, c’est-à-dire sa vitesse de rotation
en fonction de l'éloignement au centre, on s’est rendu compte que, quand on
s’éloigne vers l’extrême périphérie de la Galaxie, la vitesse de rotation ne diminue
pas mais demeure constante. Cela signifie que la masse de la Galaxie est
distribuée de façon plus uniforme qu’on ne s’y attendait. La masse gravitationnelle
de la Galaxie (gravitation) qu’il est possible de déduire de la courbe de rotation, dite
aussi masse « dynamique », est égale à trois cents milliards de masses solaires.
Par ailleurs, si l’on comptabilise la masse du halo de la Galaxie, alors cette masse
dynamique totale s’élève à environ 1 000 milliards de masses solaires.
Il existe deux façons de calculer la quantité de matière présente dans un lieu
donné. Cette valeur peut être calculée à partir de l’attraction gravitationnelle que ce
lieu exerce sur les corps voisins, ou bien à partir de la quantité de rayonnement
électromagnétique qu’il émet.
Dans le cas de notre Galaxie, la masse « visible » déduite grâce à la quantité de
rayonnement émis est sensiblement inférieure à la masse dynamique mesurée au
moyen des courbes de rotation. Une interprétation possible de cette différence
réside dans l’existence de matière obscure qui n’émet aucun type de rayonnement,
mais contribue au bilan gravitationnel de la Galaxie dans son ensemble. Les
candidats proposés pour expliquer l’existence de cette matière invisible sont
nombreux. Parmi eux, citons une possible concentration de trous noirs ou encore
de petits corps, étoiles ratées nommées naines brunes, ou encore une substance
inconnue des physiciens. Ce sujet reste pour l’instant un mystère des plus
passionnants.
COMPOSITION GALACTIQUE
Notre Galaxie est un grand agrégat d’étoiles, de gaz et de poussière interstellaire,
dont la cohésion est assurée par la force gravitationnelle. À côté de cela, on ne doit
pas oublier les rayons cosmiques, et le champ magnétique galactique qui joue un
rôle non négligeable dans la physique de notre Galaxie.
Le milieu interstellaire
Les étoiles qui composent notre Galaxie sont plus de 200 milliards, et la distance
moyenne qui sépare deux étoiles de la Voie Lactée est très grande. À l’intérieur
d’un cube ayant un côté égal à cinq années-lumière, on trouve en moyenne une
seule étoile. L’immense espace autour de l’étoile n’est pas vide, mais est rempli par
le milieu interstellaire qui se présente sous la forme de gaz et de poussière. La
masse totale du milieu interstellaire est d’environ un dixième de la masse de toutes
les étoiles de la Galaxie. Mais le milieu interstellaire et les étoiles ne sont pas deux
choses distinctes. Au contraire, le gaz interstellaire est l’élément indispensable à la
naissance des étoiles qui, à leur tour, lui restituent de la matière enrichie sous
forme d'éléments lourds (carbone, oxygène, calcium, fer, etc.), synthétisés au cours
de leur existence. Le milieu interstellaire a une structure très hétérogène. Il peut se
présenter sous la forme de condensations de matière, telles que les nébuleuses

4
brillantes, divisées en nébuleuses à réflexion (si elles reflètent la lumière d’une
étoile proche) et en nébuleuses à émission (si la lumière émise est un effet de
l’excitation atomique provoquée par la présence d’une étoile proche) et les
nébuleuses obscures, ainsi appelées parce qu’elles se trouvent à une grande
distance des étoiles et ne sont pas éclairées par ces dernières. Le milieu
interstellaire est distribué surtout le long du plan galactique et, est beaucoup plus
raréfié, également dans le halo.
Le gaz interstellaire
Le gaz interstellaire se compose d’atomes et de molécules dispersés entre les
étoiles, dont la densité dans le plan galactique ne dépasse pas celle d’une particule
par centimètre cube.
La plupart des informations que nous possédons sur le gaz interstellaire provient de
l’observation des ondes radio émises (ondes électromagnétiques). Dans le spectre
radio, la longueur d’onde radio à 21 cm a un rôle privilégié car elle représente la
fréquence d’émission de l’hydrogène atomique, qui est l’élément le plus abondant
parmi les éléments présents dans l’espace interstellaire. Sur cent atomes en effet,
au moins 90 sont d’hydrogène, tandis que les atomes restants sont l’hélium
(environ 9 %), l’azote, l’oxygène, le carbone... L’observation du ciel à la longueur
d’onde de 21 cm a permis de réaliser une carte des régions de la Galaxie riches en
hydrogène atomique. De cette façon, on s’est rendu compte que le gaz n’est pas
distribué uniformément le long du disque de la Galaxie, mais se concentre dans la
région centrale et le long des bras spiraux. Toujours grâce aux observations radio,
on a pu constater que l’hydrogène neutre, indiqué par le symbole HI, se présente
sous la forme de nébuleuses obscures de masse comprise entre 0,1 et
1 000 masses solaires. Ces nuages ont une densité d’environ cinquante particules
par centimètre cube, une densité très basse si l’on songe que, pour réaliser le
« vide » dans un laboratoire, on ne parvient pas à descendre au-dessous de cette
valeur. La température des nuages elle aussi est très basse, environ -200°C.
Dans la gamme du visible, on peut observer par contre les régions HII, nébuleuses
brillantes à émission, considérées comme les objets astronomiques les plus beaux
de notre Galaxie. Ces grands nuages d’hydrogène ionisé (ion) sont en général
associés à des étoiles jeunes, massives, très lumineuses et chaudes, qui émettent
intensément dans l’ultraviolet. Leurs dimensions varient d’une année-lumière à
plusieurs centaines d’années-lumière, et leur température peut atteindre jusqu’à
10 000 degrés Kelvins.
D’autres constituants importants du gaz interstellaire sont les nuages moléculaires,
vastes amas de gaz contenant une grande quantité de molécules, qui ont été
découvertes au fur et à mesure, ces trente dernières années, grâce à leurs
émissions dans le domaine des ondes millimétriques. La première de ces
molécules, le radical hydroxyle ou radical OH, fut découverte en 1963. À ce jour, les
espèces de molécules interstellaires connues sont plus de 90, et la plupart sont des
molécules organiques. Nombre de ces molécules sont présentes aussi sur Terre.
Par exemple, il existe des observations d’alcool éthylique en condensation
gazeuse, dans des proportions telles qu’elles pourraient remplir d’alcool environ
1028 bouteilles de whisky. La masse des nuages moléculaires dépasse
500 000 masses solaires, et leur densité dans les régions centrales est d’environ
10 000 particules par centimètre cube. La température est en général très basse,
dans certains cas inférieure à -260°C. L’observation dans le spectre infrarouge

5
(ondes électromagnétiques) semble indiquer que, précisément dans ces régions,
les étoiles sont actuellement en cours de formation. On estime que la moitié de la
masse du milieu interstellaire est condensée sous la forme de ces nuages et
complexes moléculaires. Comprendre la naissance d’une étoile passe
nécessairement par l’étude et l’analyse des processus physiques et chimiques qui
ont lieu à l’intérieur de ces nuages.
Les nuages moléculaires et les nuages d’hydrogène neutre ne remplissent pas
toutefois la totalité du volume interstellaire. Les observations dans l’ultraviolet et
dans le spectre des rayons X ont mis en évidence l’existence d’un gaz très chaud,
d’une température comprise entre 500 000 et 1 million de degrés Kelvins, et
extrêmement dilué (3 000 particules par mètre cube). Selon toute probabilité, ce
gaz est la conséquence des explosions de supernovae, explosions qui dans la
Galaxie ont lieu environ tous les trente ans.
La poussière interstellaire
On estime qu’il y a dans notre Galaxie environ 1053 grains de poussière
interstellaire, c’est-à-dire le double des grains de sable estimés sur Terre. Bien
qu’elles représentent moins de 2 % de la masse entière du milieu interstellaire, les
poussières jouent un rôle très important dans la vie de la Galaxie. Elles absorbent
en effet la lumière stellaire, en émettant aussi, dans l’infrarouge lointain (ondes
électromagnétiques), plus d’énergie que les étoiles elles-mêmes. Ces poussières
sont par ailleurs le siège de formation de la molécule interstellaire la plus
abondante de l’Univers, la molécule d’hydrogène. Les poussières occultent la
lumière des étoiles devant lesquelles elles sont interposées. Ce phénomène,
appelé extinction interstellaire, est causé d’un côté par l’absorption réelle de la
lumière par les poussières, qui par conséquent chauffent, et de l’autre par la
diffusion de cette lumière dans des directions différentes de leur direction d’origine.
Ce dernier effet, qui correspond à un phénomène qui en optique s’appelle diffusion
de la lumière, fait que la quantité de lumière observée est inférieure à la quantité
effectivement émise par l’étoile. Le phénomène de l’extinction interstellaire
représente un grand problème pour les astronomes. La lumière de milliards
d’étoiles dans la direction du centre de notre Galaxie est absorbée ou interceptée
par une grande quantité de poussières sombres qui divisent la Voie Lactée, si nous
l’observons de biais, en deux longs fleuves d’étoiles parallèles. L’extinction
interstellaire dépend fortement des longueurs d’onde d’observation. Puisque la
poussière est constituée de grains de moins d’un micron (10-6 m), l’effet de
l’extinction interstellaire est d’autant plus sensible que la longueur d’onde est plus
petite. Il est donc pratiquement nul dans l’infrarouge lointain et dans les ondes
radio, tandis qu’il est important dans le visible et dans l’ultraviolet, où il atteint son
maximum pour une valeur de longueur d’onde égale à environ 2200 Å. Par
conséquent, si une étoile se trouve derrière un nuage de poussière, elle nous
semblera plus rouge qu’elle ne l’est en réalité. La mesure du changement de
couleur (rougissement interstellaire) d’une étoile donnée, comparée à celle d’une
étoile semblable non occultée par la poussière, permet de remonter à la quantité de
poussière interposée entre l’étoile et nous. On a observé qu’en général, cette
quantité est proportionnelle à la quantité de gaz interstellaire présent, ce qui
démontre que la poussière et le gaz du milieu interstellaire sont bien mélangés.
L’énergie de la lumière absorbée réchauffe les poussières interstellaires, mais cette
augmentation de température est gênée par la perte de chaleur par rayonnement
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
1
/
31
100%