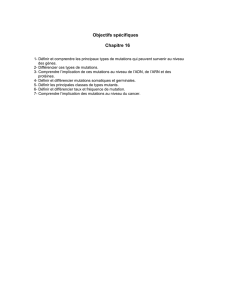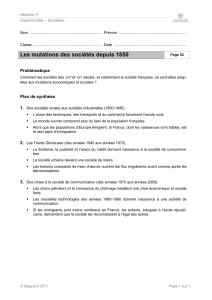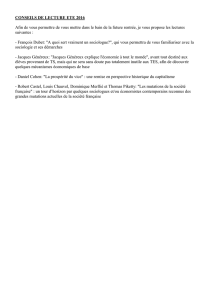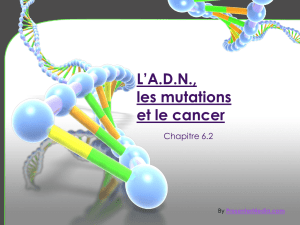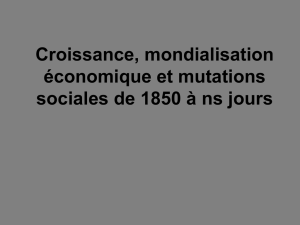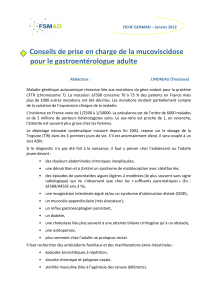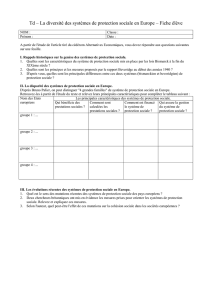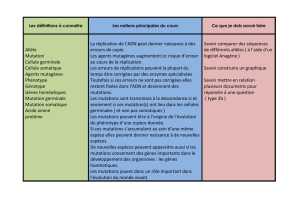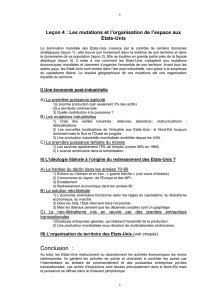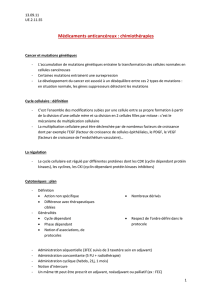les mutations de l`économie française - ac-nancy

G.4. Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques. 1/5
Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques
Introduction : Malgré sa taille modeste, la France est la quatrième puissance mondiale, derrière les Etats-Unis,
le Japon et l’Allemagne. Elle tient son rang grâce au dynamisme de l’agriculture, de l’industrie et du tourisme.
La France s’est bien insérée dans l’Union européenne où elle joue un rôle primordial sur les plans économique,
politique et diplomatique. En s’ouvrant sur le monde et sur l’Europe, la France a dû s’adapter et se moderniser
dans tous les domaines.
Pb. : Quelles grandes mutations l’économie française a-t-elle connues ? Quelle est l’ampleur de ces
mutations ? Comment ces mutations ont-elles transformé l’espace français ?
1. Les mutations du système productif.
Pb. : Comme tous les pays industrialisés, la France s’adapte à la révolution technologique. Quels en sont les
principaux effets ?
1.1. La révolution de l’électronique et l’informatique.
Les progrès rapides de l’électronique et l’informatique permettent aux entreprises de travailler plus vite
et plus efficacement.
La production industrielle est de plus en plus assurée par de robots. Des usines entières sont contrôlées à
partir de postes de commande électronique : c’est le cas des centrales nucléaires ou des usines d’aluminium.
Dans les banques, les assurances, les entreprises de transport, la presse, etc., toute l’activité est informatisée.
Les effets de cette mutation sont considérables aussi bien dans l’organisation du travail que dans la
localisation des activités.
1.2. La transformation du travail.
La généralisation de l’ordinateur entraîne une nouvelle organisation du travail. L’emploi peu qualifié
tend à disparaître dans l’industrie comme dans les services. En revanche, les techniciens et les cadres sont de
plus en plus nombreux.
L’informatique est devenue une activité vitale dans toutes les entreprises. Désormais, créer un
produit, chercher à le produire au prix le plus bas, gérer sa fabrication, le vendre, occupent plus de salariés que
de la fabriquer.
C’est pourquoi les activités de recherche, de gestion ou de commerce se développent. Les sièges
sociaux des entreprises qui regroupent ces activités prennent de plus en plus d’ampleur et occupent de grands
immeubles. Les bureaux se multiplient.
1.3. L’espace productif remodelé.
La localisation des activités a été remodelée. Les entreprises recherchent une main-d’œuvre qualifiée,
la proximité des centres de consommation, le voisinage des centres universitaires et de recherche, l’accès
rapide à l’innovation scientifique et technique. Tous ces facteurs de localisation sont réunis par les grandes
métropoles (= très grande agglomération qui étend son influence sur toute une région). Des quartiers entiers
de bureaux se construisent au centre des villes. Les sièges sociaux se rassemblent dans des centres d’affaires,
comme celui de la Défense à Paris ou la Part-Dieu à Lyon.
Les villes qui connaissent ces évolutions se modifient. L’industrie a quitté le centre des villes pour la
périphérie. A la place des anciennes usines, on construit des immeubles d’entreprises dans des espaces verts.
Dans les zones d’activités, aux abords des villes, se mêlent entrepôts, bâtiments industriels et commerciaux,
laboratoires de recherche. C’est le cas aussi, à une plus vaste échelle encore, dans les technopôles (= site sur
lequel sont développées des activités de formation, de recherche et de production orientées vers les nouvelles
technologies).

G.4. Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques. 2/5
2. La première agriculture d’Europe.
Pb. : Comment, en une génération, la France est-elle devenue le deuxième exportateur mondial de produits
agricoles ?
2.1. Performances et modernisation.
La France est devenue le premier pays agricole d’Europe et le second du monde pour les exportations.
La vente de ses produits, transformés par de puissantes industries agroalimentaires (= secteur d’activité qui
transforme les produits agricoles en denrées alimentaires pour les hommes et les animaux), lui procure
d’importants excédents commerciaux. L’agriculture est devenue le « pétrole vert » de la France.
La sélection très poussée des variétés de plantes cultivées, des races animales, l’utilisation croissante
de produits chimiques ont permis de diversifier et d’augmenter les productions et la productivité (=
augmentation de la production par travailleur et par heure de travail).
Cette modernisation, complétée par le développement de l’irrigation, affranchit de plus en plus
l’agriculture des contraintes naturelles. C’est particulièrement le cas pour les productions « hors-sol » réalisées
dans des serres ou dans les élevages intensifs « en batterie ».
Pourtant, l’usage immodéré d’engrais, des pesticides et de l’élevage hors-sol est aujourd’hui remis en
question car ces pratiques entraînent une grave pollution du sous-sol et nappes d’eau profondes (nappes
phréatiques).
2.2. Un monde rural nouveau.
La modernisation a bouleversé le monde rural. Les agriculteurs y sont devenus minoritaires. Leur
nombre a été divisé par cinq depuis 1960. Ils ne constituent plus que 4,3% des actifs.
Confrontés à une concurrence vive, accusés de dégrader l’environnement et de privilégier la quantité
aux dépens de la qualité, les agriculteurs manifestent parfois leur mécontentement.
Ils dépendent de plus en plus des industries agroalimentaires et des intermédiaires qui alimentent les
grandes surfaces. Leur sort dépend également des décisions de l’Union européenne et de la politique agricole
commune (PAC) qui fixe les prix des produits et subventionne les régions en difficulté. Ainsi, dans certaines
régions délaissées de montagne, les agriculteurs survivent grâce aux aides qui leur sont accordées pour
conserver les paysages.
Les paysages se transforment sous les effets conjugués de la diversification des activités rurales
(tourisme vert, résidences secondaires, activités urbaines) et de la spécialisation agricole. Ainsi la
céréaliculture reste l’activité principale dans les paysages de champs ouverts. Les bocages, bien qu’en recul,
correspondent aux activités d’élevage, tandis que les cultures fruitières et maraîchères se développent et créent
des paysages jardinés, parfois sous serres.
Malgré la diminution des agriculteurs, la désertification s’est ralentie sous l’effet de la
périurbanisation (= urbanisation des espaces ruraux à la périphérie des agglomérations). On assiste même à
une renaissance rurale du fait de l’installation dans les campagnes d’employés, d’ouvriers et de retraités.

G.4. Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques. 3/5
3. Un nouvel espace industriel.
Pb. : La France se situe au 4e rang mondial des puissances industrielles à la suite d’une phase de modernisation
difficile mais réussie. Quels sont les atouts et les faiblesses de l’industrie française ?
3.1. Les difficultés d’adaptation.
Après le redressement industriel de l’après-guerre (1945-1950) suivi d’une période de forte croissance
(1950-1973), l’industrie française a dû s’adapter à la révolution technologique et à la mondialisation.
Cette modernisation a entraîné une forte diminution des emplois peu qualifiés. Le nombre des salariés
de l’industrie est passé de 8 millions en 1975 à 5 millions aujourd’hui.
Avec la mondialisation, la concurrence s’est accentuée. Certaines branches industrielles comme le
textile, la sidérurgie ou constructions navales connaissent encore de graves difficultés. Dans d’autres secteurs
comme l’automobile, les entreprises françaises ont réussi leur adaptation et assurent à la France le quatrième
rang mondial.
3.2. Les atouts de l’industrie française.
Si quelques branches industrielles restent fragiles, la France est bien placée dans les industries de
pointe. Elle le doit au développement de la recherche civile et militaire dans les domaines de l’espace, de
l’aéronautique, de l’électronique et du nucléaire.
La contribution française au succès des fusées Ariane et des avions Airbus est décisive. Les industries
de l’armement permettent à la France d’être le troisième exportateur mondial. De même, la réussite du TGV
ouvre des marchés en Europe (Espagne) et dans le monde (Corée).
Les centrales nucléaires fournissent les ¾ de l’électricité. Toutefois, la question du nucléaire fait
toujours l’objet d’un débat car des inquiétudes subsistent quant aux effets sur l’environnement.
3.3. Un espace industriel remodelé.
La localisation des industries se modifie. Moins dépendantes des matières premières et des sources
d’énergie, elles recherchent surtout la qualité des services et la facilité des transports et communications.
Ce sont les métropoles qui remplissent le mieux ces conditions. Les établissements industriels
s’installent près des sorties d’autoroute, à proximité des ports et des aéroports. Toutes les grandes villes
ont aménagé des technopôles où la recherche et l’industrie collaborent étroitement.
Ainsi, les deux régions industrielles principales sont la région Ile-de-France qui s’organise autour de
Paris, métropole mondiale, et la région Rhône-Alpes, en situation de carrefour ouvert sur l’Europe.
Cependant, l’ouest et le sud de la France attirent de plus en plus les industries de l’avenir :
électronique, aéronautique, bio-industries.

G.4. Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques. 4/5
4. La croissance des services.
Pb. : Les services quotidiens (santé, éducation, loisirs) ou ceux qui servent aux entreprises (banques,
assurances, publicité) connaissent une croissance rapide. Pourquoi et où se développent-ils ?
4.1. Essor et diversité des services.
L’importance des services dans l’économie française ne cesse de grandir. Ce qu’on appelle le secteur
tertiaire (= ensemble regroupant les activités de commerce et de service) fournissait 40% des emplois en
1950 ; il en fournit 70% actuellement.
Cet essor est lié à l’élévation du niveau de vie et aux besoins de la société. Les individus sont de plus
en plus exigeants pour leur formation, leur santé, leur sécurité, leurs loisirs et leur confort.
Il tient également à la complexité croissante des activités économiques. Dans les entreprises, la
recherche, la gestion du personnel, le conseil financier et juridique, la prospection des marchés, la publicité
prennent une part croissante. L’ensemble du monde économique est affecté par ces mutations.
4 .2. Les services se concentrent dans les villes.
Les services sont de nature et de niveaux très variés. Certains services satisfont des besoins de
proximité. Ils concernent tout le monde (école, commerce de détail, médecin généraliste, etc.). D’autres sont
des services plus rares, exigeant plus de qualifications (centre hospitalier, musées, enseignement supérieur,
grands équipements sportifs, aéroports).
La croissance de services s’inscrit dans les paysages. Restées longtemps diffuses dans le tissu urbain,
les activités de service se regroupent progressivement dans des quartiers d’affaires où la haute administration,
les sièges sociaux d’entreprises s’installent dans un paysage hérissé de tours de verre et de béton, comme celui
de la Défense à Paris.
Par contre, les grandes surfaces commerciales et les complexes sportifs avides d’espaces, s’implantent
surtout en périphérie des villes, près des grands nœuds de communication.
4.3. Les services hiérarchisent les villes.
La répartition des services commande l’organisation du territoire. Essentiellement urbains, ils
contribuent largement à la hiérarchie des villes.
Les villes petites et moyennes concentrent les services courants (collège, lycée, gendarmerie,
supermarché, etc.).
Les grandes villes proposent des services rares (universités, sièges sociaux d’entreprises, centres de
recherche, administration supérieure).
Ainsi, plus une ville est équipée, plus ses services sont complets, plus elle est attractive et rayonne
sur l’espace environnant. Les petites villes limitent leur influence à leur périphérie immédiate ; les capitales
régionales influencent toute une région ; Paris, capitale de la France, domine l’ensemble du territoire et c’est
une grande métropole européenne et mondiale.

G.4. Les mutations de l’économie française et leurs conséquences géographiques. 5/5
5. Le rôle des pouvoirs publics.
Pb. : Pourquoi les pouvoirs publics (Etat et collectivités territoriales) jouent-ils un rôle particulièrement
important en France ?
5.1. L’Etat, premier fournisseur de service.
La France s’est constituée autour d’un Etat fort et centralisé, soucieux d’encadrer la vie des citoyens et
les activités économiques. A la différence d’autres pays voisins ou des Etats-Unis, les services publics (=
services assurés par l’Etat ou sous son contrôle [ex. : l’enseignement, la Sécurité sociale, etc.]) sont gérés par
l’Etat et ont en charge des domaines essentiels de la vie sociale : santé, sécurité, éducation et communications.
La Sécurité sociale, la Poste, la SNCF, l’Education nationale sont des services auxquels les Français sont
particulièrement attachés.
Par ailleurs, l’Etat, en France, a longtemps cherché à orienter les activités économiques par la
planification (= action de prévoir les objectifs de la production. En France, le plan est seulement indicatif) ou
par des investissements. Il contrôlait le secteur de la banque et certaines entreprises industrielles. Il pratique
depuis plus de trente ans une politique d’aménagement du territoire qui vise à mieux répartir les activités sur
le territoire.
Malgré les privatisations (= vente d’actions d’une société contrôlée par l’Etat aux particuliers ou aux
entreprises privées [France Télécom, par ex.]), les pouvoirs publics (= pouvoirs exercés par l’Etat et les
collectivités territoriales) restent le premier fournisseur de services, le plus gros consommateur de biens
d’équipement et le premier employeur du pays : les fonctionnaires représentent le quart des salariés.
Depuis deux décennies, le rôle des pouvoirs publics se transforme. La décentralisation (= transfert
de compétences et de pouvoirs de l’Etat vers les collectivités territoriales), poursuivie depuis 1982, a augmenté
le rôle économique et social des départements et des régions. Par ailleurs, les activités économiques sont de
plus en plus orientées par les décisions de l’Union européenne.
5.2. L’Etat organise les communications et les transports.
Les pouvoirs publics ont permis l’essor fulgurant des télécommunications par l’intermédiaire de
France Télécom. Cette société, en partie privatisée, est l’un des tous premiers opérateurs internationaux sur les
réseaux essentiels : téléphone, Minitel, mobile (Orange), Internet (Wanadoo), et les réseaux d’entreprises
(Numéris, Transpac).
Les pouvoirs publics ont joué un rôle essentiel dans la modernisation du système des transports :
autoroutes, réseau ferré, TGV, construction d’aéroports, modernisation des ports. L’Etat et les collectivités
territoriales entretiennent et développent un réseau de transports modernes bien relié au réseau européen.
Malgré les efforts réalisés pour desservir toutes les régions, une part croissante des échanges se
concentre sur les grands axes. Cela renforce le rôle de certaines villes comme Paris, Lyon ou Lille.
Une question se pose aujourd’hui : la France pourra-t-elle maintenir sa particularité en ce qui concerne
le rôle des pouvoirs publics dans le cadre de l’unification européenne ?
1
/
5
100%