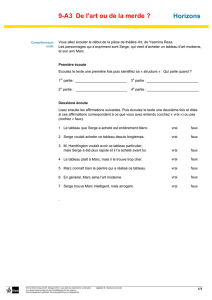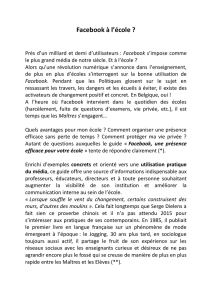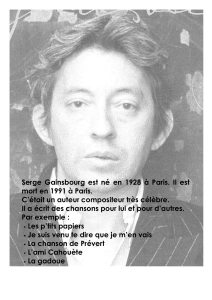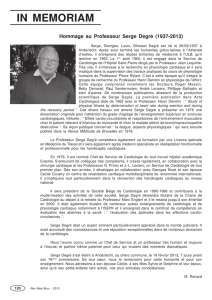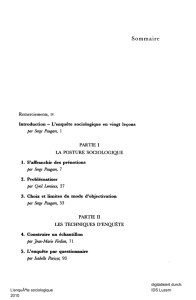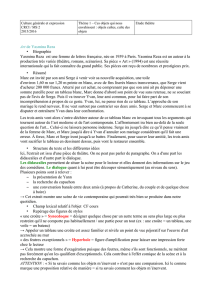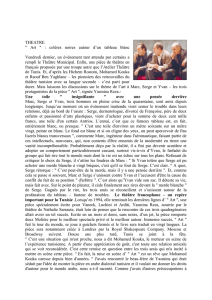Discours prononçé en l`honneur de Serge Coursan, comédien du

Page 1 sur 3- Philippe Caubère – Achives – Hommage à Serge Coursan - 1999
Discours prononçé en l’honneur de Serge Coursan, comédien du Théâtre du Soleil, mort le 28 février
1999.
SALUT COURSAN !
On m’a demandé de faire un discours sur Serge ; d’évoquer sa carrière. D’abord, je crois que je ne
saurais pas. Ensuite, je ne suis pas sûr que j’en ai vraiment envie. Je préfère laisser aller ma pensée au
gré de sa fantaisie. En vérité, je n’ai pas fait partie de ses vrais copains, de sa bande ; je pense à René
Patrigniani, à Roland Amstutz, à Jean-François Labouverie ou Régis Bouquet ; et tous ceux qui sont là
et que j’oublie — et qu’ils me le pardonnent — ou ceux qui ne sont pas là parce qu’ils n’ont pas pu. Ou
pas voulu. Pourtant, Serge, pour moi, c’était quelqu’un d’important. De très très important. Et d’autres
qui sont ici savent ce que je veux dire, parce que pour eux aussi, je sais que c’est la même chose.
Il y a quelques mois, Roger Van Loo, un autre de ses copains, — un Belge, mais quand même ! —,
m’avait dit :
— “ Tu sais, il va pas bien, Serge ; il a des problèmes. Il est dans la merde. ”
— “ Ah bon ?, je lui ai dit, quels problèmes ? ”
— “ Des problèmes de fric ; de boulot ; tout ça. ”
Le truc habituel, quoi. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais ça m’a foutu la trouille. Pourtant, les
problèmes, c’est pas ce qui manque aux comédiens ; on en a sans arrêt, surtout de fric. Mais là, je ne
sais pas si c’est l’histoire d’Amstutz ou quoi, —-ce type qui s’est jeté sous un train sans rien dire, sans
nous, loin de tout, et pour qui apparemment ce n’était pas une question d’argent — je me suis dit : ce
con, il va faire pareil. Alors, je l’ai appellé. Tout de suite. Ça faisait longtemps que je les avais pas eus,
Serge et Betty, mais aussitôt il m’a rassuré. Aprés, on y est allés, Clémence, Véronique et moi ; on a
bouffé ensemble dans leur joli appartement ; on s’est bien marré ; on s’est raconté nos vies.
Évidemment on a évoqué nos souvenirs, on a parlé d’Ariane, — pas trop ; c’était pas un obsédé,
contrairement à moi — bref, on a vu que peut-être ils avaient des problèmes, — sûrement même —
mais que c’était pas pour ça qu’ils allaient se faire sauter le caisson. Et quand je lui ai demandé ce que
je pouvais faire pour lui, comment je pourrais lui donner un coup de main, il m’a dit : “ Ce qui me
plairait, c’est si tu pouvais regarder mon spectacle, et me donner ton avis. ” Et allez, je suis venu chez
lui, il m’a joué ses élucubrations dans son salon, et tout en le regardant, je me disais : “ Quel acteur,
putain ! Quel comédien, ce mec ! ” Et puis, comme promis, je lui ai donné mon avis. Plus tard, on est
allé le voir jouer. Et puis… Et puis.
Je ne comprends toujours pas ce pressentiment incroyable qui m’a pris, comme ça, et qui m’a fait
aller le retrouver, juste avant qu’il meure.
Serge, il faut d’abord que je raconte la première fois que je l’ai vu. C’était en 69. J’avais 19 ans, je
venais de quitter mes parents. J‘étais seul, libre, et du coup, complètement fou. Je marchais pieds nus
dans les rues, maquillé, efféminé ; ravi. J’avais un copain qui s’appellait Jean-Claude Bourbault, et qui,
en attendant d’obtenir les rôles que lui promettait Antoine Bourseiller, servait de gardien au Théâtre du
Gymnase, dit “ Centre Dramatique du Sud-Est ”, à Marseille. J’allais le rejoindre dans sa loge de
concierge où on déconnait, où on se rendait malades de rire, et où, toute la nuit, pendant qu’on allait se
saôuler dans les bars, il laissait enfermées des filles qu’il avait sautées l’après-midi et qu’il se gardait
pour le lendemain. Il y avait à cette époque un jeune metteur-en-scène de génie qui s’appellait Patrice
Chéreau, et que Bourseiller avait acueilli dans son théâtre pour y créer Richard II. J’avais vu le
spectacle et je ne l’ai jamais oublié. Ce fut l’un des plus beaux de ces années-là ; un des plus beaux que
j’ai vus de ma vie. J’en étais bouleversé. Et un soir, — est-ce que c’était la fin du spectacle ou avant, je
ne sais plus —, alors que j’errais aux abords du théâtre, dans l’espoir peut-être d’y rencontrer le génie,

Page 2 sur 3- Philippe Caubère – Achives – Hommage à Serge Coursan - 1999
j’en vis sortir deux personnages extraordinaires. Un petit cow-boy trapu, costaud, carré, aux cheveux
déjà gris, qui portait aux pieds des bottes de motard avec des boucles en fer, comme celles que j’ai
mises pour lui aujourd’hui, un blouson de cuir, de motard aussi, accompagné d’une créature superbe,
grande, plus que sexy — le mot ne suffit pas —, sexuelle, vêtue comme un arbre de noël, et en même
temps au regard complètement ingénu. Elle me faisait penser à la fois à Arletty et aux putes qui tenaient
boutique dans la rue derrière le Gymnase, dont elle avait le costume, l’allure, le charme et l’arrogance.
Ils ont traversé la rue et ils sont entrés dans le bar en face du théâtre. Et moi, je me suis dit :
— “ C’est ça, les comédiens ! ”
C’était Serge et Betty.
Deux ans plus tard, mêlé à la foule qui, par tous les moyens possibles et imaginables, traversait le
Bois de Vincennes et se perdait dans ses taillis pour tenter d’y trouver le chemin de cette mystérieuse
Cartoucherie, je finis par aboutir dans l’endroit déjà mythologique, où, par je ne sais quelles ruses ou
quelles dragueries, je parvins à obtenir de la charmante personne, brune, fatale, sombre, superbe,
tragique — Odile pour ne pas la nommer —, un ticket d’entrée. Je ne savais pas, même si je crois qu’au
fond je m’en doutais, que je venais par là de sceller le cours de mon destin, et celui de ma vie. Le
spectacle commença, il n’est pas besoin de le raconter ici. Mais comme je n’ai pas reconnu Serge tout
de suite, je veux dire dans le lion des Animaux malades de la peste, la première scène du spectacle,
j’eus la surprise quelques instants plus tard, de revoir soudain le petit homme de Marseille, assis au
bord d’un des plateaux, la lumière montant doucement sur lui, tapant avec beaucoup de précaution sur
une clé. C’était lui. Et le bonheur que je sentais monter en moi depuis le début de la soirée, cette
impression qu’enfin je venais de découvrir, ou plutôt de retrouver, le théâtre du Capitaine Fracasse, des
légendes, des contes et des rêves de mon enfance, s’affirma et se confirma tout à fait quand je le vis se
dresser et hurler : “ Je suis le Roi ! ”. Au pays du théâtre, c’était là, sans nul doute, le roi des
comédiens.
Plus tard — comme je me suis employé ces dernières années à ce que toute la France le sache —
nous eûmes la chance et l’honneur, mes copains et moi, de devenir citoyens de ce pays. Et Serge, en
souverain de pacotille, nous y accueillit. Bien sûr, la Reine, ce n’était pas lui. Mais tout de même, en
secret, par-dessous, il nous abreuvait de ses conseils, de ses idées, de ses considérations réactionnaires
et phallocratiques qui nous affolaient, mais surtout nous réjouissaient et nous rassuraient. Si un
personnage comme celui-là pouvait aussi librement et triomphalement exister à l’intérieur d’une telle
troupe, c’est que nous étions en bonne compagnie. Le Théâtre du Soleil, implacablement gauchiste et
militant, dont nous nous voulions nous-même l’avant-garde sectaire et révolutionnaire, contenait un
royaliste fervent, admirateur, non pas de Bonaparte — il était trop révolutionnaire — mais de
Napoléon. De l’Empereur. Un grognard. Un chouan. Un fanatique. Et lorsque nous revenions de nos
expéditions terroristes dirigées contre les prisons, ou les juges de l’État fasciste, il n’avait qu’une
phrase, hurlée en cachette, vers les chiottes, ou caché au fond de l’atelier : “ Moi, les p’tits gars, vous
faites ce que vous voulez, je n’dirai qu’une chose : “ Vive l’Empereur ! ” ”. Et nous le faisions taire,
quoique morts de rire à l’idée que la direction politique ou morale puisse nous entendre nous complaire
à de telles insanités. Pour lui, c’était pas compliqué : Ariane, c’était Jeanne d’Arc. Et il n’avait pas tort.
Quant à Betty, n’importe quel étranger, spectateur ou visiteur égaré dans la cuisine, pouvait apprendre
de sa propre bouche que son petit homme, le matin même, venait de la déguiser en petite fille, de lui
faire des couettes, de lui faire porter une mini-jupe et des socquettes blanches, et de la faire courir
autour de la table, avant de l’honorer. Combien nos femmes, nos amantes et nos maîtresses devraient
remercier Coursan des idées qu’il nous a données ! En cette matière aussi, il fut imbattable, et je tiens à
l’en saluer. Nous ne sommes tous ici que ses piètres disciples.
Enfin, et c’est par là que je finirai, je veux nommer le rôle dans lequel sans doute il fut le meilleur.

Page 3 sur 3- Philippe Caubère – Achives – Hommage à Serge Coursan - 1999
Immortel, comme on dit. Oh ! ce ne fut pas lors de cette émission scolaire où nous eûmes l’infinie
tristesse de voir Gérard Hardy déguisé en biscuit Lustucru, et nous-même en galettes, et où Coursan,
qui ne se rappellait jamais de son texte, devant dire à Max : “ Et, ceci est un oligopole, mon cher
ami ! ” lança, à la quatorzième prise, devant le réalisateur et l’équipe complètement attérés, à la face de
Max défigurée par le fou-rire : “ Héééé, ceci… est un Ouligouli, mon jeune amant ! ” Non. Ce fut dans
un révolutionnaire — quel extraordinaire paradoxe —, que son talent s’exprima de la plus grande et la
plus belle manière : le sectionnaire Jean Choux, “ mort sur le front du Rhin ! ”, comme il le hurlait à la
fin de1793, les yeux écarquillés et les doigts sur la couture de la culotte, pensant dans sa tête à je ne
sais quelle bataille napoléonienne, Austerlitz ou Waterloo, à laquelle il associait, sans que personne ne
le sache, le malheureux sans-culotte. Qui n’a pas vu la bataille de Valmy, racontée et jouée par les deux
grands acteurs du Théâtre du Soleil Gérard Hardy et Serge Coursan n’a rien vu du théâtre de ces années
de fête et de vitalité !
Jean-Claude Bourbault, toujours le même, me demandait il y a quelques jours : “ Mais comment il
est mort, Serge ? ”. “ Écoute… ”, lui ai-je dit, “ je crois qu’il est allé tourner dans la neige, par moins
dix, en petite culotte, à soixante-dix ans ; ils l’ont fait grimper et descendre d’une carriole toute la
journée ; et le soir, il s’est senti mal ! ” Et comme je lui rappellais ce cri de Serge à la fin de 93, il m’a
fait remarquer : “ Et ben, en fait, il est vraiment mort au champ d’honneur ! ” C’est vrai. Sans vouloir
faire de sentimentalisme facile, on peut le dire : il est mort de jouer. Pour gagner son cachet ; et pour le
plaisir de “travailler”, comme on dit dans le métier. Comme Matamore dans la neige. Comme Molière
dans le film.
Alors, pour l’honorer, je répèterai son cri : “ Jean Choux, mort au champ d’honneur ! ”
Salut, Serge. Salut, l’artiste !
1
/
3
100%