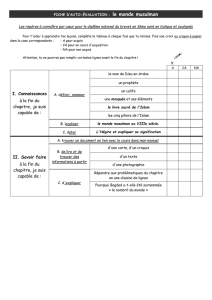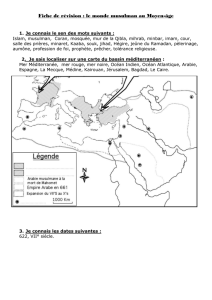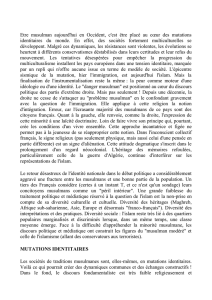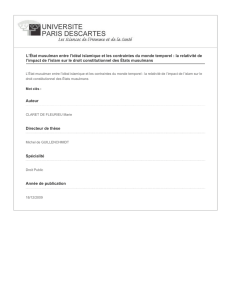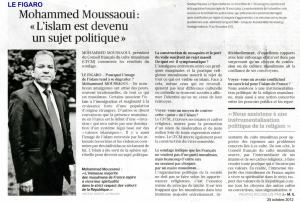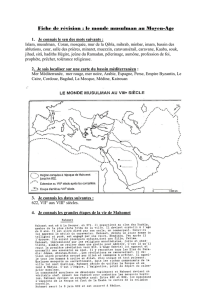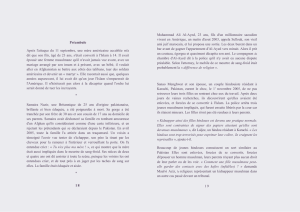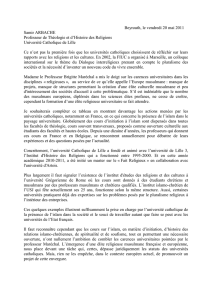Articles de Sophie Brouillet

Articles de Sophie Brouillet
publiés en 2003 dans
La Presse
1. Les mariages islamo-chrétiens
:
une aventure périlleuse
«Anne-Josée et Mohammed.» À l’entrée d’un immeuble perdu du quartier Villeray, par une
glaciale et noire soirée d’hiver, l’étiquette sous le bouton de sonnette semble conviviale.
L’appartement, lui, est franchement chaleureux, avec sa peinture de Chagall, ses meubles
marocains et sa cage à oiseaux tunisienne. Anne-Josée Grégoire et Mohammed Mhirit sont
jeunes et ils s’aiment. Le reste, c’est-à-dire les éléments contrastés de leurs deux visions du
monde, gravite autour d’eux sans les affecter. Ils en parlent avec un certain détachement, autour
d’un savoureux thé marocain.
«Avant de commencer à la fréquenter il y a deux ans, c’était évident pour moi que ma femme serait
musulmane», confesse toutefois Mohammed, un Marocain d’origine qui adhère résolument à l’islam et le
pratique. Sa rencontre avec Anne-Josée, une fille du Québec moderne peu portée sur la religion, a renversé
les perspectives, et leur complicité naturelle a relégué les différences au second plan. Elles refusent,
toutefois, de s’effacer.
Élevé dans un pays «à 100% musulman» où «tout le monde est croyant», Mohammed a grandi
imprégné de l’islam, dont il parle aujourd’hui avec ferveur. Sa compagne, bien qu’héritière d’une
civilisation judéo-chrétienne, n’a été ni baptisée ni élevée dans la foi, et conçoit les religions comme des
inventions humaines.
Pour le jeune couple, cette divergence pose avec une certaine insistance la question du mariage.
«Comme je ne crois pas en Dieu, ça n’a pas de sens pour moi », explique avec confiance Mme Grégoire, de
sa voix douce et engageante. Les yeux rieurs, son ami enchaîne avec son propre point de vue,
diamétralement opposé. «C’est une obligation pour moi, écrite noir sur blanc dans le Coran, mon livre
sacré, et sur laquelle on est jugé dans ma culture», dit-il. Pour Anne-Josée Grégoire, un mariage religieux
avec Mohammed Mhirit risquerait bien de ressembler à une conversion à l’islam. La religion musulmane
permet l’union d’un musulman à une «femme du Livre» (juive ou chrétienne) et accepte que cette dernière
garde sa propre foi. Mais la jeune Québécoise n’a jamais reçu le baptême, peu significatif pour elle.
En plus de la priver d’une éventuelle légitimité conjugale comme «non-musulmane», son agnosticisme
lui ferme les portes d’un mariage interreligieux du côté catholique. L’Église, qui joue les équilibristes face
aux unions islamo-chrétiennes, ne les cautionne en effet qu’à certaines conditions, dont l’engagement de la
partie catholique à donner une éducation chrétienne aux enfants dans la mesure du possible. Ainsi,
dépourvu de toute référence religieuse autre que l’islam, ponctué par la profession de foi musulmane (la
Fâtiha) et impliquant en principe une conversion, un mariage célébré selon les rites de l’islam ferait
d’Anne-Josée une musulmane dans les formes.
Du point de vue du droit musulman, il serait d’ailleurs préférable pour elle de le devenir. Les
législations en vigueur dans les pays musulmans désavantagent en effet les épouses d’autres religions,
faisant revenir la tutelle sur les enfants au père musulman en cas de divorce et à la communauté familiale
des femmes musulmanes en cas de mort du père. Il est également impossible à une épouse non musulmane
d’hériter d’un musulman, et vice-versa.
«Dans les faits, une femme est presque obligée de se marier avec l’intention de se convertir», déclare
Mohammed Mhirit avec franchise. Sensible à la situation de non croyante de son amie, et résolu à demeurer
au Québec où la législation musulmane reste commodément confinée à l’abstraction, il se montre ouvert à
la solution éventuelle du mariage civil.
Quant aux enfants, une perspective encore lointaine pour le jeune couple, ils naîtraient musulmans,
selon l’islam. La religion est en effet transmise par le père, et du simple fait de la filiation, dans la tradition
musulmane. Cette vision explique d’ailleurs l’interdiction absolue faite à une femme musulmane d’épouser
un homme d’une autre confession, qui lui engendrerait une descendance non musulmane.
Sans évoquer ces conceptions tranchées, et tout en se disant ouvert à d’autres avenues, Mohammed
Mhirit indique qu’il aimerait voir ses enfants élevés dans l’islam. L’idée semble d’ailleurs positive à Anne-
Josée Grégoire. «L’islam, c’est quelque chose de bon», affirme la jeune employée de l’Institut interculturel
de Montréal, fascinée par les autres cultures.

Aucun élément menaçant, à ses yeux, dans cette intégration d’une confession étrangère à sa vie intime.
Mohammed fait le ramadan sans elle, et elle boit de l’alcool sans lui. «Chacun vit pleinement son identité,
mais on le fait ensemble», énonce-t-elle avec conviction.
Respectueux l’un de l’autre, forts de l’optimisme de l’amour, ils se sentent à mille lieues du fossé qui
sépare leurs deux civilisations.
~~~~~~
2. Un étroit chemin commun
Quant un couple islamo-chrétien souhaite un mariage interreligieux, l’archevêché de Montréal entend
parler de son cas deux fois plutôt qu’une.
D’abord, les amoureux s’y présentent pour obtenir de leur évêque une dispense spéciale, comme le veut
le droit canonique. Si la permission est accordée, il n’est pas rare qu’une autre visite suive: celle du prêtre
chargé de célébrer le mariage, un peu embêté et en quête de points de repères.
Les demandes répétées des prêtres des paroisses ont ainsi amené le cardinal Turcotte à mandater une
équipe pour élaborer un Guide pastoral des mariages islamo-chrétiens, terminé en 2001. Loin des solutions
clé en main, cet ouvrage pose des balises et ouvre des pistes sur un terrain encore peu défriché, escarpé en
plusieurs endroits.
Outre le souhait des curés, une inquiétude l’a fait naître, écrivent ses auteurs. Engagés dans le dialogue
interreligieux, ils disent s’être aperçus d’un malentendu fréquent sur le sens des mariages islamo-chrétiens.
«Nous sommes devenus conscients du contraste entre la communauté chrétienne et la communauté
musulmane dans leur manière d'aborder ces mariages : l’acceptation par l’Église de célébrer des mariages
interreligieux tout en respectant entièrement la religion de la partie musulmane et la tendance apparente de
la partie musulmane à convertir la partie chrétienne. Cela nous a grandement préoccupés. »
En moyenne, une douzaine de mariages religieux islamo-chrétiens sont célébrés chaque année dans le
diocèse de Montréal, la plupart des couples optant pour l’union libre ou le mariage civil. À ceux qui
choisissent de vivre à plein l’aventure interconfessionnelle, le Guide adresse des recommandations basées
sur les expériences vécues dans différents pays, en particulier la France.
Il pose d’abord les conditions nécessaires pour créer un terrain commun et rendre le mariage valide
d’un point de vue catholique. Le musulman doit ainsi renoncer aux possibilités que lui donne l’islam de
pratiquer la polygamie et de répudier son épouse. «La monogamie et l’indissolubilité ne sont pas
nécessaires dans l’islam, mais elles n’y sont pas contraires», souligne le père blanc Yves Gaudreault, co-
auteur du guide.
Quant à la partie catholique, elle doit s’engager à tenter d’éduquer les enfants du couple dans la foi
chrétienne, une exigence très délicate puisque, selon l’islam, l’enfant d’un père musulman naît musulman.
Devant cette conception catégorique de la filiation religieuse, le Guide se fait diplomate. «Si grave que soit
l’obligation (de la partie catholique), qui subsiste toujours, on peut admettre que l’exécution de la promesse
ne soit pas toujours possible», concède-t-il.
On recommande ensuite de faire reculer le fossé juridique qui sépare civilisations musulmane et
chrétienne au moyen d’un contrat de mariage, signé devant notaire et deux témoins. Le renoncement à la
polygamie peut y être spécifié, comme on le fait maintenant fréquemment dans les pays musulmans. Il est
aussi conseillé d’y préciser les droits de garde d’éventuels enfants et de succession, pour se soustraire à la
législation musulmane qui désavantage sur ces points les non-musulmans. Quant à la célébration du
mariage, le Guide la situe de préférence dans une église, où on fait place à certains rites chrétiens et
musulmans mais où on en exclut d’autres. Ainsi, il n’y a pas de communion, question de respecter la
sensibilité de la partie musulmane. Cette dernière doit de son côté renoncer à la récitation de la Fâtiha (le
credo musulman), une pratique habituelle lors des mariages musulmans et qui peut prendre le sens d’une
conversion à l’islam.
Lorsqu’une célébration à l’église répugne à la partie musulmane ou qu’il est plus prudent pour elle de
garder secret le caractère interreligieux de l’union, l’Église accorde une «dispense de la forme canonique
du mariage». Ce dernier peut alors prendre une forme purement civile tout en étant reconnu d’un point de

vue catholique. On peut notamment choisir cette formule lorsqu’une femme musulmane veut épouser un
homme chrétien, chose que permet le christianisme mais que proscrit l’islam.
La foi des enfants
Une fois accompli ce petit tour de force de l’amour qu’est la célébration interreligieuse, les mariés se
retrouvent l’un en face de l’autre. «Ils ont, dans une certaine mesure, à inventer un style de vie qui leur soit
propre», écrivent les auteurs du Guide. Il devient alors tentant d’aplanir les différences à la source des
difficultés, une solution facile mais aussi, souligne-t-on, risquée.
Fouad (nom fictif), un musulman de Québec marié depuis quelques années à une catholique
pratiquante, en témoigne. «Mon mariage et le fait d’avoir quitté mon pays m’ont plutôt rapproché
qu’éloigné de ma religion, raconte-t-il. Ça nous rattrape, on cherche à se protéger.»
Le couple repousse depuis la naissance de ses enfants la question de leur baptême et tend à la fuir, ne
trouvant pas de solution. Le mari énonce toutefois sa conviction sur le chemin à suivre. «On va sûrement
trouver un terrain d’entente. Il faut que chacun puisse demeurer ce qu’il est, ça ne fonctionne pas si on
essaie de se changer.»
En ce sens, le Guide pastoral des mariages islamo-chrétiens déconseille de renoncer à la formation
religieuse des enfants pour éviter les tensions, ce qui pourrait être selon lui «une fuite des deux conjoints
devant la réalité de leur couple». Il suggère plutôt une éducation dans l’une des deux religions, alliée à une
approche réelle de l’autre. À l’enfant de choisir plus tard en toute connaissance de cause.
Confrontés à des défis foisonnants, les couples sont enfin encouragés à rencontrer des pairs. Des
groupes de foyers islamo-chrétiens existent d’ailleurs déjà dans certains pays, dont la France. Leur
exemple, qui tranche avec des expériences d’échec, constitue selon les auteurs du guide «un signe de
réconciliation possible entre les peuples, les races, les religions».
~~~~~~
3. D’irréductibles distances
Des couples islamo-chrétiens ont beau édifier un amour solide, les fondations de ce dernier restent
toujours bancales par endroits, à entendre certains observateurs.
D’abord, il y a souvent à la base de ces unions des malentendus culturels importants. À commencer par
les conversions à l’islam destinées à faciliter les choses. Des hommes d’origine chrétienne s’y adonnent
pour éviter à leur future épouse la transgression d’un interdit, et des femmes chrétiennes pour ne pas être
désavantagées par le droit musulman. Pure formalité pour bien des esprits occidentaux, ce geste prend un
sens profondément religieux dans la mentalité musulmane. En outre, il est irréversible.
«Dans les pays musulmans de stricte observance, les légistes musulmans classiques prévoient la peine
de mort pour celui qui quitte leur religion, appelé apostat», rapporte le Guide pastoral des mariages islamo-
chrétiens. S’il s’agit d’une femme, certains pays prévoient la prison à vie jusqu’à ce qu’elle meure ou
revienne à l’islam.»
Quant aux cas de mariages interreligieux en bonne et due forme, ils ne sont pas également perçus et
reconnus par les autorités religieuses des deux côtés. Ainsi, l’imam montréalais Said Fawaz ne reconnaît
pas les unions entre une musulmane et un chrétien, et n’adapte pas ceux qu’il célèbre entre une chrétienne
et un musulman. «C’est une cérémonie très simple, la même que d’habitude», explique-t-il.
À de tels malentendus s’ajoutent des divergences irréductibles dans les faits, principalement au chapitre
de l’éducation des enfants et du droit civil.
«Assez souvent, un mariage islamo-chrétien suppose que l’un des deux a pris des distances assez
considérables face à sa propre foi, parce que quelque part, on est devant une impossibilité», affirme le
spécialiste de l’islam Jean-René Milot, en faisant pour sa part référence aux enfants, que chaque parent a la
responsabilité d’éduquer dans sa foi.
Des incompatibilités bien théoriques pour qui demeure au Québec, où lois et mentalités enlèvent de
l’emprise aux religions? Encore faut-il ne pas en sortir. Or, plusieurs couples séjournent à un moment ou à
un autre dans le pays d’origine du conjoint musulman, et certains choisissent d’y rester. Mais surtout,
même sans voyager, il n’est pas rare que les unions interreligieuses et le déracinement qu’elles accentuent
nourrissent la ferveur musulmane. Jean-René Milot raconte avoir rencontré ainsi des «born again muslims»,
tièdes au moment de leur mariage, enflammés quelque temps plus tard.

Enfin, en cas de rupture, la distance entre les deux traditions légales peut se concrétiser
dramatiquement. Le député bloquiste Bernard Bigras en sait quelque chose, lui qui tente de rapatrier
l’enfant de sa conjointe actuelle, enlevé en 1993 et amené en Égypte par un père musulman. «Ma conjointe
a une ordonnance de garde qui n’est pas respectée du côté musulman, d’autant moins qu’elle n’était pas
mariée, explique-t-il. Son fils a été baptisé, mais là-bas il est considéré comme musulman. On est devant un
fossé moral et religieux, il ne reste plus de lieu de médiation.»
De telles histoires sont une douche froide sur l’optimisme d’artisans du rapprochement
interconfessionnel, comme le père Robert Gendron de l’Institut interculturel de Montréal. «Les religions
monothéistes, le judaisme y compris, sont pas mal "tough" ("éprouvants") pour les mariages interreligieux,
soupire-t-il. Il faudrait au moins que les couples, qui ne pensent pas au conflit des civilisations, sachent
dans quelle réalité ils s’engagent. »
~~~~~~
4. Les noces d’argent d’un couple mixte
(adapté de la revue française Accueil-Rencontre)
Youssef et Nicole se sont mariés en France il y 24 ans. Tous deux sont demeurés ce qu’ils étaient alors,
lui musulman pratiquant, elle catholique pratiquante. Initiées à leurs croyances respectives, leurs 2 filles ont
choisi l’islam. Nicole El Mhadhbi raconte le chemin spirituel particulier de sa famille dans un article récent
de la revue Accueil Rencontre, publiée par la Fédération des centres de préparation au mariage de France.
«Nous nous sommes mariés conscients des difficultés, mais en faisant le formidable pari de réussir à
tout prix», relate-t-elle d’abord. Chacun bien ancré dans sa foi, elle et son mari ont refusé d’éluder leur
double appartenance religieuse. Les filles ont accompagné leur mère à l’église et leur père à la mosquée,
tandis que la famille célébrait les fêtes des deux religions. Le couple a toutefois uni ses prières en certaines
occasions comme des mariages ou des enterrements, et a mis de l’avant dans son foyer les valeurs
«humanistes» communes à l’islam et au catholicisme.
Une route suivie avec détermination, mais ponctuée par certains doutes. «Soumis tout au long de ces
années aux aléas de la géopolitique et aux remous de la société, nous nous sommes parfois demandé si nous
étions aussi forts que nous le pensions au départ pour vivre un mariage biculturel, pour harmoniser nos
deux religions», confie Nicole.
Ils ont tenu bon, profitant du soutien de leurs deux familles, très respectueuses de leur choix de vie.
«Des 2 côtés, ces personnes croyantes et tolérantes n’ont jamais suggéré à l’autre de se convertir», assure-t-
elle.
En matière d’allégeance religieuse, les parents ont choisi de donner à leurs filles aujourd’hui âgées de
21 et 18 ans «le choix» et «les outils nécessaires» pour le faire. Elles ont participé aux activités
d’aumônerie de leur mère, à celles d’un groupe de foyers islamo-chrétiens, à celles des scouts musulmans
de France et aux causeries de formation instaurées par leur père. Nicole raconte aussi s’être aperçue en
discutant avec elles que son caractère et celui de son mari avaient à eux seuls transmis quelque chose de
différent.
«Elles ont surtout retenu de moi mon «activisme», un engagement plus social, plus organisationnel,
dirons-nous. Leur père leur a donné sa présence spirituelle à la maison, ses cinq prières par jour, son aura.»
Les filles disent n’avoir jamais senti de pression religieuse d’un parent ou de l’autre, rapporte leur mère.
S’il y a eu pression, elle est plutôt venue de leurs camarades, qui les ont étonnées par leurs questions. Elles
se sont fait demander par des amis chrétiens si leur mère n’avait pas eu peur d’épouser un musulman, et par
de jeunes musulmans comment il se faisait que leur père n’avait pas converti leur mère. Ces derniers
offraient l’image d’une adhésion beaucoup plus affirmative, note Nicole. «Contrairement à leurs amis
d’origine française et chrétienne, les jeunes musulmans que mes filles connaissent sont restés croyants et
enracinés dans leur foi», écrit-elle.
Arrivées à l’âge des décisions, les filles ont toutes deux résolu de devenir musulmanes. Aux yeux de
leur mère, une expérience déterminante de leur choix aura été la «vie communautaire religieuse» permise
par le scoutisme musulman. Elle mentionne aussi qu’il leur était bien moins ardu d’opter pour l’islam que

pour le catholicisme. «Il leur a suffi de dire «je suis musulmane». Pour elles, demander le baptême aurait
été un parcours difficile, semé d’embûches.»
Sans que leur père le leur ait demandé, les filles ont commencé il y a deux ans à faire le
ramadan. Mais dans le temps de Noël, elles aident aussi leur mère à préparer la crèche.
1
/
5
100%