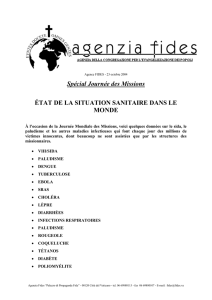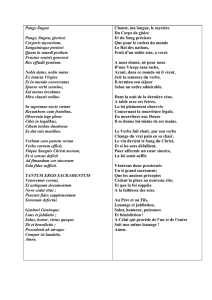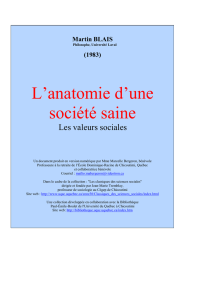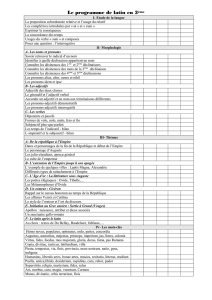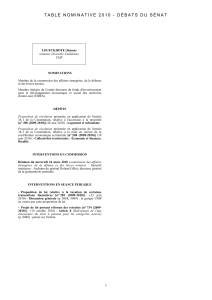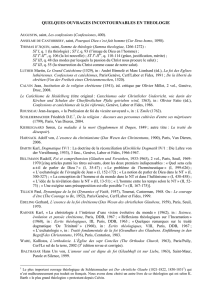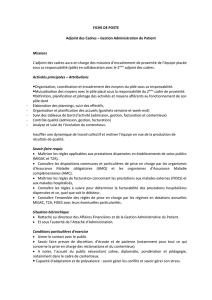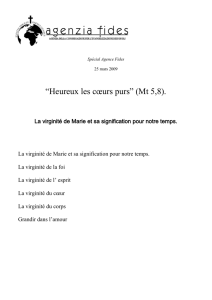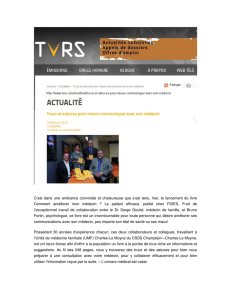AFRIQUE - Agenzia Fides

Agenzia Fides “Palazzo di Propaganda Fide” - 00120 Città del Vaticano - tel. 06 69880115 - fax 06 69880107 - E-mail: [email protected]
Agence FIDES - 23 octobre 2004
Spécial Journée des Missions
AFRIQUE : POURQUOI LES RICHES SONT-ILS
PAUVRES ?
LES TRÉSORS DE L’AFRIQUE
GAZ ET PÉTROLE EXPORTÉS DANS LE MONDE ENTIER
LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
UN IMMENSE POTENTIEL AGRICOLE
LE TOURISME
LE PRODUIT INTÉRIEUR BRUT PROGRESSE, MAIS PAS SUFFISAMMENT
LES CHIFFRES DE LA PAUVRETÉ
DES CONDITIONS DE VIE À LA LIMITE DE LA SURVIE
LANTERNE ROUGE DE LA PLANÈTE
L’URGENCE SANITAIRE
LE DRAME DE LA FAIM
POURQUOI LES RICHES SONT-ILS SI PAUVRES ?
LE CERCLE VICIEUX DU SOUS-DÉVELOPPEMENT
LE PROBLÈME DE LA DETTE EXTÉRIEURE
L’INTERNATIONAL FINANCE FACILITY
RÉSOUDRE LES CONFLITS OUBLIÉS
CONFRONTATION ENTRE DEUX CAS :
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO ET L’AFRIQUE DU SUD
______________________________________________________________________________________

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE –
FIDESDIENST
2
DOSSIER FIDES
AFRIQUE : POURQUOI LES RICHES SONT-ILS PAUVRES ?
LES TRÉSORS DE L’AFRIQUE
Un immense trésor, fait non seulement de matières premières, mais aussi d’énergies
renouvelables, eau, ressources agricoles, tourisme, main d’œuvre, grands marchés pour les
investissements étrangers. C’est de l’Afrique que nous parlons : pas seulement du populeux
Maghreb, mais de tout le continent, y compris l’Afrique subsahariennes. Pour une fois,
essayons d’invertir la perspective : au lieu de partir de la description des maux qui affligent
l’Afrique, nous allons en énumérer les richesses. Nous découvrirons que cette liste est
étonnamment longue.
Fournisseur traditionnel de minerais sur le marché mondial, l’Afrique subsaharienne
figure, à elle seule, au premier ou au deuxième rang mondial pour une longue série de
matières premières : antimoine, bauxite, chromite, cobalt, diamants, or, manganèse, platine,
titane et vanadium, dont elle détient de 23% à 89% des réserves mondiales. Si les grandes
réserves minières sont situées en Afrique du Sud, il faut cependant y ajouter aussi la Guinée,
riche en bauxite, la République Démocratique du Congo et la Zambie pour le cobalt, le Niger
pour l’uranium, l’Angola, le Botswana, la Namibie et encore la République Démocratique du
Congo pour les diamants.
gaz et pétrole exportés dans le monde entier
Le continent africain recèle en outre dans son sous-sol de 6 à 8% des réserves
mondiales de charbon, gaz naturel et cuivre, et près de 20% des réserves utilisables
d’uranium. L’Algérie, à elle seule, est le cinquième producteur et le quatrième exportateur
mondial de gaz naturel. Mais d’autres pays d’Afrique sont également très actifs dans
l’extraction et l’exportation du gaz naturel. Sur 133,2 milliards de mètres cubes de gaz
produits au cours de l’année 2002 en Afrique, 80,4 provenaient d’Algérie, 22,7 d’Égypte, 17,7
du Nigeria, 5,7 de Libye et 6,7 d’autres pays. Le nouveau gazoduc d’Afrique de l’Ouest,
d’une longueur de 617 km, entre Lagos au Nigeria et Takoradi au Ghana, donnera un nouvel
élan à l’exploitation des gisements de gaz naturel en Afrique subsaharienne.
Quant au pétrole, 11% de la production mondiale provient d’Afrique. D’ici 2015, les
États-Unis comptent importer du golf de Guinée 25% de leur pétrole brut, contre 14%
actuellement. Le golf de Guinée produit actuellement 3,5 millions de barils par jour, mais il
pourrait augmenter sa production jusqu’à 6 millions de barils par jour d’ici la fin de la
décennie. D’après les prévisions, d’ici 2010, dans cette seule région, les réserves de pétrole
s’élèveront à 80 milliards de barils.
Les énergies renouvelables
Le continent africain est très riche aussi en sources d’énergies renouvelables. À
commencer par l’eau. Un tiers des grands bassins fluviaux du monde se trouvent en Afrique :
le bassin du Nil, qui traverse dix pays, celui du Volta, qui en traverse 6, le Niger, partagé entre
11 pays, le lac Tchad (8 pays), le fleuve Congo (9 pays) et le Zambèze (9 pays). Il faut y
ajouter de nombreuses cascades et de cours d’eau mineurs. Ces chiffres suffisent pour
comprendre que ce continent a un potentiel hydroélectrique considérable, en grande partie
inexploité. Seuls 8% de cette extraordinaire source d’énergie renouvelable qu’est l’eau sont en
effet utilisés pour produire de l’énergie électrique. En partie parce que manquent les ouvrages

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE –
FIDESDIENST
3
nécessaires : sur les 25.400 barrages construits dans le monde, l’Afrique n’en compte que
1272.
Un immense potentiel agricole
Cet « or bleu » est très précieux aussi pour l’agriculture, autre richesse de l’Afrique.
Une meilleure exploitation de l’immense bassin du Niger pour l’irrigation multiplierait les
surfaces cultivables dans la région du Sahel, ce qui ferait progresser considérablement la
production. Pour le seul Mali, on a calculé que la production de riz pourrait passer de 750
mille tonnes par an à plus de 4 millions de tonnes en améliorant les ouvrages d’irrigation,
puisque seuls 10% des 2,2 millions d’hectares de terres agricoles sont actuellement exploités.
Au Sénégal, on estime qu’il existe 400.000 hectares potentiellement irrigables. Grâce aux
pluies abondantes et bien réparties au cours de l’année, le Sahel a enregistré des récoltes sans
précédent pour la saison 2003-2004 : 14,3 millions de céréales, soit 31% de plus que la
moyenne des cinq dernières années. Mais l’envers de la médaille de ce résultat a été un
effondrement des prix des récoltes qui a mis en difficulté les cultivateurs. En Algérie, au
Maroc et en Tunisie également, des récoltes sans précédent ont été enregistrées en 2003. Au
Maroc, par exemple, la production de céréales s’est élevée à 81 millions de quintaux, soit
80% de plus que la moyenne des cinq dernières années.
Le tourisme
Le tourisme, si possible dans le respect des cultures et des traditions locales et de
l’environnement, est une autre grande ressource de l’Afrique qui mériterait d’être exploitée de
manière plus planifiée et clairvoyante, car elle permet d’attirer de grandes quantités de
capitaux de l’étranger. Mais le tourisme a besoin de sécurité et de stabilité politique dans les
pays intéressés et il devrait être géré autant que possible au niveau local.
Le produit intérieur brut progresse, mais pas suffisamment
Au plan macroéconomique, l’année 2004 présente de bonnes perspectives de
croissance dans la région du Maghreb, à la suite des politiques fiscales appliquées en Algérie,
des réformes économiques en cours au Maroc et en Tunisie, et des résultats prometteurs de la
production agricole. On attend aussi à une croissance significative en Afrique occidentale et
centrale, et en particulier au Nigeria, grâce à l’augmentation de la production de pétrole brut,
qui est toutefois menacée par une insécurité croissante dans le Delta du Niger. En Afrique
australe, le Botswana affichera probablement le meilleur taux de croissance grâce à
l’augmentation de sa production minière. Dans ce pays, le revenu moyen par habitant est de
3.000 dollars, plus que ceux de l’Inde et du Maroc. La croissance devrait en revanche ralentir
dans la Corne d’Afrique, où la Somalie et l’Éthiopie connaissent une situation critique, à la
limite de la crise alimentaire. L’économie du Cameroun et celle de la Côte d’Ivoire sont
stationnaires après la division du pays consécutive au coup d’État manqué de 2002, qui a eu
des effets négatifs sur le développement.
Selon les estimations du Fonds monétaire international, le produit intérieur brut (PIB)
de l’Afrique augmentera de 4,8% durant l’année 2004 (contre 3,7% en 2003). Le meilleur
résultat est attendu en Angola, avec une croissance du PIB de 11,4%. Bénin, Burkina Faso,
Mali, Mozambique, Sénégal, Île Maurice, Rwanda, Seychelles, Tanzanie et Ouganda
devraient confirmer l’évolution positive de leur croissance économique de ces dernières
années. On prévoit une croissance du PIB de 6% en Ouganda et en République Démocratique

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE –
FIDESDIENST
4
du Congo, de 6,3% en Tanzanie, de 4,4% au Cameroun, de 5% au Ghana, de 3% en Côte
d’Ivoire.
Au Maghreb aussi, le PIB devrait afficher une progression, quoique plus faible qu’en
2003, avec une croissance moyenne pour toute la région de 4,8% pour l’année 2004, contre
5,7% l’année précédente. Le résultat le meilleur est attendu en Tunisie, avec une croissance
du PIB de 5,8%, suivie par l’Algérie (3,8%) et le Maroc (3,4%). Malgré l’urgence
alimentaire, des signaux positifs se manifestent aussi en Éthiopie (6,7%). Les problèmes
politiques ne devraient pas empêcher le Soudan d’enregistrer une croissance de 6,5% de son
PIB, malgré la crise humanitaire au Darfour qui pèse sur la situation économique générale du
pays. Moins importante, mais toujours positive, sera la croissance économique au Kenya
(2,6%), qui souffre d’une baisse du tourisme due à la crainte du terrorisme.
LES CHIFFRES DE LA PAUVRETÉ
Malgré ses nombreuses richesses en matières premières, énergie, terres cultivables et
tourisme, l’Afrique reste marquée par une pauvreté dramatique. Pour faire une comparaison,
la richesse produite par tout le continent africain équivaut à celle produite par les Pays-Bas.
Un continent de 830 millions d’habitants produit autant de richesses qu’un pays de 20
millions de personnes.
Pourtant, la croissance économique africaine se poursuit à un rythme plus élevé que
celle de l’Occident, mais pas suffisant pour permettre à la plupart des pays de ce continent
d’atteindre les taux de développement établis par les « Objectifs du Millénaire » afin de
vaincre la pauvreté d’ici l’an 2015. La croissance économique en Afrique subsaharienne
devrait en effet augmenter de 7% par an de plus que son niveau actuel, en considérant que le
taux de croissance était de 5% durant la dernière décennie.
Des conditions de vie à la limite de la survie
Pour une grande partie de la population africaine, les conditions de vie sont
extrêmement précaires ; près de la moitié de la population subsaharienne vit en effet avec
moins d’un dollar par jour, 450 millions de personnes n’ont pas un accès suffisant à l’eau
potable, 4 enfants sur 10 ne vont pas à l’école. À ce propos, les chiffres cités par l’économiste
Ferruccio Marzano, professeur d’économie du développement à la Faculté d’économie et
commerce de l’Université La Sapienza de Rome sont significatifs : « Alors que le revenu réel
par habitant est de 25.500 dollars dans les pays riches – observe Ferruccio Marzano – à égalité
de pouvoir d’achat il est d’environ 500 dollars en l’Afrique subsaharienne (dont fait aussi
partie l’Afrique du Sud) ». Cela signifie que entre les revenus européens et les revenus
africains, le rapport est de 50 à 1.
« Toujours d’après les données fournies par la Banque Mondiale – dit encore
l’économiste – nous constatons un niveau de pauvreté très élevé dans les pays d’Afrique
subsaharienne : la pauvreté absolue (pourcentage de la population qui vit avec moins d’un
dollar par jour) concerne plus de 46% des habitants, tandis que la pauvreté relative
(pourcentage de la population qui vit avec moins du tiers du revenu moyen par habitant)
concerne plus de 50% d’entre eux ». En réalité, toutes ces personnes et leurs familles
survivent uniquement grâce à l’autoconsommation.
Un autre paramètre important indiqué par Ferruccio Marzano est l’indice du
développement humain, calculé d’après les données fournies par le Programme des Nations
Unies pour le Développement : « Alors que cet indice est de 0,920 pour les pays riches, il est

FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE –
FIDESDIENST
5
de 0,464 dans les pays d’Afrique subsaharienne ». Cela signifie que ces pays ont un rythme de
développement réel plus lent, qui équivaut à la moitié de celui des pays les plus avancés.
Lanterne rouge de la planète
L’Afrique reste à la traîne non seulement par rapport aux pays développés, mais aussi
par rapport aux pays en développement. En effet, alors que les pays en développement dans
leur ensemble voient augmenter le niveau de leurs exportations, celui des pays africains
diminue. Le pourcentage des exportations marchandes mondiales de l’Afrique est descendu
du 2,8% entre 1988 et 1990 à 2,1% dix ans plus tard, dans la période 1998-2000. Une
diminution analogue a été constatée dans les importations, passées de 2,7 à 2,1%. Ce déclin
contraste très nettement avec la croissance générale des exportations des pays en
développement, passées de 22,7% à 28,1% dans le même temps.
En 2000, le revenu réel par habitant en Afrique subsaharienne (en excluant, cette fois,
l’Afrique du Sud) était inférieur d’un tiers à celui de l’Asie du Sud, ce qui fait de cette partie
de l’Afrique la région la plus pauvre de notre planète. En 1990, la production moyenne par
habitant à prix constants y était inférieure à celle enregistrée trente ans plus tôt. Et dans les 15
prochaines années, on prévoit que le nombre de personnes vivant dans la pauvreté la plus
absolue en Afrique subsaharienne passera de 315 à 404 millions. L’aide financière
internationale publique, durant ces mêmes années, est restée stationnaire ou a diminué dans de
nombreux cas. En revanche, les investissements étrangers directs (IED) progressent,
encouragés par les privatisations. En 1999, l’Angola et le Niger ont reçu 56% de l’ensemble
des IED en Afrique pour un montant de 7,1 milliards de dollars. Les flux de capitaux vers les
pays avancés, comme ceux du Mozambique, de l’Ouganda, de la Tanzanie et de l’Éthiopie ont
atteint 1 milliard de dollars en 1999.
L’urgence sanitaire
Du point de vue de l’accès aux ressources primaires, plus de la moitié de la population
africaine ne dispose pas d’une source d’eau potable et les 2/3 des habitants ne disposent pas
d’un réseau d’assainissement adéquat. Du point de vue sanitaire, on enregistre une situation
de grande urgence : l’Afrique compte aujourd’hui 80% des décès dus au sida et 90% des
décès dus au paludisme. Plus de deux millions d’enfants meurent chaque année avant d’avoir
atteint l’âge d’un an. Au milieu des années 1990, les pays africains dépensaient plus de 25
milliards de dollars par an pour le service de la dette contractée auprès des pays riches et 15
milliards de dollars seulement pour les frais de santé. Le coût économique, outre que social,
de l’urgence sanitaire en Afrique est très élevé. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a
estimé que les pertes économiques dues à la diffusion du paludisme sur le continent africain
s’élèvent à 2,2 milliards de dollars par an, alors qu’avec moins de la moitié de cette somme
les décès causés par cette maladie pourraient être réduits de moitié.
Le sida est devenu, en l’espace de vingt ans, la première cause de mortalité en Afrique.
Sur 42 millions de séropositifs dans le monde en 2002, 29,4 millions étaient des Africains, et
sur 3,1 millions morts, 2,4 millions étaient des Africains. Sur 1,3 millions d’enfants malades
du sida dans le monde, près d’un million sont africains. Dans seize pays d’Afrique, plus d’un
adulte sur dix est séropositif. Dans sept de ces pays, au moins un adulte sur cinq vit avec le
VIH. Au Botswana, par exemple, plus de 35% des adultes sont séropositifs. À Abidjan, en
Côte d’Ivoire, le sida est devenu la première cause de mortalité. L’Afrique du Sud compte le
nombre le plus élevé de séropositifs au monde : 5 millions de personnes.
Le drame de la faim
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%