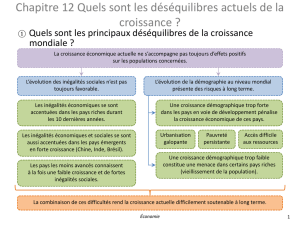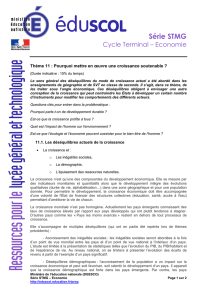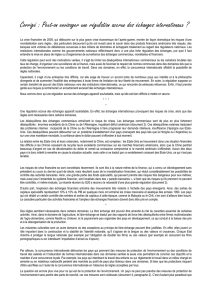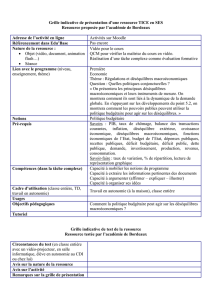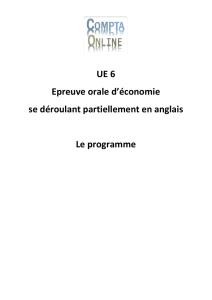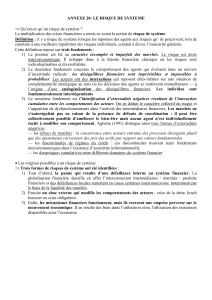Les grangds désordres hydroélectrolytiques du malade chirurgical

Les grangds désordres hydroélectrolytiques
du malade chirurgical
Les désordres hydroéectrolytiques n'ont plus actuellcmcnt en chirurgie la même acuité
qu'antérieurement. Certes, tout malade devant subir une intervention est exposé à ce risque: en
effet, il ne gère plus ses apports et des altérations fonctionnelles ou organiques du tube
digestif et/ou du rein modifiant les pertes. Mais, grâce à une meilleure connaissance et à
une meilleur gestion de cette pathologie,il est possible dans la plupart des cas soil d’évider, soit
de récupérer les désordres graves pré-, per- ou postopératoires.
Déséquilibres hydrosodés
BASES PHYSIOLOGIQUES
L'eau totale d'un sujet nonmopondéral, c'est-j à-dire de teneur en graisse comprise entre 15
et 20 %, représente 60 % du poids corporel. Cette proportion est inferieure quand la masse
graisseuse, non hydratée, est augmentée (obese, fermme, vieillard). Il faut done dans le calcul des
apports hydriques se baser plus sur le poids théorique que Sur le poids réel pour éviter une
surcharge.
Cette eau est répartie en deux secteurs de com-Position différente:
— le liquide intracellulaire (LIC) représente 40 % du poids corporel ou les 2/3 de l’eau
totale.98 % du K+ échangeable sont contenus dans le LIC à une concentration variable selon
les tissus, d'environ 140 mmol.l-1(fig. 10-1). Les tissus les plus riches en K+ sont les
muscles (autour de 2 635 mmol), les globules rouges (250 mmol), le fpie (250 mmol). Les
anions sont csscntiellement les phosphates et les protéines;
— le tiquide extracellutaire (LEC) représente 20 % du poids corporel on le 1/3 de
1'eau totale. 98 % du Na +échangeable est contenu dans le LEC à une concentration
de 140 mmol.l-1 (fig. 10-2). Cette particularité explique que les solutions sodées agissent
exclusivement sur le remplissage extracellulaire. Les anions sont essentiellement le chlore et le
bicarbonate. Il est commode de dire que les concentrations d'électrolytes dans les deux
secteurs sont inversées. Le LEC est lui même subdivisé en deux sous-secteurs : le secteur
interstitiel représente 15 % du poids du corps, le secteur vasculaire 5 %. Si son
importance quantitative est faible, son importance qualitative est grande. D'une part,
son remplissage comme sa vidange représentent une priorité immédiate quel que soil
l’état des autres secteurs, d'autre part, la correction des deséquilibres passe
necessairement par lui: un temps de latence est done obligatoire pour agir sur les autres
secteurs, d'autant qu'il convient d'éviter autant l'hypovolemie que l'hypervolemie.
La difficulté de la réanimation hydroélectroilytique dent à l’impossibilité de connâitre
la valeur absolue de la teneur en eau et de sa répartition et de 1'utilisation de moyens
d'appréciation qualitatifs non spéctfigues d'autant plus imprécis et moins fiables que l'on
s'éloigne du secteur vasculare; les settles quantifications dont dispose le clinicien sont
des concentrations du secteur vasculare qu’il ne faut pas assimiler au pool (fig. 10-3).
Les échanges entre les deux compartments utilisent des mécanismes différents:
— les mécanismes d'échange des solutée sont passifs,représentés par la diffusion, et

actifs membranaires dominés par 1'ATPase Na+-K+ à l’origine de la différence de
composition sans gradient de concentration entren LIC et LEC. Les phéno mènes
mcmbranaires peuvenl subir dcs influences pharmacologiques à l’origine surtout de transferts
potassiqucs anormaux dans un sens ou dans un autre;
— les mécanismes d'échange du solvant sont exclusivement passifs, représents par
la pression hydrostatique et la pression osmotique. Il interviennent tous deux dans les
échanges d'eau de part et d'autre de la membrane vasculaire comme le fait ressorter
l'équation de Starling; l’imperméabilité de la paroi vasculaire aux grosses molécules
explique leur place dans le remplissage vasculaire, alors que les solutions sodées se
répartiront en respectant la proportion 3/4-1/4 entre secteur interstitiel et secteur
vasculaire.
Les échanges d'eau de part et d'autre de la membrane cellulaire dépendent non
d'une valeur absolue, mais d'un gradient de pression osmotique entre LIC et LEG, en
rappelant que le clinicien ne peut connâitre que la concentration particulaire du LEG
(soit la pression osmotique mesuree ou abaissement du delta cryoscopique,soit la
pression osmotique calculée = natrémie x 2). Les variations de concentration sodée
sont pour la presque totalité responsables de ce gradient qui répartit différemment de
la normale l’eau entre LIC et LEC. Celle-ci se déplace du secteurs le moins
concentré vers le secteur le plus concentré jusqu'a nouvelle égalisation de la pression
osmotique entre les deux secteurs. Ces données expliquent pourquoi le remplissage
du LIC passe par l'utilisation soit de solutions hypotonique en Na+, soit de solutés
isotoniques en glucose et sa déplétion par celle de solutions hypertoniques sodées ou
non.
BASES PHYSIOPATHOLOGIQUES
Les rappels précédents cxpliquent l'existence possible de 6 troubles élémentaires de
l’hydratation
— les atteintes respectant la proportionnalité 2/3-1/3 entre LIC et LEC sont
dues à des variations du seul pool hydrique. Le LIC est quantitativement le plus important
(les 2/3 de l'eau totale), aussi les variations du seul pool hydrique se feront done ressentir
en priorité à ce niveau et en particulier au niveau cérébral : hypertension intracrânienne en
cas de surcharge, troubles de la conscience d'intensité variable en cas de déplétion : la
rétraction cérébrate et les ruptures veineuses qui 1'accompagnent expliquent la possibilité
d'hématome cérébral chez 1'enfant et le vieillard. L'atteinte du LEG est dans ce cas
cliniquement au second plan (en dehors de l’hémorragie);
— l'atteinte isolée du LEC est la conséquence d'une surcharge ou d'une perte
isotonique sodée. La répartition 2/3-1/3 n'est plus respectée, mais la quantité d'eau
contenue dans le LIC ne varie pas en raison de l'absence de gradient osmotique. Les
conséquences en sont essentiellement vasculaires : hyper- ou hypovolémie dont la
symptomatologie est bien connue. L'atteinte du secteur interstitiel se recherche soit par
le signe du mouchoir en cas de déplétion, soit par le signe du godet en cas d'inflation;

— I'atteinte dissociée des deux secteurs appélee dyshydratation est la conséquence d'un
deséquilibré osmotique au niveau da LEC.
L'inflation hydrique absolue ou relative par rapport au pool sodée responsable d'une
hyponatrémie avec osmolarité basse est le trouble le plus fréquent. Quel que soit l'état
du LEC, augmente (oedèmes), diminué (signe du mouchoir) ou apparemment normal, la
baisse de la concentration particulaire par rapport au LIC entraîne un transfert d'eau du
LEC vers le LIC avec risque d'hypertension intracrânienne.
La surcharge particulaire absolue ou relative du |LEC peut être due au sodium:
perfusions de quantités importantes sur un temps bref de sérum bicarbonaté
hypertonique; à des particules noil sodées : mannitol, glucose essentiellement dans le
cadre d'une insuffisance rénale aiguë ou chronique; celle-ci êmpeche l'effet de diurèse
osmotique qui en éliminant ces osmoles est responsable normalement d'une dehydratation
globale. Dans ces deux cas d'' hyperosmolarité avec hypernatrémie si la surcharge est
sodée ou avec hyponatrémie si la surcharge est non sodée se produit un transfert d'eau
du LIC préjudigable pour le cerveau, vers le LEC : le retentissement dépend de son
étiage initial et de l'état cardiovasculaire.
En pratique clinique chirurgicale, plus que des troubles élementaires se
rencontrent des troubles mixtes de traitement plus ou moins facile : le secteur
vasculaire reste à la fois la priorité immédiate qu'il y ait surcharge ou déplétion et
l'intermédiaire pour agir sur les autres secteurs : apport ou soustraction isotoniques de
sodium pour agir sur le secteur interstitiel, apport de solutés hypertoniques ou
hypotoniques en sodium ou non pour agir sur le LIC.
Déséquilibres électrolytiques
Les déséquilibres sodées ont éte envisagées avec les déséquilibres hydriques.
Les déséquilibres potassiques soni fréquents. Le K+ pénètre dans l'organisme par voie
entérale ou parentéral, est stocké dans le LIC a une concentration 35 fois supérieure à
celle du LEC, par des mécanismes de transfert membranaire, est éliminé dans les
conditions normales par le rein, . avec possibilité de pertes digestives supplémentaires
en pathologic Le K+ extracellulaire ne représente que 2 % du pool potassique.
Les variations de la kaliémie sont la conséquence de perturbations de 3
mécanismes : les deux premières sont une modification des apports qui jouent
rarement seuls, ou un trouble de l’élimination rénal ou digestif. Dans ces cas les plus
fréquents, la kaliémie varie directement avec les stocks intracellulaires sans
corrélation rigoureuse. La troisième est un trouble de distribution entres LIC et LEC,
le plus souvent une sortie de K+ du LIC vers le LEC. Même si les quantités ainsi
transferées sont faibles en valeur absolue, ellcs sont susceptibles d'entraîner des
variations importantes de la kaliémie sans modification du pool. En effet, le pool
potassique du LEC est de 60 mmol pour une kaliémie normale de 4,5 mmol.I-1. Ce
transfert est la conséquence d'une atteinte membranaire consécutive à plusieurs a
facteurs : l'insuline, 1'aldostérone, les catécholamines et les médicaments qui

interfèrent avec eux,la concentration en ions H+, les curares dans certain es conditions.
On peut en rapprocher l'hyperkaliémie de la rhabdomyolyse même limitée et de
1'hemolyse intense.
Le K+ étant un ion cellulaire contenu pour la plus grande part dans les muscles, les
dyskaliémies retentissent d'abord sur le coeur, plus tardivement et au second plan sur
les muscles lisses ou squelettiques.
L'hypokalémie se définit par une baisse de kaliémie au-dessous de 3,5 mmol.
l-1.Les anomalies ECO les plus préoces sont caractéristiques. Initialement apparaît un
sous-décalage de ST,un aplatissement de l’onde T et une onde U responsable d'un
pseudo-élargissement de l'espace QT. Quand rhypokaliémie s'aggrave, l'onde P
devient ample et pointue, l'onde QRS s'élargit. Les troubles du rythme sont
initialement supraventriculaires et sans conséquence hémodynamique. Les
dysrythmies ventriculaires menaçantes sont rares et tardives. Les digitaliques ont un
effet potentialisateur et aggravant même à des concentrations non toxiques.
L'effet périphérique le plus important est la paralysie des muscles lisses
périphiriques responsable d'un état subocclusif de type chirurgical et d'une rétention
d'urines.
L’hyperkaliémie se dénit par une élevation de la kaliémie au-dessus de 5 mmol.l -1.
Elle est une urgence en raison du risque de mort subite par fibrillation ventriculaire
rebelle au choc électriquc. Les modifications ECQ initiates sont représentées par des
ondes T pointues et hautes avec raccourcissement de l'espace QT. A un stade plus
avancé, QRS est allongé, et l'onde P s'aplatit. Le traitement agit a 3 niveaux possibles :
en premier lieu en provoquant l’entrée intracellulaire du K+ par l'association
glucose-insulinc et l’alcalinisation par le serum bicarbonaté, moyens couramment
utilisés en première intention; en second lieu en soustrayant le K+ du LEC par les
diurétiques si l'émonctoire rénal fonctionne, ce qui est loin d'être toujours le cas, par
les résines échangeuses d'ions qui peuvent être administrées par voie gastrique ou
colique, enfin par l’épuration extrarénal qui représente un moyen très efficace, parfois
le seul pour des hyperkaliémics graves et autoentretenues, situation
rencontrée au cours du crush syndrom. II est possible enfin de s'opposer à l’action
membranaire du K+ par 1' administration de Ca++ d'effet précoce et transitoire;
l'indication ne se pose que pour des intoxications graves, en urgence, quand les ondes
P disparaissent ou que QRS s'élargit, sous surveillance cardioscopique.
Les désequilibres calciques sont plus rares.L'hypocalcémie est un risque fréquent
chez l'enfant et une anomalie biologique habituelle chez l'insuffisant renal chronique.
L'hypercalcemie se rencontre surtout chez l’adulte dans le contexte d'une
hyperparathyroïdie ou d'un syndrome para-néplasique ou après apport intempestif de
calcium au cours d'une transfusion massive. Les effets de la variation de ia calcémie
et de la kaliémie sont opposés. .
Il faut souligner la fréquence sous-estimee de I'hypomagnésémie dont les
manifestations cliniques sont proches de cellc de l’hypokaliémie.

Déséquilibres acidobasiques
L'application de la loi d'action de masse aux acides, en particulier à l'acide
carbonique (en lui substituant la pression partielle de gaz carbonique) permel
d'écrire que :
H+=24PaCO2 /Bic
Cette équation appelée équation de Henderson est plus facile d’ approche pour le
clinicien que l’équivalent logarithmique appelé équation de Henderson-Hasselbach
donnant la concentration de H+ en unités pH (des tables de correspondance existent
entre ces deux unités). A côté de cette équation, il est possible d'utiliser l'équivalent
graphique qui permet peut-être une approche diagnostique plus simple.
Les phénomènes pathologiques provoquant une variation initiale du numérateur
de l'équation, c'est-à-dire des modifications de la capnie, s'appellent les déséquilibres
ventilatoires qui ne seront pas envisagés ici. Les phénomènes pathologiques provoquant
une variation initiale du dénominateur, c'est-à-dire des variations de la bicarbonatémie,
s'appellent des déséqinlibres métaboliques.
Quand se produit une variation primitive de la PaCO2, ce qui correspond à un
déplacement sur la ligne verticale du graphique partant de la valeur normale des
bicarbonates, les bicarbonates sous l'influence d'une régulation rénale varient dans le
même sens; quand se produit une variation primitive des bicarbonates, soit un
déplacement sur la ligne horizontale du graphique partant de la valeur normale de la
capnie, la PaCO2 sous l’influence d'une régulation respiratoire varie dans le même sens.
Ce phénomène bien connu appelé compensation minimise la variation du pH. Il est
quantifiable (tableau I) : sur la figure 10-5 il correspond a un déplacement des valeurs
d'ions H+ des zones verticales ou horizontales vers les zones ombrées. Les déséquilibres
métaboliques simples méritent un développement.
L 'alcalose méitabolique ou hyperbicarbonatémie est la conséquence d'une perte
d'ions H+ d'origine digestive, gastrique surtout, ou rénal par le biais de 1'effet de
diurétiques ou d'un hyperal-dostéronisme primaire ou secondaire. La rétention de
bicarbonates, deuxième mécanisme de production d'une alcalose métabolique, est
iatrogène succedant à des transfusions massives, le citrate étant métabolisé en
bicarbonate, ou à un apport massif de bicarbonate à l'occasion d'une ressuscitation ou
d’un choc. l'alcalose métabolique a une fausse réputation de bonne tolérance alors que
la mortalité est élevée chez les sujets souf-frant d'alcalose métabolique. Le traitement
est soit simple et efficace quand l'alcalose s'inscrit dans un contexte de déplétion du
LEC, la recharge de ce secteur entraînant la correction du déséquilibre; il est plus
complexe dans les autres cas.
L'acidose métabolique ou hypobicarbonatémie est la conséquence soit d'une perte
de bicarbonate, soit d'une surcharge en acides fixes non volatils c'est-à-dire tous les
autres acides que i'acide carbonique. En dehors des données cliniques, le calcul du
trou anionique (fig. 10-6) permet de différencier ces deux groupes :
trou anionique = (Cl- + HCO3-) Na+ - = 10-15 mmol.l-1.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
1
/
9
100%