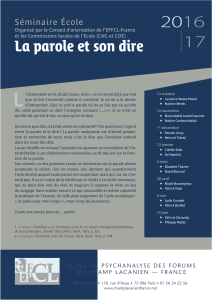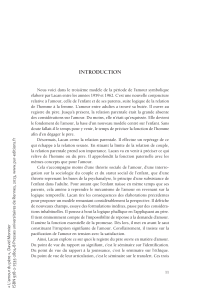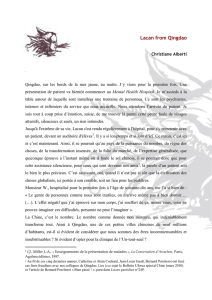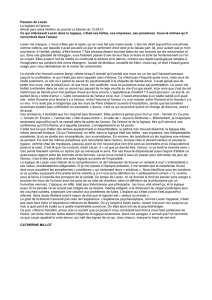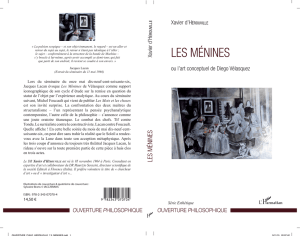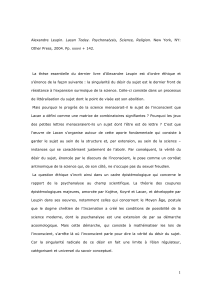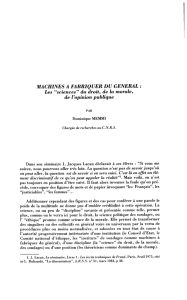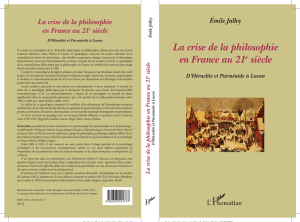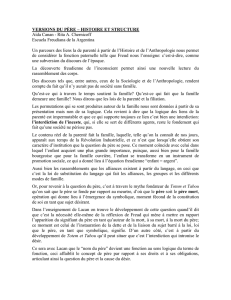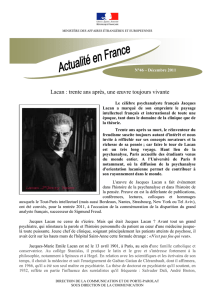une valse a deux temps

UNE VALSE À DEUX TEMPS
Alain Badiou, Barbara Cassin
Il n’y a pas de rapport sexuel. Deux leçons sur « L’Étourdit » de Lacan
Paris, Fayard, Coll. « Ouvertures », 2010, 136 p.
«Il n’y a pas de rapport sexuel» : ainsi Lacan énonçait-il, sous la forme d’une contre-vérité
évidente, un principe prétendant «faire la pige» à Aristote ; et c’est sous ce titre qu’Alain Badiou et
Barbara Cassin signent chacun la moitié d’un livre qui articule la différence même qui les
singularise : la sophiste d’abord, d’une habileté, d’une aisance, d’un sans-gêne langagiers par
moments époustouflants, alignant un texte « vachement pas con » ; puis le philosophe, droit dans
ses bottes et sa puissance conceptuelle, appliqué à retrouver ses marques et son lexique en terre
étrangère, n’en portant pas moins un remarquable diagnostic sur le psychanalyste qui les réunit —
et qui méritait bien ce double et contradictoire patronage. Galanterie éditoriale ? C’est la femme
qui commence, quand la couverture se contente de l’imperturbable ordre alphabétique.
Avec elle, voici donc Gorgias et ses collègues sophistes, au nombre desquels se trouve
enrôlé un Lacan ravi d’apporter des citations qui, non seulement vont dans le sens où on veut
l’entraîner, mais le montrent fort averti des enjeux de la sophistique grecque, jusqu’à s’y identifier
dans une phrase à juste titre montée en épingle et en exergue : « Le psychanalyste, c’est la
présence du sophiste à notre époque, mais avec un autre statut ». Dont acte. Reste à déplier les
attendus d’un tel jugement.
Et d’abord : le principe de contradiction posé par le Stagirite comme le «principe des
principes» est-il, oui ou non, « vachement con », comme Lacan l’énonce sans ambages ? Pourquoi
ce dernier tient-il tant à ne pas se précipiter vers l’identité de la lettre à elle-même qu’implique
assez directement ce fameux principe ? Forte de ses travaux antérieurs
1
, Barbara Cassin montre,
citations de L’Étourdit à l’appui, la prévalence accordée par Lacan à l’équivoque sur l’unicité du
sens —unicité qu’Aristote requiert, lui, pour fonder « ce que parler veut dire ». L’un parle (voire :
écrit) pour que les significations fassent cortège dans une et une seule direction, éliminant
impitoyablement les équivoques générées par le langage ; l’autre se prête presque négligemment
au jeu du sens pour s’enchanter de la matière sonore (et scripturale) du langage, cherchant
l’équivoque avec autant de soin que le premier en met à l’éviter. Adieu la moindre idée de
synthèse entre ces deux frères ennemis : aux yeux du sophiste, le philosophe fait l’effet d’un gros
balourd, les deux pieds pris dans la glaise du sens, quand, aux yeux du philosophe, le sophiste
n’est qu’un bonimenteur, un charlatan — la preuve : il fait payer ses prouesses verbales, alors que
la vérité, on ne le sait que trop, n’est pas une fille facile, etc. Sauf qu’avec Lacan une question
largement inédite se pose : en quoi « il n’y a pas de rapport sexuel » mérite-t-il d’être considéré
comme le principe de toute sophistique qui se respecte ?
« Den » ou « Mêden » ?
La trouvaille de Barbara Cassin consiste à aller chercher un allié que Lacan, au demeurant,
lui indique : Démocrite. Non que celui-ci se soit beaucoup penché, à notre connaissance, sur les
1
L’Effet sophistique (Paris, Gallimard, 1995), bien sûr, mais sans oublier Si Parménide (Paris-Lille, PUL-MSH,
1980), texte germinal s’il en fut. À quoi l’on ajoutera désormais Jacques le sophiste (Paris, Epel, 2012).

Une valse à deux temps, p. 2
mystères du sexe et du sens confondus, mais l’idée qu’il a pu se faire de la nature des atomes –
une fois retirée la gangue ontologique minimale qu’Aristote s’est empressé de lui conférer – se
montre fort affine à celle des éléments matériels de la langue auxquels Lacan accorde toute son
attention de clinicien.
Nous voilà ainsi ramenés au riche terrain de la lexicographie. Qu’est-ce donc que le « den »
dont Démocrite taxe ses atomes ? Même pas un mot de la langue grecque, les dictionnaires se
contentant pour la plupart de l’ignorer ! Le lecteur qui n’a pas lustré ses manches à parcourir la
littérature philologique découvrira avec bonheur, à travers le commentaire doxographique érudit
de Cassin, le bricolage linguistique qui a donné naissance à ce mot-clef de la physique
démocritéenne.
Via Plutarque et Galien, on apprend que Démocrite distinguait entre le « den » des atomes
et le « mêden » du vide, entre lesquels se tissent de subtils échanges. Or ce « den » vient d’une
troncature de deux éléments négatifs présents dans le grec classique, à savoir ou et mê, le premier
renvoyant à une négation de fait et objective, le second à une négation modale et subjective. Si je
fais porter ces deux types de négations sur le un (hen en grec), j’obtiens soit ouden (ou-de-hen : pas
même un), quelque chose qui n’est pas là, factuellement ; soit mêden (mê-de-hen : pas même, et
surtout pas, un), quelque chose qui ne peut en rien être là, ni ailleurs, le néant pur et simple. Mais
l’important tient au fait que « den » est découpé en dépit de l’étymologie, avec un bout de la
particule qui fait liaison avec la négation et le un qu’il s’agit de nier diversement. Pour Démocrite,
commente Heinz Wismann, il s’agit de montrer que « la positivité de ce qui est n’existe que grâce
à la négativité de ce qui n’est pas (mêden – mê = den)
2
». Cassin le traduit poétiquement par le
français « ien » (et même plus justement « iun »), obtenu en sectionnant le mot « rien », qui lui-
même vient du latin rem (chose), d’une façon qui prend à rebours tout bon sens linguistique. Et
donc le « den » démocritéen, dans son ambition de dire la nature même des atomes qui peuplent
l’univers, ne désigne ni le rien ni le quelque chose à quoi Aristote tenait à le réduire, mais ce que
l’on obtient en ôtant au vide lui-même sa négativité.
Si bien qu’avec ce den entendu tel que Cassin le déplie, on n’est plus exactement dans
l’ordre du discours célébrant la phusis – le monde, la nature, les étants – on n’est plus dans l’ordre
du signe développant un signifiant dont l’accouplement à un signifié parvient à attraper un
référent, on se trouve dans une production linguistique qui s’affiche comme telle, dans sa
prétention à manifester d’abord du langage. Un néologisme, certes, mais dérivé en dépit des
jointures usuelles de la langue grecque. Ce qui ne l’empêche pas de fonctionner aussi comme
signe, puisqu’il entend renvoyer à ce référent physique que serait la nature même des atomes
(fidèle à son principe d’univocité du sens, Aristote ne retient que cette fonction) ; mais même
considéré sous cet aspect, ce qu’il désigne n’est pas vraiment hors de lui, c’est encore lui en tant
que flatus vocis, rature langagière dans la pureté du non-être, du vide, du rien, du mêden dont il est
extrait. Pour le dire en termes post-saussuriens : manifestation du signifiant en tant que tel (si cela
se peut !).
Voilà en quoi le den vient à Lacan comme bague au doigt : il ne cherche pas, en effet, à
refiler à Freud un nouveau discours, plus « linguistique », sur la réalité psychique inventée par son
prédécesseur. Il entend établir la place et la fonction de ce qu’il a nommé, d’un mot ancien
revisité : le symbolique, qui excède de beaucoup la langue naturelle, laquelle néanmoins le
structure. Non pour inclure ce symbolique new look dans le champ des savoirs désormais à
parcourir (tel l’univers devenu objet de science à cause de la relativité générale, alors qu’il était
jusque-là proscrit pour tout savant honnête) ; mais pour extirper quelques conséquences du
maniement d’un tel outil chez l’être humain dès lors que celui-ci entend signifier quoi que ce soit.
Avant, donc, bien avant tout bouclage sur l’univocité du sens et l’identité de la lettre à elle-même,
2
Heinz Wismann, Les Avatars du vide. Démocrite et les fondements de l’atomisme, Paris, Hermann, 2010, p. 48.

Une valse à deux temps, p. 3
vient jouer, de façon aussi décisive que cachée, l’impact de cet appareil sur l’être parlant qui le
déroule, et s’en croit stupidement quitte (« connerie » d’Aristote). Il ne s’agit pas, dit un jour
Lacan, « de parler de la parole, mais de parler dans le fil de la parole
3
. » Ce fil a été l’affaire de sa vie,
il y a entraîné quelques autres.
À cause du langage qu’ils reçoivent tous deux en fermage obligé, le mâle et la femelle de
l’espèce humaine sont pressés d’advenir comme homme et comme femme, plus ou moins en
fonction de leur sexe de départ. Dans l’ensemble, ils y parviennent, quoique inégalement. Mais à
cause de ce fichu « den » qui revient, en la circonstance, à cette appropriation de la langue par
laquelle chacun se fait « je », cet indispensable petit caillou énonciatif s’avère, lui, rebelle à la
sexuation. Et donc : « Il n’y a pas de rapport sexuel » qui se puisse écrire, qui se puisse soutenir
dans l’ordre du langage hors lequel il n’est point de sujet. CQFD. Merci le den qui montre bien le
jeu de la faille langagière dans l’appréhension du réel (sexuel). Merci Barbara Cassin.
Vérité-savoir-réel : un triplet pour un pas de deux ?
C’est alors qu’entre en scène le philosophe, aristotélicien par définition, voué qu’il est à sa
puissance d’affirmer. On apprend vite que le « fil conducteur » sera « comme toujours, l’examen
du rapport de Lacan à la philosophie. En définitive, c’est la seule chose qui m’intéresse (p. 105). »
Au moins y aura-t-il ainsi du rapport en perspective, et plutôt du genre contradictoire puisque
Lacan est rangé, avec raison, du côté de l’antiphilosophie, tandis que Badiou entend défendre les
couleurs de la philosophie. Pour en débattre, un triplet est d’emblée proposé – vérité, savoir, réel
–, chacun des deux camps étant supposé faire valser les termes à sa manière.
On assiste très vite à un curieux traitement de Lacan. Exemple : « Quelle est, demande
Badiou, aux yeux de Lacan, la vraie nature de l’opération philosophique ? » Il est permis de
douter que Lacan ait jamais posé pareille question, et surtout en ces termes, ce qui n’empêche
certes pas de la lui poser, ni d’y faire la réponse suivante : « L’opération philosophique, aux yeux
de Lacan, est d’affirmer qu’il y a un sens de la vérité. » Quelques lignes plus loin : « C’est là son
axiome implicite ou explicite : il y a un sens de la vérité parce qu’il y a une vérité du réel. »
« Implicite » en effet, au sens où Lacan n’a certainement jamais dit ça, mais ici rendu « explicite »
au sens où Badiou lui suppose cette position pour la clarté du débat qu’il engage avec lui. On
mesure d’entrée les conditions de cette lecture : pour participer au débat auquel il est invité,
Lacan doit d’abord être traduit en termes propres à Badiou. C’est un procédé plus courant qu’on
ne l’imagine, mais il est mené ici avec une certaine rudesse, la position de Lacan dans L’Étourdit se
résumant alors à l’inverse strict de ce qui lui a été prêté comme conception de l’« opération
philosophique », à savoir que pour l’analyste, au dire de Badiou, « il n’y a pas de sens de la vérité
parce qu’il n’y a pas de vérité du réel ».
Je serais bien en peine de savoir si tel est le cas, mais plus en peine encore de montrer que
non. Ça n’est certainement pas aussi marmoréen que ça en a l’air, mais après tout, la hauteur de
ton de L’Étourdit justifie qu’on lui tienne la dragée haute. On a d’ailleurs le sentiment de
progresser lorsque, suivant la distinction entre « non-sens » et « absence de sens » lancée par
Lacan, qui parle alors d’« ab-sens » du rapport sexuel et de « sens ab-sexe », Badiou suit cette
piste : « Tout se joue, dit-il, sur la distinction entre ab-sens et non-sens ». Là, il est presque facile
de lui dire oui.
Admettons en effet que, pour Lacan, le sexe (mais qu’est-ce que c’est que ça ?) n’est ni du
côté du sens, ni du côté du non-sens, mais bien dans ce champ de l’absence de sens, de ce « sens
ab-sexe », comme il est dit dans L’Étourdit ; il devient alors concevable qu’il y ait pour lui un
savoir sur le réel du sexe, mais hors du sens ou du non-sens, donc hors rapport à la vérité, alors
3
J. Lacan, Les Formations de l’inconscient, séance du 6 novembre 1957.

Une valse à deux temps, p. 4
que la philosophie, on l’accordera à Badiou, n’envisage le savoir qu’en tant qu’il peut toucher au
réel grâce aux effets de vérité qu’il atteint en se protégeant du non-sens. À la réflexion, ça se tient.
Si l’on veut bien suivre ainsi Badiou dans son style d’affirmation, on aboutit, aux alentours
de la page 120, à une perception plus fine des griefs que Lacan pourrait avoir à l’endroit de la
philosophie. D’abord elle ignore l’ab-sens (le « sens ab-sexe ») en mettant à sa place quelque
chose comme le principe de non-contradiction (petit salut à Barbara Cassin). Ensuite, elle ignore
ce que le savoir peut avoir de réel ; elle « engloutit [le savoir] dans l’amour de la vérité » (p. 121) .
Et enfin « elle dispose le sens et la vérité en miroir ».
Seul un long et détaillé commentaire permettrait de comprendre jusqu’à quel point ces
mots-clefs que Badiou tient à partager avec Lacan – vérité, savoir réel – œuvrent comme des
concepts identiques chez l’un et chez l’autre. Aristotéliquement parlant, l’homophonie menace et
je parierais volontiers que le seul mot de « vérité » couvre des conceptions pour le moins
différentes. Mais plus que la correspondance terme à terme, c’est la ternarité elle-même qui retient
l’attention, surtout lorsque Badiou en vient à écrire :
Par conséquent, pour Lacan, et c’est, je crois, la thèse la plus neuve et la plus
importante de L’Étourdit, le triplet savoir-vérité-réel ne peut pas se segmenter.
Il n’est pas distribuable en paires […] Si vous prétendez qu’il y a la vérité et le
réel, il faut situer la fonction du savoir, si vous avez un savoir du réel, vous
devez supposer un effet de vérité, et quand vous parlez des rapports entre
vérité et savoir, il faut qu’il y ait du réel.
Arrivé à ce point, le lecteur se souvient d’un bref récit rapporté par Werner Heisenberg
alors qu’il venait tout juste de formuler le principe d’incertitude. En vacances dans un refuge de
haute montagne, il est brocardé sur sa récente découverte par ses amis qui lui disent qu’avec un
tel principe, il est en train de mettre à bas tout le magnifique édifice de la physique classique et
relativiste. À quoi il rétorque : « Mais regardez ! nous sommes en train de faire la vaisselle avec
une eau plus que douteuse, des torchons en lambeaux, et cependant nos assiettes et nos couverts
sont propres ! ». De ces appareillages conceptuels, dont chacun appellerait de longs
développements pour qu’un sens clair en découle, surgit en effet dans le texte de Badiou quelque
chose de propre et net. Le fait est que Lacan rejette toute « mise en paire », l’obsession du nœud
borroméen, si prégnant dans L’Étourdit, en est bien la preuve.
« Les choses alors deviennent beaucoup plus claires », écrit Badiou lui-même après avoir
énoncé ce qui précède et, de fait, il parvient à dire plus simplement ce qui fait de Lacan autre
chose qu’un philosophe, quel que soit le niveau de construction théorique auquel il se place : il
veut un trois qui ne résulte d’aucun appairage, il aurait pu être évêque au premier concile de
Nicée, il faut que ça valse pour que ça tienne. Badiou sent alors qu’il tient l’affaire :
Je pourrais montrer comment dans L’Étourdit […] il s’agit toujours, lorsque
l’on discute de ces questions, de remembrer le triplet […] Je vous propose
alors la définition lacanienne de la philosophie. La philosophie, c’est une
subversion du trois par le deux. La philosophie refuse que le trois soit
irréductiblement originaire, qu’il soit impossible de le déplier dans le deux
(p. 124).
Il ne manque pas de conclure que « la querelle sur le trois et le deux est en définitive une
querelle sur le Un ». Fidèle à sa méthode, il propose alors un « théorème lacanien qui, s’il n’est pas
exactement de Lacan, vaut comme théorème antiphilosophique essentiel. Ce théorème se dit : « Si
l’on subvertit le trois par le deux, c’est que l’on a une pensée fausse de l’un. »

Une valse à deux temps, p. 5
Yad’l’un (ou : Le temps est compté)
Que l’Un soit, que « être » et « un » s’équivalent, ne convenait en effet en rien à Lacan, non
tant parce qu’il aurait voulu se rire des agapes philosophiques où ce genre d’affirmation vaut
ticket d’entrée, mais parce que, sophiste s’il en fut (parce que clinicien), il a tenu à ce que l’on
n’écartât point, sous quelque prétexte que ce soit, le « fil » de la parole, rappelant inlassablement le
fait « qu’on dise reste oublié derrière ce qui se dit dans ce qui s’entend ». La petite friandise du
« qu’on dise »…
Badiou pousse cependant plus loin encore son questionnement en demandant ce qui
pourrait ainsi « gager » le triplet savoir-vérité-réel et sa connexion brutale avec le fait que, d’l’un,
« ya ». Sa réponse a de quoi surprendre, dans le bon sens du terme :
Puisque du réel il n’y a ni connaissance, ni vérité, puisque, au contraire, il n’y a
vérité que sous condition de son enchaînement indémêlable au réel dans la
guise d’une fonction de savoir, il faut bien qu’il y ait, de ce réel, une pure
rencontre. Appelons « acte » le point de la rencontre du réel comme tel
(p. 127).
Point de rapport cognitif au réel ; seulement un rapport pratique, que Badiou nomme,
d’une curieuse expression qu’on ne rencontre pas dans L’Étourdit : « démontrer le réel » : « [Le
réel] relève de ce que Lacan tente d’inventer sous le nom de “démontrer” » (p. 129). Il s’ensuit
qu’un tel réel n’a de chance de se manifester que dans les impasses du fonctionnement
symbolique, un peu comme chez Pascal le raisonnement apagogique est plus conclusif que le
raisonnement positif puisque l’apagogique bute sur le faux et oblige à rebrousser chemin, alors
que le positif laisse ouverte une voie qui sera peut-être bouchée au prochain coup, à la prochaine
« démonstration ». Le réel se devine là où échouent les capacités de la symbolisation, voire (c’est
plus court) de la représentation. De telle sorte que la différence sexuelle se voit ainsi promue au
rang d’un réel lorsqu’on affirme qu’à son endroit « il n’y a pas de rapport » entre les termes que
l’on ne peut pas ne pas constater, à savoir ceux d‘« homme » et de « femme ».
Mais reste aussi la dimension de l’acte, indépendamment de toute « démonstration » par les
voies logiques ou argumentatives diverses. Qu’est-ce donc qui pourrait donner le signe « de ce
qu’on est bien dans l’élément du sens ab-sexe, ou de l’ab-sens, et que donc le réel peut répondre à
sa place ? » (p. 131). Le sort fait par Lacan à l’angoisse apporte la réponse dans la mesure où il l’a
conçue, dès son séminaire sur ce thème, comme l’« affect qui ne trompe pas ». Reprenant son
triplet, Badiou commente alors : « Cet affect fonctionne comme garantie latente de l’effet de
vérité produit par la fonction du savoir dans le réel (p. 131). »
Tout cela s’imbrique assez bien, comme dans un jeu de lego rendu complexe par une
indéniable disparité des pièces, mais non sans produire à nouveau quelque gêne chez le lecteur au
regard des termes ainsi mis en jeu. Commentant deux « exigences » que Lacan aurait énoncées
concernant la conduite d’une cure, Badiou écrit : « La première est de conduire, ou produire, ce
que Lacan nomme une “formalisation correcte” »(p. 132). On a beau chercher, dans le texte de
L’Étourdit et un peu ailleurs, l’endroit précis où Lacan aurait dit ça pour en mieux percevoir les
entours et peut-être en saisir les enjeux, on ne trouve rien de tel, alors que les guillemets
rapportaient clairement la chose à Lacan. Ça n’est pas non plus totalement abusif ; le lecteur
régulier de Lacan peut avoir le sentiment d’« avoir vu ça quelque part » mais, sans en avoir le
cœur net, comment assentir à ce que Badiou en dit ? De même au sujet de la deuxième
« exigence » :
Le problème est que cet affect, qui est en somme l’affect du triplet réel-savoir-
vérité sous la loi du réel, cet affect doit être mesuré dans son usage. Il faut
doser l’angoisse (p. 133).
 6
6
1
/
6
100%