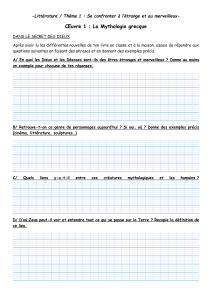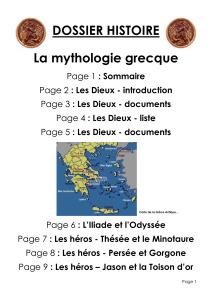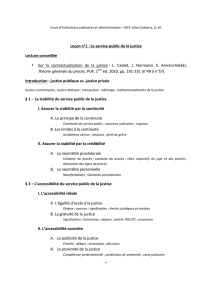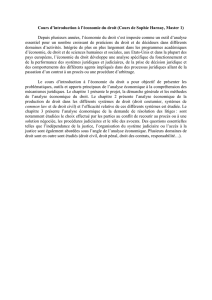finordalie3

Loi des dieux, loi des hommes : deux exemples d’ordalie dans les aventures de Leucippé et
Clitophon.
Intro :
L’ordalie est un ancien mode de preuve dans le domaine de la justice, qui a eu un rôle important
dans l’Antiquité. On se reportera à ce sujet aux analyses que Bernard Sergent y consacre dans son
livre Les Indo-Européens. On sait par exemple qu’il joue un certain rôle dans la législation hittite.
On associe souvent l’ordalie à une conception archaïque de la justice. Mais, si on s’appuie sur les
textes anciens, on se rend compte que c’est loin d’être aussi simple. Ainsi le code de lois hittite qui
est un code indo-européen très ancien, fortement marqué par le rationalisme toutefois, connaît
l’ordalie : ce procédé est intégré à la justice, dans des limites et des circonstances étroitement
délimité.
Aujourd’hui nous nous intéresserons à l’ordalie dans un cadre bien différent, celui de des romans
hellénistiques. On a, au travers du roman d’A. Tatius, qui date certainement du deuxième siècle
après J. C., deux exemples d’ordalie que l’on va étudier plus précisément. Deux jeunes femmes
subissent l’ordalie à la fin du récit ; dans les deux cas, il s’agit de connaître la vérité en l’absence de
moyen rationnel ou juridique plus pertinent. Cette double ordalie se déroule à Ephèse, dans le
sanctuaire d’Artémis. Mais les deux cas considérés sont différents : pour la première jeune femme, il
s’agit de savoir si elle est encore vierge, comme elle le prétend, pour l’autre, il s’agit de savoir si elle a
– ou non – commis un adultère. Si la présence de l’ordalie à cette époque tardive peut nous étonner,
cette procédure semble cependant intégrée à la justice.
La visée de cette communication est de définir les liens qui existaient entre la justice traditionnelle et
le recours à l’ordalie, à une époque où droit et religion étaient encore étroitement mêlés.
Définitions des épreuves :
Origine des deux épreuves : mythes et divinités.
La première ordalie doit permettre de déterminer si Leucippé est encore vierge. En l’absence de tout
moyen objectif, de toute preuve scientifique et médicale, elle doit subir l’ordalie qui consiste à entrer
dans la grotte de la syrinx, située sur le sanctuaire d’Artémis, à Ephèse.
Cette épreuve prend appui sur un mythe, rapporté dans le roman par le prêtre d’Artémis, au cours
d’un banquet qui suit le long procès qui a échoué à déterminer la culpabilité ou l’innocence de la
jeune fille. Le mythe en question appartient à la geste de Pan, dieu sauvage aux pulsions sexuelles
désordonnées. Tombé amoureux d’une jeune fille, il la poursuit mais elle le fuit et s’enfonce dans la
terre, qui fait naître à sa place des roseaux. Le dieu les coupe, croyant que la jeune fille se cache dans
ce marais, puis se repent à l’idée qu’il a tué la jeune fille. Il utilise alors les roseaux coupés pour
fabriquer une syrinx, qu’il consacre et suspend dans une grotte, qu’il offre à Artémis, après avoir
convenu avec elle qu’aucune femme ne pourrait descendre en cet endroit
1
.
Ainsi, dans le roman d’A. Tatius l’épreuve qui doit déterminer si la jeune fille est encore vierge –
c'est-à-dire en dehors de la société, dans une phase antérieure à son entrée dans le monde adulte
civilisé - met en scène deux divinités qui appartiennent au monde sauvage : Pan et Artémis.
La seconde ordalie doit établir si Mélitté a - ou n’a pas - commis d’adultère. Là encore, l’épreuve se
déroule à Ephèse, dans le sanctuaire d’Artémis.
1
Achille Tatius, Le roman de Leucippé et Clitophon, VIII, 6, 7 sq.

De la même façon que pour la première ordalie, un mythe – intégré à la narration, cette fois - vient
soutenir la légitimité de l’épreuve que doit subir la jeune femme : une jeune femme du nom de
Rhodopis menait une vie de sauvageonne, vivant dans les bois et pratiquant la chasse. Remarquée
par Artémis, elle prête serment à la déesse de lui rester fidèle et de fuir la gent masculine. Aphrodite
en prend ombrage et veut lui faire payer cet acte d’hybris : aidée par son fils, elle fait en sorte que
Rhodopis tombe amoureuse du bel Euthynicos et transgresse le serment qu’elle a prêté à Artémis.
Cette dernière se rend compte de la situation et change en eau la jeune fille, dans la caverne même
où elle l’a trahie et où elle a perdu sa virginité
2
.
Dans le cas de cette seconde ordalie, il s’agit de se prononcer sur une femme mariée, donc intégrée à
la société. L’épreuve qui doit déterminer si la femme mariée a respecté le contrat qu’elle a contracté
par le mariage et qui lui permet de donner à la famille une lignée pure fait intervenir deux divinités
rivales : l’une qui appartient au monde sauvage et à la nature, l’autre au monde civilisé.
Les éléments communs à ces deux mythes.
Le lieu : Ephèse et le sanctuaire d’Artémis. On est dans un univers civilisé et sacré, avec des
présences divines fortement marquées, et pourtant, on est proche aussi de la nature et du monde
sauvage, avec les grottes et les forêts.
L’Artémis d’Ephèse : elle est la lointaine héritière des divinités anatoliennes. Elle a des traits
spécifiques. Il s’agit d’une divinité appartenant au monde sauvage, liée à la fécondité. Ces traits la
rattachent à la déesse hittite Inara. Dans les deux mythes, si Artémis apparaît bien avec son
caractère grec - il s’agit d’une divinité vierge - elle est associée soit à Pan, divinité à la sexualité
débridée, soit à Aphrodite et Eros, qui sont aussi du côté de la sexualité, comme Inara.
Les personnages : on remarquera l’importance des jeunes filles et du thème de la virginité, auquel il
faut joindre les thèmes de la métamorphose et de la puissance divine : la terre enfante des roseaux à
la place de Syrinx et Artémis change Rhodopis en source.
La grotte : il s’agit d’un lieu très important dans les deux mythes que nous avons analysés, aussi
mérite-t-elle que l’on s’y attarde quelque peu. Les grottes et cavernes sont communément des lieux
propices aux activités relevant de l’éros comme aux activités clandestines, interdites voire marginales
ou monstrueuses. De nombreux exemples viennent à l’esprit, depuis la grotte abritant les amours
d’Ulysse et Calypso à la caverne du cyclope Polyphème.
La grotte est aussi un lieu topique dans les romans, comme l’a montré F. Létoublon
3
: endroit idéal
pour l’emprisonnement des jeunes filles, c’est souvent le repaire des brigands de toutes sortes.
Dans les deux récits qui nous occupent, la grotte revêt un aspect symbolique spécifique : elle est bien
l’endroit idéal pour les individus en dehors de la société : elle abrite d’une part le désarroi de Pan,
dieu sauvage, donc en dehors de la société, d’autre part les amours interdites de Rhodopis et
Euthynicos.
Mais elle est aussi un lieu sacré, qui met en relation avec les puissances infernales, puisque la
grotte de la syrinx est capable de faire disparaître le corps de la jeune fille impure. La grotte est
également, ici, liée au son, ce qui rappelle qu’elle est un lieu de prophétie. Elle apparaît donc comme
un lieu intermédiaire entre la terre - le monde des vivants - et le monde souterrain, un lieu par lequel
on peut communiquer avec les dieux, en particulier les dieux des Enfers.
On comprend dès lors qu’elle soit un lieu privilégié pour l’ordalie. C’est le jugement des divinités
infernales qu’on attend. Dans ce cadre, la peine de mort n’existe pas : on lui substitue l’abandon aux
dieux. On ne condamne pas quelqu’un à la peine capitale mais on l’expose à un danger capital, avec,
2
Achille Tatius, op. cit., VIII, 22.
3
F. Létoublon, les stéréotypes des romans … Brill

cependant, l’espoir que la divinité vienne au secours de l’accusée, ce qui se produit dans le roman
pour les deux femmes.
L’eau est depuis toujours un élément important dans la religion grecque. On sait que l’eau joue un
grand rôle dans la divination
4
, puisque toutes les divinités de l’eau sont dotées de qualités
prophétiques, qu’il s’agisse des Nymphes, divinités des sources, ou de Nérée ou Protée, liés à la mer.
L’hydromancie utilisait les fontaines et les fleuves et certaines eaux garantissaient les serments et
dénonçaient les parjures. L’eau du Styx (pris ici comme fleuve des Enfers) serait le prototype de ce
genre de fleuves : en effet, lorsqu’un dieu voulait se lier par serment, Zeus envoyait Iris chercher une
aiguière d’eau du Styx.
L’effet d’homophonie entre les deux fleuves – celui des Enfers et celui du roman – ne peut être
fortuit et renforce d’une part le caractère de l’épreuve que doit subir Mélitté, d’autre part
l’importance de la faute commise et de la punition méritée en ce cas.
Toutefois rien n’est dit, dans le roman, du sort des jeunes femmes qui ne sortent pas victorieuse de
l’épreuve.
ἡ δὲ κρίσις· ἐγγράψασα τὸν ὅρκον γραμματείῳ μηρίνθῳ δεδεμένον περιεθήκατο τῇ δέρῃ.
κἂν μὲν ἀψευδῇ τὸν ὅρκον, μένει κατὰ χώραν ἡ πηγή· ἂν δὲ ψεύδηται, τὸ ὕδωρ ὀργίζεται
καὶ ἀναβαίνει μέχρι τῆς δέρης καὶ τὸ γραμματεῖον ἐκάλυψε.
5
Voici quelle est l’épreuve : après avoir inscrit son serment sur une tablette, elle la suspend à son cou,
reliée par un fil. Si elle ne ment pas dans son serment, la source reste telle qu’elle est ; mais si elle
ment, l’eau se met en colère, monte jusqu’à son cou et recouvre la tablette.
Les explications s’arrêtent là ; on peut supposer qu’en cas de mensonge, la justice des hommes
puisse prendre le relais et punir la menteresse, puisque dans le cas contraire ce sont les acclamations
publiques qui valident les signes divins.
L’ordalie s’inscrit dans une tentative de déterminer la vérité et repose sur un constat
d’impuissance des mortels à déterminer la vérité. Le recours à l’ordalie n’est pas spontané, dans
le roman d’Achille Tatius, mais fait suite à des multiples aventures : comme toujours dans les
romans, les deux principaux personnages féminins se retrouvent accusées, l’une de n’être plus
vierge, l’autre d’avoir commis un adultère. En première intention, l’accusateur – le mari qui
pense avoir été trompé – intente, en vain, une action en justice.
Un procès burlesque et impuissant à établir la vérité.
Achille Tatius est le romancier qui se démarque le plus des conventions romanesques, si bien que
l’on a longtemps cru qu’il était le romancier le plus tardif et que son récit n’était que parodie du
genre romanesque, avec une volonté délibérée d’amplifier les idéaux et les invraisemblances qui lui
sont liés. Si cette théorie ne peut résister aux preuves fournies par les découvertes papyrologiques
qui établissent qu’A. Tatius est bien antérieur à Héliodore, il n’en reste pas moins qu’il a un ton
original. Sa façon de traiter le topos du procès en est une bonne illustration.
L’ordalie, en effet, est demandée par l’accusateur, Thersandre, en désespoir de cause, car le procès
qu’il avait intenté n’a pas permis d’établir quelque vérité que ce soit. Pire encore, ce procès se
déroule d’une façon rocambolesque et ressortit plus à une scène de comédie qu’à la solennité d’un
prétoire.
Le procès qui occupe toute la fin du roman est tout d’abord remarquable de désorganisation : effets
de surprise et coups de théâtre se succèdent constamment. Le point de départ est à lui seul un coup
de théâtre : Thersandre que tout le monde croit mort réapparaît subitement. Ensuite, le jour J,
Thersandre et Mélitté produisent de nombreux avocats, qui plaident comme il se doit jusqu’à ce que
4
Quelques remarques sur le rôle de l’eau dans la religion grecque, in L’eau : croyances, symboles et réalités,
Kubaba I, Université Paris I – Panthéon Sorbonne, Février 1999.
5
A. Tatius, Le roman de Leucippé et Clitophon, VIII, 12, 9.

Clitophon, désespéré par une fausse nouvelle, décide de s’accuser du (faux) meurtre de Leucippé et
de se suicider. C’est alors que son cousin Clinias prend la parole de façon impromptue et donne la
version réelle des faits, ce qui a comme conséquence de déclencher toute une série de
rebondissements : Mélitté livre Sosthénés, l’esclave qui retient Leucippé prisionnière pour le compte
de Thersandre, lequel se lance dans un discours fleuve pour réfuter les dires de Clinias et accuser
Mélitté et Clitophon d’adultère et de meurtre ! Le président du tribunal est débordé et condamne
Clitophon à mort mais refuse de se prononcer sur le cas de Mélitté. Il décide de lui faire subir un
nouveau procès.
La confusion, déjà très importante, atteint son comble lorsque le tribunal voit arriver une députation
d’ambassadeurs étrangers, conduits par le père de Leucippé, pour honorer l’Artémis d’Ephèse. Il faut
alors reporter l’exécution de Clitophon.
Enfin se produit le coup de théâtre final : la résurrection de la victime, puisque Leucippé a réussi à
s’échapper de la cabane où on la retenait prisonnière. Cet ultime rebondissement rend donc
caduque la condamnation, puisqu’il n’y a pas eu meurtre. Clitophon est libéré et tout finit par un
banquet !
Mais Thersandre est mauvais perdant et fait reprendre le procès deux jours plus tard ; il intervient
lui-même et se lance dans une longue diatribe fondée sur l’accumulation, dans laquelle il mélange
tout. (VIII, 8, 3) Ce second procès finit en cacophonie et échoue à mettre à jour la vérité.
La désinvolture à l’égard des usages judiciaires.
L’intervention de Clinias, le cousin de Clitophon en plein milieu des plaidoiries est une infraction aux
usages judiciaires et confirme que ce topos du procès est ici traité de façon ludique.
De la même façon, à la fin du procès, les avocats de Clitophon et Mélitté n’arrivent pas à prendre la
parole : c’est le défenseur de Thersandre qui occupe le terrain, d’une façon tout à fait incohérente, et
qui se lance dans un discours certes élaboré, du point de vue rhétorique, mais sans lien avec les
débats.
A la fin, c’est Thersandre lui-même qui met fin aux débats - l’institution n’est plus pilotée – en
demandant que Mélitté et Leucippé soient soumises à l’ordalie.
Le prêtre et les références à Aristophane / Les invectives sexuelles.
Le prêtre, tout au long du procès, tient un rôle important ; il est plutôt favorable à l’accusé et à
Leucippé et leur offre un banquet après l’acquittement de Clitophon. Mais c’est au cours de la
reprise du procès, deux jours après la réapparition de Leucippé, que son comportement et son
langage vont le construire en personnage transgressif : le prêtre, attaqué par Thersandre et agacé
par celui-ci, va répondre en abordant un sujet qui n’a aucun rapport avec le procès : les penchants
efféminés de Thersandre.
Par cette façon de rapporter le procès, A. Tatius souligne sa désinvolture à l’égard de la
vraisemblance et du respect du topos du procès, mais aussi, sans doute, sa défiance vis-à-vis de
l’institution judiciaire elle-même. Face à l’impuissance de la justice humaine d’établir la vérité, le
recours à l’ordalie, forme de rationalisme ancien s’impose naturellement.
Une forme de rationalisme ancien
L'ordalie était connue dès la plus haute antiquité comme moyen de connaître la vérité. Les Egyptiens,
par exemple, avaient recours à des pratiques de cette nature : lorsqu'il fallait déterminer le degré de
noblesse d'un bébé né d'un père inconnu, l'enfant était jeté dans le Nil. Si celui-ci pouvait se réclamer
d'une famille noble, il était sauvé par le Dieu du Nil. Mais s'il ne l'était pas, alors il se noyait. D’autres
peuples anciens recouraient aussi au jugement des dieux. On pourrait évoquer des exemples
d’ordalie chez les Celtes, notamment par l'eau : telle ou telle source sacrée se met à bouillir en cas de
parjure ; l’ordalie sert à prouver la légitimité d'un roi : les signes examinés vont du simple succès de

son règne à diverses épreuves qu'il doit se montrer capable de réussir ; il y a aussi des serments
ordaliques tel celui de la dénonciation en paternité sous menace de fausse couche en cas de
parjure...
En ce qui concerne le monde grec, le recours à l’ordalie n’est pas clairement établi. Glotz affirme qu’il
est « impossible qu’ils n’aient pas connu l’ordalie. »
6
Il convoque à l’appui de son propos un passage
de l’Antigone de Sophocle, lorsque les gardes qui devaient surveiller le cadavre de Polynice essaient
de contrer l’accusation de négligence :
« Nous étions prêts à prendre en main les fers rouges, à marcher à travers le feu et à jurer par devant
les dieux de n’avoir été ni coupables ni complices. »
7
Pourtant, les gardes qui demandent à Créon de leur faire subir une épreuve ne s’expriment pas
devant un tribunal. L’ordalie ne s’applique pas, ici, par ordre des juges, mais par l’effet d’une volonté
particulière. En tout état de cause, il n’existe pas de preuve irréfutable de cette pratique dans le
monde Grec.
Dans tous les cas, il s’agit de mener l’investigation sur un sujet donné et d’appréhender la vérité en
recourant, en dernier lieu, au savoir des dieux qui ont des connaissances supérieures aux nôtres. Il
s’agit donc bien d’un mode de preuve, c'est-à-dire, d’une forme de rationalisme. Le recours aux dieux
est un rempart contre l’aporie ou l’arbitraire.
Deux cas peuvent, cependant, se présenter :
Dans le premier cas, les hommes reconnaissent leur impuissance à faire émerger la vérité par les
moyens qui leur sont propres et demandent aux dieux de se prononcer. L’ordalie a alors lieu mais in
fine, ce sont les hommes qui prennent la décision d’absoudre l’accusé. C’est ce que l’on trouve dans
la civilisation hittite ; c’est aussi ce que l’on trouve dans la première ordalie de notre roman, au
terme de l’épreuve subie par Leucippé. Les portes de la grotte s’ouvrent et le peuple réagit
bruyamment, validant le jugement de la syrinx.
Comme je me disais ces mots, une harmonieuse mélodie se fit entendre et l’on dit que l’on n’avait
jamais encore entendu de plus suave mélodie ; aussitôt nous vîmes les portes grandes ouvertes.
Quand Leucippé sortit d’un bond, le peuple tout entier poussa des cris de joie et injuria Thersandre.
8
La quête de la vérité s’inscrit ici dans un rapport dialogique entre les hommes et les dieux : les
hommes reconnaissent leur impuissance, questionnent les dieux, qui se prononcent, et les hommes
reprennent l’initiative pour valider la réponse, absoudre l’accusé(e). La validation de la réponse
divine qui devient vérité judiciaire devant la justice des hommes apparaît encore plus nettement
dans le cas de la femme adultère :
Lorsque se fut écoulé les temps que l’on avait fixé que Mélité devait passer dans la source, le
président la prit par la main et la fit sortir de l’eau.
9
Pour le second cas, les hommes reconnaissent leur impuissance à faire émerger la vérité par les
moyens qui leur sont propres et demandent aux dieux de se prononcer. L’ordalie a alors lieu mais les
dieux gardent la main, en quelques sortes. Dans cette hypothèse, nous disposons de moins
d’éléments d’analyse car les héroïnes ne s’y trouvent pas confrontées. Toutefois, si Leucippé n’avait
pas été reconnue innocente, la situation eût été différente : les dieux se seraient prononcés mais ils
auraient agi eux-mêmes et puni l’accusé(e) de leur propre chef : les portes seraient restées closes et
il y aurait eu disparition du corps. On se trouve là devant une forme d’ordalie différente. La
collaboration entre les hommes et les dieux ne laisse plus de place aux hommes. Dans ce cadre, où le
corps de la personne déclarée coupable disparaît, on peut se demander si l’on n’aurait pas affaire à
une forme de punition proche de l’emmurement, peine de mort pratiquée assez couramment pour
punir les femmes, en particulier
10
.
6
G. Glotz, L’ordalie dans la Grèce primitive, p. 2.
7
Sophocle, Antigone, 264-266.
8
A. Tatius, VIII, 14, 1-2.
9
A. Tatius, VIII, 14, 4.
10
Voir sur ce point les analyses de E. Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%