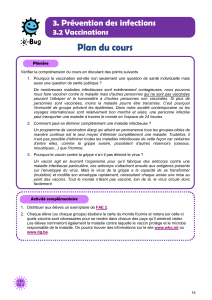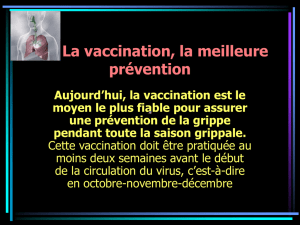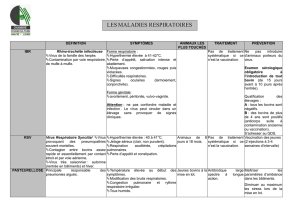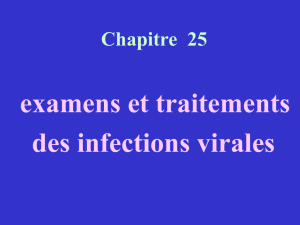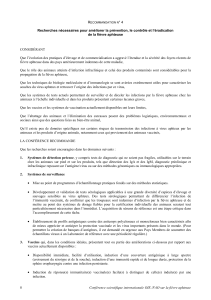L`épizootie de fièvre aphteuse à l`épreuve de la vaccination

L'épizootie de fièvre aphteuse à l'épreuve de la
vaccination
LE MONDE | 28.03.01 | 13h42
Alors qu'à l'échelon moléculaire, on connaît tout de la
structure du virus aphteux et alors que l'on dispose de
différents outils vaccinaux permettant de prévenir
l'apparition de la maladie, on ne peut nourrir aucun espoir
quant à son éradication planétaire à court ou à moyen
terme.
AVEC L'AGENT pathogène de la fièvre aphteuse, on est confronté
à un paradoxe fréquent en virologie : alors qu'à l'échelon
moléculaire, on connaît tout de la structure du virus aphteux et
alors que l'on dispose de différents outils vaccinaux permettant de
prévenir l'apparition de la maladie, on ne peut nourrir aucun espoir
quant à son éradication planétaire à court ou à moyen terme.
Il aura, au total, fallu près d'un siècle entre la démonstration - en
1897 par les biologistes allemands Löffler et Frosch - du caractère
transmissible et viral de la fièvre aphteuse et la publication (le
23 février 1989 dans les colonnes de l'hebdomadaire scientifique
britannique Nature) de la représentation tridimensionnelle du virus
aphteux. Entre-temps, de longs et patients travaux de biologistes
et de vétérinaires avaient permis d'identifier et de mieux
comprendre les caractéristiques de ce virus de petite taille
appartenant à la famille Picornaviridae et au genre Aphtovirus.
Ces travaux ont notamment permis de mettre en évidence la très
grande variabilité génétique de ce virus à ARN constitué d'une
petite capside de symétrie icosaédrique de 30 nanomètres de
diamètre (30 millionièmes de millimètre) et composée de quelques
protéines seulement. Cette tendance naturelle à modifier son
patrimoine génétique lui confère le moyen de s'adapter très
rapidement à des situations épidémiologiques nouvelles et fait que
l'infection aphteuse demeure endémique dans certaines régions du
monde. A cette variabilité s'ajoutent d'autres facteurs aggravants :
capacité du virus à résister dans le milieu extérieur et à infecter
nombre d'animaux (bovins, porcins, ovins et caprins, qu'ils soient
d'élevage ou sauvages) ; le taux d'excrétion virale très élevé chez
certains d'entre eux ; existence d'infections chroniques
inapparentes. Conséquences : une extrême contagiosité de
l'infection et la survenue récurrente d'épizooties d'ampleur variable.
Le professeur Jean Blancou rappelle, dans Histoire de la
surveillance et du contrôle des maladies animales
transmissibles(éditions de l'Office international des épizooties), que
c'est en 1925, grâce aux travaux de Vallée, Carré et Rinjard, que
l'on obtint les premiers résultats positifs de vaccination à partir d'un
virus purifié, obtenu in vivoet formolé. En dépit des progrès
accomplis depuis, l'immunisation des animaux est, là où elle est
encore pratiquée, d'une efficacité encore limitée et d'un maniement
parfois délicat.
NOMBREUX TYPES DE VIRUS

On compte aujourd'hui sept sérotypes du virus (dénommés O, A, C,
SAT1, SAT2, SAT3 et Asia1) et, pour chacun d'entre eux, de très
nombreux sous-types caractérisés par des différences structurales
au niveau de l'une des protéines constitutives de la capside virale.
Ces mutations continues du virus - qui n'est pas sans rappeler
celles de nombreux virus pathogènes comme ceux de la grippe et
du sida - peuvent être à l'origine de vaccinations peu efficaces du
fait de l'éloignement entre le virus utilisé lors de la fabrication du
vaccin et celui contre lequel on entend protéger les animaux.
"Ainsi la vaccination appliquée autour d'un foyer épidémique peut
donner une fausse idée de protection, expliquaient en
novembre 1999 dans les colonnes du Bulletin des groupements
techniques vétérinairesEtienne Thiry et Ratiba Baazizi (faculté de
médecine vétérinaire, université de Liège). Si l'épidémie est
provoquée par un sous-type variant par rapport aux sérotypes
présents dans le vaccin, la vaccination va protéger imparfaitement
le bétail et peut-être masquer la dissémination du sous-type
présent dans le foyer."
La question de l'efficacité de la vaccination anti-aphteuse est ainsi,
pour beaucoup, celle des progrès pouvant être accomplis pour
déjouer les capacités de mutation du virus. Celle soulevée par son
usage au sein de l'Union européenne renvoie à la mise au point de
vaccins qui permettraient, en pratique, de faire la distinction entre
les animaux vaccinés et ceux qui sont porteurs des traces
biologiques qui résultent de l'infection naturelle par le virus.
On sait en effet que la réglementation sanitaire internationale,
élaborée par l'Office international des épizooties, interdit aux pays
considérés comme étant indemnes de cette maladie d'importer sur
leur sol des animaux ou des produits qui en dérivent en provenance
de pays qui ne le sont pas. Or cette même réglementation fait
qu'un pays qui maintient une politique de vaccination ne peut, par
définition, être considéré comme indemne, ce statut n'étant
accordé qu'à ceux qui parviennent à ne pas avoir de foyers
épizootiques en l'absence de vaccination.
L'émotion, sinon l'incompréhension, de l'opinion face aux multiples
conséquences de l'épizootie britannique fait que les règles
pourraient être modifiées dès lors que l'on pourrait disposer de
vaccins permettant de faire la part entre animaux vaccinés et
animaux infectés. Force est de constater que les recherches
menées dès les années 1980 sur des vaccins constitués de sous-
unités protéiques du virus n'ont pas débouché sur des vaccins
utilisables sur le terrain.
APPROCHE PROMETTEUSE
Une autre approche, celle des vaccins dits "marqués", pourrait se
révéler plus prometteuse. Il s'agit d'une technique fondée sur le
recours à des protéines structurantes ou non du virus aphteux. Elle
a été notamment développée au sein de Mérial (joint-venture
d'Aventis et de Merck, par ailleurs leader mondial des vaccins et
médicaments vétérinaires) par l'équipe du docteur Michel Lombard.
Ces vaccins, commercialisés depuis 1995 dans plusieurs pays

endémiques, induisent les différences qui pourraient être utiles
dans l'optique d'une reprise de la politique vaccinale.
Pour autant, l'industrie du diagnostic biologique n'a toujours pas
trouvé de consensus de standardisation des procédures de contrôle
indispensables à l'utilisation des vaccins "marqués". Leur usage ne
peut donc pas être reconnu à l'échelon international, ce qui fait que
la vaccination demeure encore incompatible avec les règles
sanitaires et commerciales actuellement en vigueur.
J.-Y. N.
1
/
3
100%