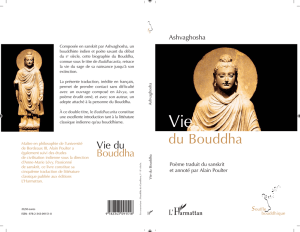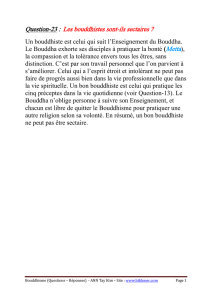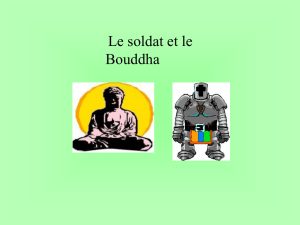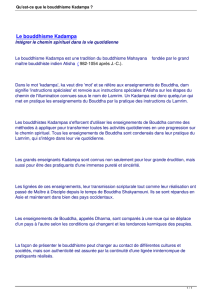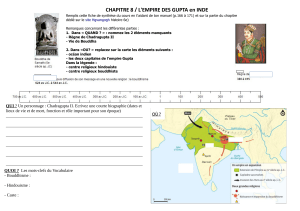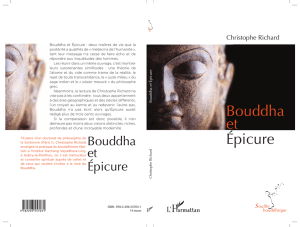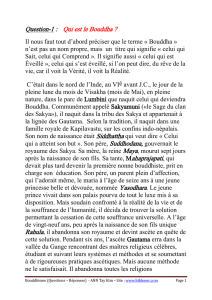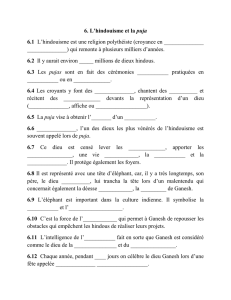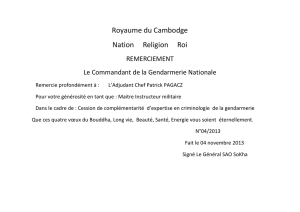Embarquement pour Lankâ

1
Embarquement pour Lankâ
Pourquoi le soi des théories non bouddhistes
Ne serait-il pas un exemple de la nature de l’esprit
Qui, avec ou sans naissance,
Est toujours claire lumière
1
?
« Tout est esprit : le monde et le moi se ramènent à des
contenus de conscience, des perceptions et des activités
psychiques. » Telle est la théorie que le Bouddha et son disciple,
le bodhisattva Mahâmati, dont le nom signifie « Grande
Intelligence », discutent tout au long de ce Soûtra de l’Entrée à
Lankâ.
Lankâ désigne Ceylan, ou Sri Lanka, et plus exactement,
ici, une citadelle perchée au sommet d’un mont tout en pierreries
qui jaillit au milieu de la mer. C’est un sanctuaire aussi étrange
qu’inaccessible, peuplé de monstres polycéphales, les yakshas.
« Étrange » comme l’inconcevable – claire lumière de la nature
de l’esprit qui semble prisonnière des passions douloureuses – et
« inaccessible » comme l’inconditionné – qui n’a ni
commencement ni milieu ni fin –, c’est une image de l’Éveil des
1
Soûtra de l’Entrée à Lankâ, X, 136. Tous les titres ici
mentionnés apparaissent dans la Biblographie en fin de volume.

2
bouddhas, et y « entrer » signifie accéder au cœur même du réel.
D’où l’importance d’« entrer à Lankâ ». Râvana, le démon
souverain de l’île, est en fait un ardent mystique, et il n’a qu’un
désir : accueillir le Bouddha en sa capitale pour recevoir de lui
les enseignements les plus profonds sur l’esprit en tant que
sagesse primordiale et secret fondement de l’univers.
Ici le Bouddha creuse la vacuité dans le sens de la claire
lumière, qu’il appelle « sagesse de la réalisation intérieure des
êtres sublimes », et qui désigne cette puissance de connaître dans
l’évidence dont il fait le moteur de la vie. Vides sont les choses
tant qu’on n’y reconnaît pas ses propres perceptions, tant que, les
prenant pour des objets extérieurs à son esprit, on jouit de se les
approprier pour souffrir de les perdre en refusant de considérer le
caractère entropique de ce triste jeu.
La déclaration « tout est esprit » ne manque pas de sens !
Il est évident que quand je dors ou quand je serai mort, le
monde continuera. Continuera-t-il d’être, d’apparaître ou bien
d’être perçu ? Il continuera comme il continue, que j’y pense ou
non, tant qu’il sera perçu ne serait-ce que par l’être animé le plus
infime, éventuellement le dernier être au monde. Puis, quand ce
dernier être aura disparu, qu’en sera-t-il du monde ? Existera-t-il
encore vraiment s’il n’y a personne pour le percevoir ? On peut
encore se demander quel sens peut bien avoir un monde qui
existerait sans aucune « âme » pour le percevoir ?

3
Si, dans la proposition « tout est esprit », on se représente
assez facilement que « tout » désigne le monde, le mot « esprit »,
chargé d’innombrables significations, se laisse plus difficilement
appréhender. À en croire le texte ici traduit, le Soûtra de l’Entrée
à Lankâ, qui chante sur tous les tons que « tout est esprit, rien
qu’esprit et esprit seulement », « esprit » (citta) est le mot qui a
été choisi pour désigner d’une part un processus sensible
intégrant huit « consciences » et d’autre part la huitième de ces
consciences, appelée « conscience fondamentale »
(âlayavijñâna). Cette dernière, pour dévoiler tout de suite l’une
des thèses les plus importantes du soûtra, est le nom qui
convient, dans la condition qui est la nôtre, à la somme de
« toutes les merveilles » que désigne l’expression « nature de
bouddha » (tathâgatagarbha).
Qu’est-ce qu’une conscience ? Un instant de perception
claire. Par perception j’entends la réaction cognitive à un objet
matériel ou psychique. Cette réaction est claire au sens où elle
répond à certaines classes d’objets et non à d’autres, et dans la
mesure où une conscience correspond toujours à un objet, ni plus
ni moins. En cessant, la perception de l’objet ne s’anéantit pas.
Elle produit un objet psychique, ou mental (caitta) qui, sous
forme de « semence » (bîja), ira rejoindre le train des semences
déjà accumulées dont l’ensemble constitue la conscience dite
« fondamentale » à ce titre et à nombre d’autres.

4
La conscience fondamentale a deux objets : d’une part les
semences et les facultés psycho-sensorielles réunies en un corps,
et d’autre part l’environnement de ce corps, le monde
apparemment extérieur à la conscience fondamentale qui
imprègne le corps.
Comment une perception devient-elle la semence d’une
autre perception ? Son sens, qui est son contenu et l’énergie de
ce contenu, est une merveille de claire lumière impérissable.
Tout ce qui n’est pas immédiatement perçu mais l’a été ou le sera
existe ou existera sous forme virtuelle en constituant des
schémas habituels, des imprégnations, des tendances et autres
propensions : autant de semences où l’expérience se résorbe en
concentrant son sens et d’où, dans les bonnes conditions,
jailliront et jaillissent les perceptions dans leur infinie variété.
Toutes ces semences forment des faisceaux de séries qui
constituent la conscience fondamentale dont la substance est
claire lumière aperceptive.
Ainsi puis-je dire, à en croire le Bouddha du Lankâ, que de
ma conscience fondamentale émergent toutes les expériences qui
nous façonnent, le monde et moi, et que ces expériences,
toujours se modifiant, se combinant, retourneront, encapsulées
en « semences », tisser le flux immémorial de ma conscience
fondamentale.

5
Je dis « nous », je dis « moi », je pense à mes semblables et
moi. Le mot « moi » et l’idée que je me fais de ma personne,
l’idée que mes « semblables » se font de la leur, ce mot et ces
idées ont inspiré d’innombrables fictions dont la plupart nous
sont servies – et peu importe si parfois elles se contredisent
cruellement – comme la vérité, la seule et unique vérité vraie où
chacun doit trouver la bonne réponse à ses questions
existentielles, rehaussées ou non de doutes métaphysiques.
Bref, à part le « pyrrhonisme », l’être et le néant se sont
imposés à toutes les sagesses qui prétendent nous rassurer, nous
justifier, nous expliquer. Aussi rares sont les philosophies qui
ramènent le petit moi à son néant que sont nombreuses celles qui
l’exaltent et lui proposent de grandir, toujours grandir. Cette
dernière position présente toutefois un risque : plutôt qu’un
« grand moi », un moi sublime, le risque de se forger un grand
« petit moi », soit, en acte, un égoïsme énorme, monstrueux,
ravageur.
Certaines pensées morales ont inventé le renforcement du
moi, donc de l’égoïsme, par sa négation – l’abnégation –,
d’autres par son affirmation – la charité –, et d’autres encore par
un mélange des deux : l’illusion fusionnelle comme, par
exemple, la fusion du petit moi de l’homme et du grand moi de
Dieu dans l’expérience mystique romantique.
L’épanouissement personnel, les projets de vie, la réussite,
le sens de la vie et tous les « qui suis-je réellement ? » sont des
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
1
/
33
100%