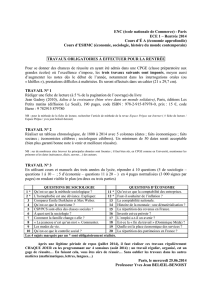À Michel Verret, mon directeur d`hier - TEL (thèses-en

3
UNIVERSITÉ DE NANTES
U.F.R. DE SOCIOLOGIE
Centre Nantais de Sociologie/Ecole Doctorale Droit et
Sciences sociales
Joël Guibert
Dossier de candidature pour
l’habilitation à diriger des recherches
À la recherche du temps libre
Tome 1 : Mémoire
Jury
Monsieur Salvatore Abbruzzese,
Professeur de Sociologie, Université de Trente
Madame Catherine Dutheil-Pessin,
Professeur de Sociologie, Université PMF, Grenoble II
Monsieur Ali El Kenz,
Professeur de Sociologie, Université de Nantes
Monsieur Claude Javeau,
Professeur émérite de Sociologie, Université Libre de Bruxelles
Monsieur Michel Messu,
Professeur de Sociologie, Université de Nantes
2009

4
À Michel Verret, mon directeur d’hier
À Ali El Kenz et Michel Messu, mes directeurs d’aujourd’hui

5
SOMMAIRE
CURRICULUM VITAE……………………………………………. page 6
MEMOIRE…………………………………………………………… page 17
Introduction…………………………………………………… page 18
I. Une trajectoire sous influences………………………… page 22
1. L’héritage
2. L’attrait du terrain
3. La vigilance méthodologique
4. La quête du populaire
II. Les loisirs en questions…………………………………… page 79
1. Le temps du loisir
2. Le temps de la fête
3. Le temps du jeu
III. La culture recomposée…………………………………… page 106
1. Les risques du métier
2. Le culturel en pratiques
3. La démarche comparative
Conclusion………………………………………………………. page 124

6
CURRICULUM VITAE
PARCOURS PROFESSIONNEL
1973-1982 : Surveillant de collège
1982-1987 : Chargé de cours dans l’enseignement supérieur
Chargé d’études sur contrats à durée déterminée
Depuis 1987 : Maître de Conférences Sociologie (Première classe en 1992)
* IUT de Rennes 1, Département des Carrières sociales (1987-1995)
* Université de Nantes, Département de Sociologie (depuis 1995 ; hors
classe en 2002)
RESPONSABILITÉS ADMINISTRATIVES
* Responsable des Relations internationales pour l’UFR de Sociologie, Université de Nantes
depuis 2002 ; membre nommé du Conseil Universitaire des Relations internationales (CURI)
2004-2008.
* Membre élu du Conseil de l’UFR Histoire/Sociologie 1997-2001 et de l’UFR Sociologie 2005-
2008.
* Membre des commissions de spécialistes (19e section), Angers-Le Mans, Nantes, Rennes 1989-
2002 ; Tours 2004.
* Directeur du Département de Sociologie de l’Université de Nantes (avec Christophe
Lamoureux), 1999-2001.
* Membre du Jury pour le concours des Conseillers territoriaux socio-éducatifs des Pays-de-la-
Loire organisé par le Centre de Gestion de la Fonction publique de La Roche-sur-Yon, 1997-
2001.
* Directeur du Département des Carrières Sociales, IUT de Rennes, 1989-1990 et 1992-1993 ;
Directeur adjoint du Département des Carrières Sociales, IUT de Rennes, 1991-1992.

7
TRAVAUX ET PUBLICATIONS
(en souligné, textes reproduits au moins partiellement dans tome 2)
Recherches universitaires
1978 : Maîtrise de Sociologie, Université de Nantes
(Le devenir social d’ouvriers sortis d’un hôpital psychiatrique
Direction Michel Verret, 160 pages, mention T.B.)
1982 : Doctorat de 3e cycle en Sociologie, Université de Nantes
(La vieillesse ouvrière – retraités du milieu nantais
Direction Michel Verret, 381 pages, mention T.B.)
Ouvrages
La vieillesse ouvrière, Les Cahiers du Lersco, n° 5, Nantes, 1983, 95 pages.
Joueurs de boules en pays nantais, édition L’Harmattan (collection Temps et Espaces du sport),
Paris, 1994, 233 pages.
Méthodologie des pratiques de terrain en sciences humaines et sociales (avec Guy Jumel),
édition Armand Colin, Paris, 1997, 219 pages.
La socio-histoire (avec Guy Jumel), édition Armand Colin, Paris, 2002, 192 pages.
Ouvrages collectifs
Les grands moments du sport (rubriques « 1894 : la naissance du sport-boules » et « 1895 : la
première assemblée de l’American Bowling Congress »), édition Larousse, Paris, 1997.
La Loire-Atlantique (chapitre Jeux et sports traditionnels), encyclopédie Bonneton, Paris, 1998.
Quels loisirs sportifs pour la société de demain ? (dir. avec Guy Jaouen), édition Institut Culturel
de Bretagne, Vannes, 2005.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
1
/
127
100%