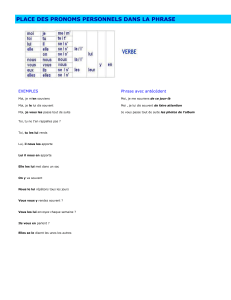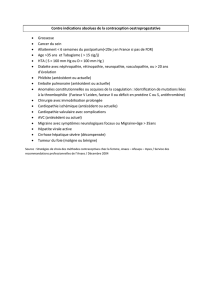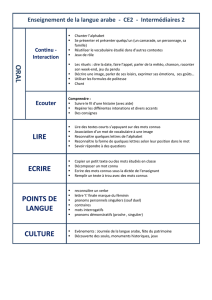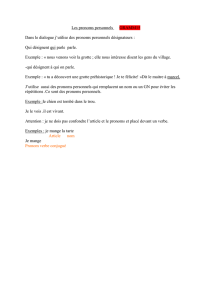LES SUBSTITUTS DU GN : LES PRONOMS

Envoyé par Christophe. LES SUBSTITUTS DU GN : LES PRONOMS
Les PN constituent une catégorie syntaxique relativement homogène, mais présentent des
propriétés sémantiques et des fonctionnements référentiels très diversifiés. Le terme de
« pronom » signifie « qui remplace un Nom » ; cette définition est doublement malheureuse
dans la mesure où les PN fonctionnent assez rarement comme l’équivalent d’1 nom isolé, et
bcp de PN ne « remplacent » strictement rien , mais désignent directement leur référent en
vertu de leur sens codé (« je » désigne la personne qui dit « je »).
Souvent équivalents à un GN, les PN peuvent néanmoins se comporter comme des
équivalents fonctionnels d’autres catégories grammaticales, ils peuvent en effet occuper la
place de :
GN ( pourvu d’1 ou plusieurs modificateurs) (les réponses sont toutes arrivées sauf
celle de Jean)
N avec ou sans modificateurs (j’ai oublié mon programme détaillé de la visite,
peux-tu me prêter le tien)
Adjectif (si tu es contente, je le suis aussi)
Gpe Prépositionnel (ou construction complétive ou infinitive précédée des
prépositions à ou de ) (il ressemble à son père, il lui ressemble. Pensez à réserver vos
places, pensez-s’y. J’ai le sentiment que les choses s’arrangent, j’en ai le sentiment)
Proposition (Pierre nous aidera je le sais)
Les PN peuvent donc avoir des fonctions différentes : - Sujet
- COD ou COI
- Attribut
- Cplt du N ou de l’Adj
- Cplt d’agent
- Cplt circonstanciel
D’un point de vue syntaxique, les PN se distinguent entre eux selon qu’ils ont
une forme simple ou complexe ( nous chacun plusieurs/ le mien celui-ci),
une ou plusieurs formes : (je j’ me m’ moi).
varient ou non en genre ou en nombre
peuvent être mis en correspondance avec des déterminants
morphologiquement et sémantiquement apparentés (ceci, ce, cette,ces)
admettent ou non des modificateurs
n’apparaissent que dans un type de phrase spécifique (PN interrogatifs et
négatifs)
combinent ou non leur statut de PN avec celui de marqueur de subordination
La sémantique des PN
Sémantiquement un PN se caractérise par la manière dont il réfère à ce qu’il désigne ds le
discours. On distingue trois modes différents de référence :
référence déictique : référent du PN est identifié plus ou moins directement à partir de
l’énonciation même de cette forme .

référence anaphorique : lorsque l’identification du référent du PN nécessite le recours
à l’environnement contextuel. Le cas typique est celui où le PN reprend intégralement les
valeurs référentielles de son antécédent ; le PN et son antécédent sont alors coréférents.
L’anaphore pronominale peut être une représentation totale ou une représentation
partielle.
référence par défaut : lorsque ni le contexte linguistique ni la situation d ‘énonciation
immédiate n’offrent la moindre information pertinente susceptible de substituer une
constante référentielle à la variable contenue dans le sens pronominal.
En général c’est l’interprétation générique qui s’impose.
Les PN personnels
La catégorie des PN dits personnels regroupe 2 types d’éléments monosyllabiques au
fonctionnement radicalement différent :
je tu nous vous et on sont ds PN sans antécédent dont le référent est identifié à
partir de la situation de discours où ils st employés
il et ses variantes allomorphiques sont fort mal à propos appelés « personnels » :
non seulement ils servent à désigner n’importe quel objet de pensée, mais
lorsqu’ils désignent une personne, celle-ci est généralement une « non personne » ,
c ‘est à dire n’est pas un protagoniste de l’acte d’énonciation.
Sauf nous, vous et on qui sont invariables, les autres PN personnels présentent tous plusieurs
formes : on distingue ainsi les formes conjointes et les formes disjointes, les formes conjointes
entre elles selon leur fonction, formes propres aux emplois réfléchis et les formes
indifférenciées.
Les formes conjointes sont généralement antéposées au verbe dont elle ne peuvent être
séparées que par une autre forme conjointe et par le premier élément de la négation.
Les formes disjointes ont un comportement syntaxique analogue à celui d’un groupe nominal
séparé du verbe( par une préposition, une pause…)
Les pronoms possessifs
Sont formés de l’article défini suivi de l’une des formes de l’adjectif mien, tien … qui
exprime une relation sémantique variable avec la personne correspondante. Il reprennent la
substance notionnelle d’un N antécédent ou inférable situationnellement , mais lui associent
de nouvelles déterminations véhiculées par l’article et par la personne associée à la forme
adjectivale.
Les pronoms démonstratifs
Se répartissent en une série simple et une série composée (élargie par les adv de lieu ci et là)
Les formes variables en genre et en nombre s’opposent aux formes neutres ce ça ceci cela
qui ne se rencontrent qu’au singulier.
Les formes simples masc ou féminines , sont des symboles incomplets qui reprennent le
contenu lexical et le genre d’un N antécédent, mais en modifient le nombre et les
déterminations à de nouvelles fins référentielles. Aussi sont-elles toujours déterminées par un
modificateur qui prend la forme :
- d’une proposition relative (j’ai examiné tous les livres mais je n’ai pas
trouvé celui que je cherchais)
- d’un cplt prépositionnel (voici mon passeport et ceux de mes passagers)

- d’un participe avec sa complémentation (les meilleurs de ses livres sont
ceux écrits avant 1910/ ceux relatant ses campagnes militaires)
elles servent aussi d’antécédent « support animé » aux relatives périphrastiques ( que celui qui
n’a jamais péché lui jette la première pierre)
forme neutre atone ce s’emploie d’une part comme sujet clitique du verbe être,
éventuellement modalisé par pouvoir ou devoir ( c’est gentil, ce devrait être facile), mais a
progressivement été remplacée par cela, puis par ça Elle joue également le rôle d’antécédent
« support non-animé » d’une relative ou d’une subordonnée interrogative portant sur le COD (
ce qui se conçoit bien s’énonce clairement / dis-moi ce qu’il a encore fait)
formes composées variables celui-ci… tjs employées sans modificateurs, véhiculent les
mêmes valeurs déictiques et anaphoriques que le déterminant démonstratif. Elles peuvent
prélever 1 ou plusieurs référents sur l’ensemble dénoté par le GN antécédent ou désigner de
nouveaux référents à partir du contenu notionnel d’un N antécédent ( vos livres ne sont pas
chers, je prends celui-ci/ Pour le prix de ce seul livre je peux acheter tous ceux-là). En emploi
déictique elles désignent un référent accessible à partir de la situation de discours.
Formes composées neutres ceci, cela et ça servent à désigner déictiquement des référents
non catégorisés, voire à décatégoriser péjorativement un référent en lui refusant sa
dénomination usuelle. Elles anaphorisent aussi les antécédents dépourvus de genre et de
nombre que sont les propositions ( tu terminera tes devoirs, après ça tu pourras regarder la
télévision).
Enfin, en alternance avec ce , elles reprennent un antécédent (svt générique) dont elles
neutralisent le genre et le nombre (les enfants, ça fait du bruit)
Les pronoms interrogatifs
« Symboles incomplets » au contenu lexical réduit à la notion de personne ou de chose et dont
le sens consiste à demander l’identification du ou des référents vérifiants et ces notions
générales et ce qu’en dit le reste de la phrase interrogative. Ce sont les PN qui introduisent les
phrases interrogatives directes, et les subordonnées interrogatives
les formes simples servent à interroger sur l’identité supposée inconnue de leur référent ;
ainsi, elles ne sont jms marquées en genre ou en nombre.
Chacune des formes simples est doublée d’une forme renforcée qui lui ajoute l’élément est-
ce qui / est ce que
Formes composées sont les mêmes que celles du PN relatif, elles sont formées de l’article
défini et du déterminant interrogatif quel. Elles sont variables en genre et en nombre, se
contractent avec les prépositions à et de
Les pronoms relatifs
Introducteurs de propositions relatives
Formes simples ne marquent ni l’opposition du genre ni celle du nombre
Formes composées lequel, laquelle, lesquels, duquel, desquels, auquel…sont les mêmes que
celles des pronoms interrogatifs.

Relatifs sans antécédents (obligatoirement simples) s’apparentent à des PN indéfinis (qui
vivra verra)
Les pronoms indéfinis
Regroupent des pronoms dt la plupart sont homonymes d’1 déterminant dt ils partagent les
valeurs quantificatrices (tout, toute, tous, nul, aucun, plusieurs, certain, beaucoup, peu…)l’un,
les uns, quelqu’un, quelques uns, quelque chose.
Les quantificateurs
Déterminants numéraux cardinaux utilisés comme pronoms pour indiquer la quantité
dénombrée (j’ai de nombreux amis, j’en ai invité cinq)
Aucun, nul, pas un, personne, rien sont des indicateurs de quantification nulle
Un certain nombre de PN renvient à des totalités :
- tous, toutes / tout marquent la totalité globalisante
- chacun marque la totalité distributive
les PN qq’1, qq chose, n’importe qui/quoi, n’importe lequel fonctionnent comme des
indicateurs de singularité indéterminée
certains, quelques uns, la plupart, plusieurs indiquent une pluralité indéterminée
Les identificateurs
Formés par nominalisation des adj même et autre qui indiquent respectivement l’identité et la
différence
PLAN
1) Référence anaphorique
a) PN personnels
- formes conjointes
- formes disjointes
b) PN possessifs
c) PN démonstratifs
- formes simples
- formes composées
d) PN interrogatifs
- formes simples
- formes composées
e) PN relatifs
- formes simples
- formes composées
f) PN indéfinis
- Quantificateurs ( …)
- Identificateurs (…)
2) Référence déictique
(…)
3) Référence par défaut
(…)
1
/
4
100%