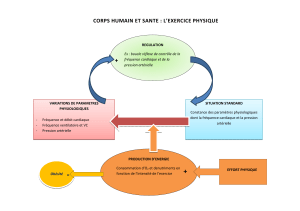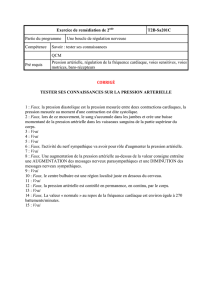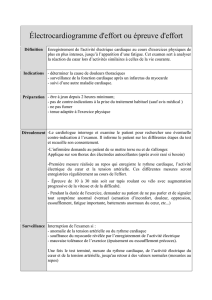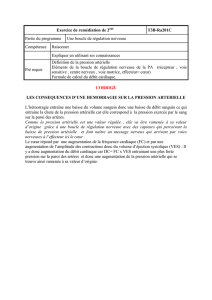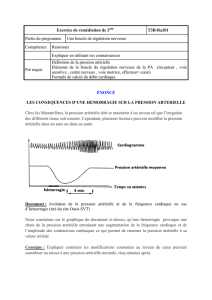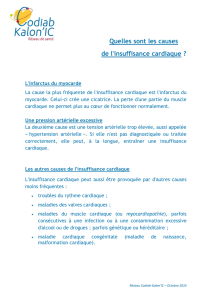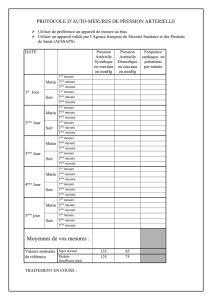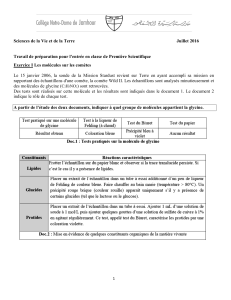Chaput Maïté

Chaput Maïté
Pression artérielle et hypertension
I / Définition de la pression artérielle et Mesure
A / Définition
La pression artérielle correspond à la pression du sang dans les artères. On parle
aussi de tension artérielle car cette pression est aussi la force exercée par le sang sur la paroi
de ces artères. La pression artérielle est souvent mesurée cm de mercure voire en mm de
mercure.
B / Pression systolique et pression diastolique
Elle est exprimée par deux mesures :
La pression maximale au moment de la contraction du cœur = systole
La pression minimale au moment du relâchement du cœur = diastole
La pression systolique : C’est la pression artérielle maximale au sommet de la phase
d’éjection systolique ( Valeur normale = 120 mmHg)
La pression diastolique : C’est la pression artérielle minimale durant la systole
cardiaque avant l’ouverture des valvules aortiques. (Valeur normale = 80 mmHg)
La pression moyenne : C’est la pression moyenne au cours du cycle cardiaque, elle
est supérieure d’environ 25% à la pression diastolique.
Lorsque le ventricule gauche se contracte et éjecte le sang sous pression dans
l’aorte:
- le sang produit une onde de pression dans toutes les artères : c’est le pouls qui est un
indicateur du rythme cardiaque. La mesure de la pression artérielle repose sur le même
principe.
- la pression mesurée au niveau des bras. La pression systolique correspond à la pression
maximale exercée par le ventricule gauche
Lorsque le ventricule gauche s’est vidé, la pression aortique n’y est pas nulle grâce à
l’action des valves aortiques qui empêchent le sang de refluer dans le ventricule : c’est la
pression diastolique, c’est-à-dire la pression qui règne dans l’aorte lorsque le ventricule
gauche est au repos.
C/ Calcul de la PAM
Si on exprime la tension sous la forme d’un seul chiffre, sans unité, il s’agit alors de
la pression artérielle moyenne notée PAM exprimée en cm de mercure. Celle- ci se calcule
de la manière suivante :
PAM = Pression diastolique + (Pression systolique-Pression diastolique)/3
Pression systolique-Pression diastolique = Pression différentielle
D / Mesure
On mesure la pression artérielle au niveau de l’artère humérale à l’aide d’un
tensiomètre = sphygmomanomètre et d’un stéthoscope. Un brassard est placé autour du
bras, au dessus du coude. Il est relié à une pompe qui permet de régler la pression en
gonflant ou en dégonflant le brassard et d’un manomètre qui indique la pression. Pour
commencer le brassard est gonflé à une pression supérieure à la pression artérielle
maximale. L’artère est comprimée et le sang ne passe plus. On décomprime ensuite l’artère
progressivement, en dégonflant le brassard. Lorsque le sang commence à passer,

l’écoulement est turbulent et donc bruyant. Le premier bruit perçu (=bruit de Korotkoff)
correspond à la pression maximale ou pression systolique. On continue à décomprimer
l’artère jusqu’à un écoulement laminaire et silencieux du sang. La disparition du dernier
bruit correspond à la pression minimale ou diastolique.
La différence entre la pression systolique et la pression diastolique est la pression
différentielle ou pression pulsée. A chaque contraction cardiaque, la pression du sang
distend de façon temporaire la paroi artérielle. On sent ce battement sur les grosses artères
superficielles : c’est le pouls.
E / Pression artérielle et résistances périphériques
Pour qu’un liquide s ‘écoule le long d’un tuyau, il doit exister un gradient de pression
entre les deux extrémités de ce tuyau. L’importance de ce gradient de pression P est égal
au produit du débit Q par la résistance au flux R.
En appliquant cette formule à la circulation systémique, P est le gradient de
pression entre l’aorte et l’oreillette droite. La pression auriculaire (1 mmHg) étant
négligeable par rapport à la pression artérielle (normalement 120/80 mmHg), P est en fait
égal à la pression artérielle. Le débit sanguin total à travers la circulation systémique, c’est-à-
dire le débit cardiaque noté Q. On a donc :
Pression artérielle P = Débit cardiaque Q * Résistances périphériques R où les résistances
périphériques R sont la résistance totale au débit sanguin dans la circulation systémique.
II / Régulation de la pression artérielle
La pression artérielle (notée PA) est égale au débit cardiaque Q multiplié par les
résistances périphériques R. C’est pourquoi, la pression artérielle peut-être contrôlée par
des mécanismes qui modifient soit le débit cardiaque, soit les résistances périphériques. Ces
dernières sont déterminées par des modifications de la constriction artériolaire. Les
modifications du débit cardiaque peuvent être secondaires à des modifications de la
fonction cardiaque ou du retour veineux. Ce dernier dépend fréquemment du volume
sanguin puisque leur modifications sont parallèles.
Les mécanismes de régulation peuvent agir rapidement, dans le but de contrôler à
court terme, minute après minute, la pression artérielle, ou à plus long terme, réglant la
pression artérielle moyenne de semaine en semaine.
A / Le contrôle nerveux de la pression artérielle
Le contrôle à court terme de la pression artérielle dépend de phénomènes réflexes qui
détectent ses variations et y répondent en quelques secondes. La portion efférente, motrice,
de ce réflexe fait intervenir des nerfs végétatifs régulés par des centres du bulbe rachidien.
1. Centre vasomoteur
Le centre vasomoteur active des nerfs sympathiques qui augmentent la pression
artérielle par différents mécanismes.
Les nerfs sympathiques destinés au cœur augmente la fréquence cardiaque et la
contractilité, et donc le débit cardiaque.
Les nerfs sympathiques destinés aux artérioles sécrètent de la noradrénaline qui
provoque une vasoconstriction des paroi des artérioles. Cette vasoconstriction augmente la

résistance périphérique. (Un effet secondaire de la vasoconstriction est la diminution de la
pression hydrostatique capillaire. Les liquides tendent alors à être absorbés de l’espace
interstitiel dans la circulation ce qui augmente le volume sanguin circulant et donc le retour
veineux).
Les nerfs sympathiques destinés aux veinules et veines provoquent leur constriction.
La veinoconstriction a peu d’effet sur les résistances périphériques mais augment
directement le retour veineux, et donc le débit cardiaque.
2. Centre cardio-inhibiteur
Il active les nerfs parasympathiques qui ralentissent le cœur, diminuant ainsi le débit
cardiaque et la pression artérielle. On ne compte que très peu de nerfs parasympathiques
destinés aux vaisseaux sanguins, et ils exercent donc des effets minimes sur les résistances
périphériques ou le retour veineux.
3. Régulation réflexe de l’activité végétative
L’activité des nerfs sympathiques et parasympathiques est modulée par plusieurs
récepteurs et réflexes cardiovasculaires importants.
a. Réflexes barorécepteurs
La condition essentielle à une régulation de la pression artérielle est que le corps
puisse mesurer lui-même la pression dans les vaisseaux. Dans l’aorte, les carotides et les
grosses artères du thorax et du cou, des cellules sensorielles sensibles à la pression, les
barorécepteurs mesurent la tension de la paroi artérielle. Ils transmettent la valeur de la
pression artérielle au centre vasomoteur cérébral par l’intermédiaire du nerf vague et du
nerf glossopharyngien.
Si une pression élevée met sous tension la paroi, les barorécepteurs envoient des
influx en plus grand nombre au niveau du bulbe rachidien dans le cerveau. Cela aura pour
conséquence une inhibition du tonus sympathique vers le système cardiovasculaire, avec
une diminution du débit cardiaque et des résistances périphériques ainsi qu’une stimulation
des nerfs parasympathiques ce qui provoque également une diminution du débit cardiaque.
Tous ces effets tendent à diminuer la pression artérielle.
Pour des valeurs plus faibles, le nombre d’influx diminuent ce qui aura les
conséquences inverses pour ramener la pression artérielle a une valeur normale.
Les réponses des barorécepteurs sont très rapides apparaissant en quelques secondes
pour compenser toute modification brutale de la pression artérielle, comme lorsqu’on passe
en position debout, afin d’éviter la chute de pression artérielle.
b. Les réflexes des récepteurs volumétriques (volorécepteurs) à faible

pression
Ce sont des récepteurs au même titre que les barorécepteurs que l’on trouve dans les
parois des grosses veines, des oreillettes et du tronc pulmonaire. On les appelle parfois les
volorécepteurs cardio-pulmonaires qui sont surtout sensibles aux variations du volume
sanguin circulant.
Une augmentation du volume sanguin étire les parois de l’oreillette et des vaisseaux
pulmonaires, stimulant les volorécepteurs. Cela tend à faire diminuer la pression artérielle
par deux mécanismes :
L’activité nerveuse sympathique vasoconstrictrice est réduite, et donc les résistances
périphériques.
La libération de l’hormone antidiurétique = ADH également appelée vasopressine
est inhibée. (Elle est libérée à partir de la post-hypophyse). L’ADH provoque une
vasoconstriction mais stimule également l’absorption d’eau au niveau des canaux
collecteurs rénaux, ce qui augmente le volume sanguin. L’inhibition de la libération de cette
hormone induite par les volorécepteurs diminuent donc le volume sanguin, ce qui va
diminuer à la fois les résistances périphériques et le débit cardiaque.
c. Les réflexes chémorécepteurs
On trouve des chémorécepteurs périphériques dans les corps carotidiens et
aortiques. Ils sont sensibles aux modifications des concentrations tissulaires d’O2. (Leur
principal rôle est la régulation de la ventilation.) Si la pression artérielle est très basse, la
concentration tissulaire d’O2 peut chuter même quand la concentration artérielle d’O2 est
normale du simple fait que le débit sanguin devient insuffisant pour couvrir les besoins
métaboliques des cellules chémoréceptrices. Il y a alors activation des récepteurs, ce qui
stimule les nerfs vasoconstricteurs sympathiques pour tenter de restaurer la pression
artérielle.
d. Réponse à l’ischémie cérébrale
A de très faibles niveaux de pression artérielle, le débit sanguin au cerveau ne suffit
plus à couvrir ses besoins métaboliques. Il en résulte une accumulation de CO2 et de H+
dans le tissu cérébral, réalisant un stimulus extrêmement puissant du centre vasomoteur du
bulbe rachidien, avec activation majeure de l’innervation sympathique de l’appareil
cardiovasculaire.
B. Contrôle hormonal de la pression artérielle
Plusieurs hormones interviennent dans la régulation de la pression artérielle. Elles
peuvent agir relativement rapidement (quelques minutes) ou n’exercer leur pleine action
qu’en quelques heures ou quelques jours.
1. Catécholamines
Les catécholamines sont des composés organiques synthétisés à partir de la tyrosine
et jouant le rôle d’hormone ou de neurotransmetteur. Les catécholamines les plus courantes
sont l’adrénaline et la noradrénaline. Elles sont synthétisées par les cellules de la
médullosurrénale. Ces hormones agissent en quelques minutes et provoquent une
vasoconstriction et une augmentation de la fréquence et de la contractilité cardiaques.
2. Hormone antidiurétique = ADH = Vasopressine
On a déjà parlé de cette hormone avec les volorécepteurs. Les effets
vasoconstricteurs de cette hormone apparaissent en quelques minutes, alors que la
réabsorption rénale d’eau et l’expansion du volume sanguin qui en résulte sont plus
retardés.

3. Système Rénine angiotensine aldostérone
Les diminutions de la pression artérielle sont responsables de baisses du débit sanguin
rénal qui sont détectées par l’appareil juxta glomérulaire de chaque néphron. Le néphron
répond en sécrétant la rénine, enzyme protéolytique qui convertit l’angiotensinase
(précurseur peptidique inactif) en angiotensine I. La convertase va à son tour transformer
cette dernière en angiotensine II qui est un vasoconstricteur qui augmente les résistances
périphériques. Ceci provoque également la sécrétion d’aldostérone (hormone stéroïdienne)
qui augmente la réabsorption rénale de sodium et d’eau dans le tube contourné distal, ce
qui induit une augmentation du volume sanguin et donc une augmentation de la pression
artérielle.
C. Régulation à long terme de la pression artérielle.
On connaît mal le mécanisme par lequel la pression artérielle moyenne est maintenue
constante pendant des semaines à des années chez le sujet normal. Un des éléments du
contrôle est la régulation à long terme du volume sanguin qui contribue au maintien du
retour veineux et du débit cardiaque à un niveau constant. Plusieurs mécanismes rénaux
interviennent, dont plusieurs sont sous contrôle hormonal.
Les variations de la pression artérielle peuvent induire des modifications minimes
mais significatives du débit sanguin rénal et de la filtration glomérulaire. Une chute de la
pression artérielle par exemple diminue l’excrétion du sodium et de l’eau, ce qui contribue à
augmenter le volume sanguin et la pression artérielle.
L’ADH stimule la réabsorption rénale d’eau quand le volume sanguin diminue.
L’aldostérone stimule la réabsorption rénale d’eau et de sodium quand la pression
artérielle diminue
La régulation à long terme des résistances périphériques est très mal connue.
D. Conclusion
La pression artérielle est donc régulée principalement à deux niveaux : au niveau
hormonal et au niveau nerveux. Qu’il s’agisse d’hormones, de nerfs sympathiques ou
parasympathiques, ces mécanismes joueront un rôle sur les résistances périphériques et sur
le débit cardiaque, les deux facteurs qui donnent la pression artérielle.
1
/
5
100%