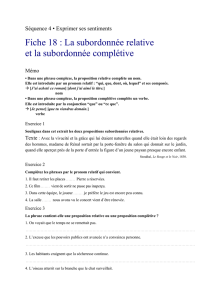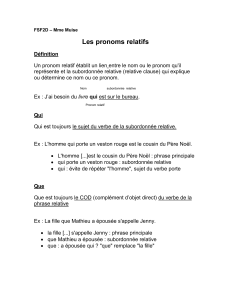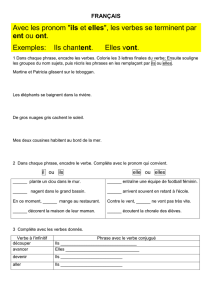доцент кафедри французької мови М. Д. Гулей (ДонНУ)

1
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
Української державної академії
залізничного транспорту
ФАКУЛЬТЕТ „ЕКОНОМІКА ТРАНСПОРТУ”
Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін
С.В.Довженко
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до опорних конспектів з граматики французької мови
для студентів 2 курсу заочної форми навчання
для спеціальностей
ЗС, ОПУТ, АТ, Л, МО, ОА, ЕП.
Донецьк 2012

2
Методичні вказівки розглянуті та затверджені на засіданні
кафедри “Соціально-гуманітарних дисциплін” 10.10.2012 року,
протокол № 2.
Рекомендовано до друку на засіданні методичної комісії
факультету «Економіка підприємства» 04.12.2012року.
Протокол № 3.
Укладач:
ст. викладач С. В. Довженко
Рецензенти:
доцент кафедри французької мови М. Д. Гулей
(ДонНУ)
старший викладач кафедри СГД С. С. Гордіна
(ДонІЗТ)

3
ПЕРЕДМОВА
Рецензовані «Методичні вказівки та завдання до опорних
конспектів з граматики французької мови для студентів 2 курсу
заочної форми навчання для спеціальностей ЗС, ОПУТ, АТ, Л,
МО, ОА, ЕП укладено за навчальною програмою курсу:
„Французька мова”.
Методична розробка призначена для студентів заочної
форми навчання всіх спеціальностей, які вивчають французьку
мову в Донецькому інституті залізничного транспорту.
Метою «Методичних вказівок» є допомогти студентам у
самостійній роботі над граматичним матеріалом, який включає
опрацювання таких тем, як: просте та складне речення,
дієприкметникові звороти, Subjonctif та його вживання в
складних реченнях, тощо.
Методичні вказівки містять вправи на закріплення поданого
граматичного матеріалу та додаткові тексти для домашнього
читання.

4
Syntaxe de la phrase simple
La proposition simple à deux termes essentiels.
Termes essentiels de la proposition
§ 1. Le sujet. 1°. Selon la présentation du sujet on peut
distinguer:
a) des propositions personnelles, où le sujet est l'être ou la
chose dont on dit l'existence ou l'action, l'état, la manière d'être, la
qualité; ce sujet répond à la question qui est-ce qui? (personnes) ou
qu'est-ce qui? (choses);
b) des propositions impersonnelles, où le sujet, représenté
généralement par il impersonnel, est purement grammatical et ne
désigne aucun être, aucune chose, par exemple: Il pleut. Il fait
sombre. Il est trois heures. II a fait de l'orage cette nuit, il tonnait
assez fort. (Rolland)
Par leur forme, ce sont des propositions à deux termes
essentiels, mais certains grammairiens n'y voient qu'un seul terme, il
n'étant, au fond, qu'une particule formelle, un sujet «apparent» et
illusoire. Pourtant, c'est lui qui, selon le mot de Vaugelas, «donne la
loi au verbe», car le verbe se met à la 3e personne du singulier.
Fort répandues sont en français — et surtout dans la langue
moderne, — des propositions où le verbe (toujours intransitif) est
précédé du sujet «apparent», impersonnel avec lequel il s'accorde, et
suivi d'un «sujet réel», ' répondant à la question qui? qu'est-ce qui?,
par ex. :
II nous arrive un accident. II est venu du monde.
Il parut sur le seuil une femme poussant devant elle une petite
fille. (Concourt))
... il continuait à flotter sur toute la colline, ses jardins
et les trois maisons, un inexplicable silence. (Bosco)
Elle ajouta même: «II pleut!» [...] C'était vrai, d'ailleurs: il
volait des gouttes. (Bazin)
Ces propositions sont donc une variété de propositions
personnelles.
2. Le sujet d'une proposition personnelle peut être exprimé par
un seul mot ou par un groupe de mots; il peut être développé au
moyen de compléments, avec lesquels il constitue le groupe du sujet.

5
Cinq à six beaux chênes verts [...] s'élevaient sur les
bords. (Mérimée)
Un grand nombre d'images vinrent alors s'offrir à M.
Quesdon. (Perret)
Diverses parties du discours peuvent faire fonction de sujet:
a) un nom (précédé généralement d'un article ou d'un adjectif
déterminatif;2)
b) des pronoms de toutes les espèces (personnels;
démonstratifs, appuyés toujours sur les particules -ci ou -là ou sur un
complément déterminatif; possessifs; interrogatiîs; indéfinis; les
relatifs qui, lequel).
Lui est électricien, et elle dactylo. (Chabrol)
Celui qui vous parle est un paisible citoyen. (France)
Cela m'annonçait le voisinage d'une source. (Mérimée)
Tout dormait dans les champs. (Rolland)
Un autre l'observait: c'était le père de Lorchen. (Rolland)
c) un nom de nombre ou un adjectif numéral ordinal:
Trois étaient sérieusement atteints. (Rolland)
Le troisième était immobile et rigide comme un mort. (Rolland)
d) un adverbe de quantité employé comme nominal:
Beaucoup venaient la consulter. (Daudet)
bien peu ont assez de souffle pour continuer leur route.
e) un mot quelconque ou tout un groupe de mots pris sub-
stantivement et ayant l'article (ou un autre déterminatif) ou rarement,
sans article:
Le plus dur n'était point passé. (Rolland)
Les «Pourquoi» et les «Parce que» se balançaient toujours.
(Maupassant)
Un «tiens» vaut mieux que deux «tu l'auras». (Proverbe)
î) un infinitif (sans préposition, ou précédé de de dans le cas où
la phrase comporte une nuance causale, et souvent repris par le
pronom ce:
Se battre était son sport préféré. (Vaillant-Couturier)
Mais se lamenter n'apportait pas de solution. (Dorgelès)
D'avoir à prendre seul la décision lui donnait un afflux de
force. (Martin du Gard)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
1
/
26
100%