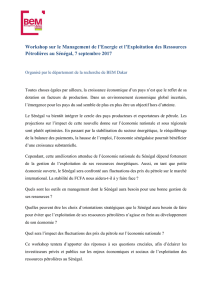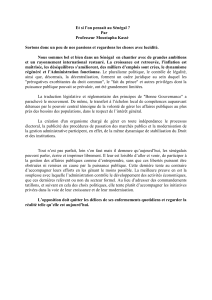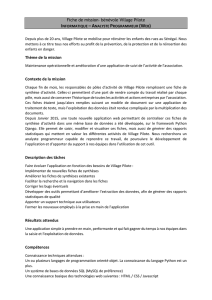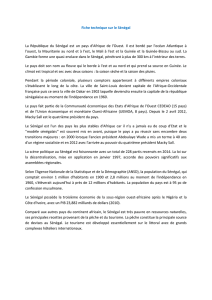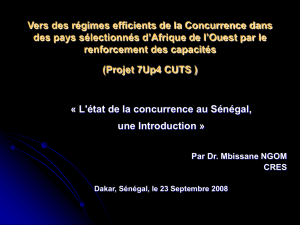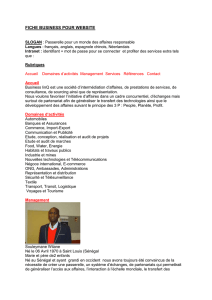PND 2015 - Professeur Moustapha Kassé

1
Université Cheikh Anta DIOP
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion
Dakar
POLITIQUE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT
Professeur Moustapha Kassé
Doyen Honoraire
Officier des Palmes académiques
Officier de l’Ordre National
Membre des Académies
www.mkasse.com
4ème Année de Sciences Economiques
Année universitaire 2015/2016

2

3
CHAPITRE INTRODUCTIF :
L’évolution de l’économie sénégalaise sur un demi-
siècle.
Dans la déclaration d’Arusha en 1967, le Président Julius K.NYERERE a eu à
souligner les points suivants :
Suivre la voie du socialisme enraciné dans la société africaine traditionnelle et son
esprit communautaire ;
Amener le peuple à compter sur lui-même et sur son travail (le travail considéré
comme la racine du développement) ;
Construire un développement qui assure l’égalité entre les citoyens ;
Ne pas attendre l’argent des autres
Prendre l’agriculture comme base du développement
« Tout le monde désire le développement ; mais ce n’est pas tout le monde qui
comprend et accepte les conditions fondamentales du développement. La plus importante de
ces conditions est l’ardeur au travail. Nous devrions aller parler à nos populations dans les
villages pour essayer de les amener à travailler davantage… Nous rendrions un très grand
service à notre pays si nous allions dans les villages dire aux gens qu’ils possèdent ce trésor et
qu’il dépend d’eux de s’en servir pour leur bénéfice propre et pour le bénéfice de notre nation
toute entière… L’argent et le temps que nous dépensons à communiquer ces connaissances
aux paysans sont mieux employés et rapportent davantage à notre pays que l’argent et le
temps que nous consacrons à quantité d’autres choses que nous appelons développement ».
Au moment des indépendances africaines, en 1960, les visions et les stratégies
se réclamaient d’une «voie africaine du socialisme.» présentée comme une alternative à
la fois au capitalisme libéral et au socialisme marxiste. Les ressources humaines
nationales étaient peu nombreuses et les infrastructures de base nettement
insuffisantes. Devant l’immensité des tâches de construction d’une nation jeune et
nouvellement indépendante, et tenant compte de l’absence d’un véritable secteur privé
national capable de saisir toutes les opportunités d’investissement, l’État sénégalais
décida de prendre en charge la promotion du développement, occupant progressivement
une position stratégique dominante dans tous les secteurs de l’économie nationale avec
un contrôle direct des secteurs stratégiques par mise en place de monopoles publics.
C’était le départ de la mise en place de toutes les institutions de «l’État développeur.»
1
Cette stratégie de développement visait notamment à transformer profondément
les systèmes productifs et les appareils administratifs hérités de la colonisation et devrait
conduire à la mise en place, au plan de l’équipement et de l’infrastructure sociale, de
larges programmes d’investissement qui se sont révélés, par la suite, massifs, parfois
peu réalistes et d’une faible efficacité. Dans le même temps, la grave rupture survenue
1
Disons plutôt que la bourgeoisie commerçante sénégalaise a subi un long processus de liquidation à partir de
1900 au point d’être réduite à la veille de la seconde guerre mondiale à des rôles secondaires. Ce fut d’abord le
crash du commerce de la gomme au début du siècle puis l’installation des comptoirs des grandes maisons de
commerce coloniales bordelaises et marseillaises, à partir des années 20 l’avalanche des libano-syriens et enfin
la crise des années 30. Voir à ce sujet Aamir Amin : Le monde des affaires sénégalais .Les Editions de Minuit,
180 pages

4
entre les structures de production – alimentaires en l’occurrence – et les structures de
consommation, a fondamentalement contribué à opérer une double extraversion : celle
de la production et celle de la consommation. Il en est résulté un approfondissement du
déséquilibre entre la production intérieure et la demande globale au sein de laquelle
prédominait une consommation finale excessive et, conséquemment, un accroissement
du déficit en ressources. Celui-ci était artificiellement entretenu et financé par l’aide
publique et l’endettement extérieur.
Le boom pétrolier des années 70 avait favorisé des emprunts publics à des taux
relativement faibles. A la faveur de l'augmentation de la dette publique des Etats dans
les années 1980, les marchés financiers sont arrivés aux commandes. Cela s'est traduit
par une augmentation des taux d'intérêt, dont le niveau a dépassé non seulement
l'inflation, mais la croissance. Les Etats qui avaient un fort niveau d'endettement sans
être producteurs de pétrole ont alors eu de plus en plus de mal à clore leurs exercices
budgétaires. Il a fallu emprunter, pour rembourser les emprunts passés, à des taux qui
promettaient d'engendrer de nouvelles difficultés. Faute de remèdes radicaux, cette
situation vouait irrémédiablement le pays à des crises qui bloqueraient la croissance et le
développement. S’y ajoutait dans le cas du Sénégal, une énorme distorsion entre
l’affectation théorique et l’utilisation effective de la dette extérieure qui n’a pas favorisé la
création de conditions adéquates de formation et d’extension de surplus nécessaires à
l’amortissement régulier du service de la dette (principal et intérêts échus). Assurément,
cette situation risquait de constituer le fondement d’une crise de paiements dont la
perpétuation, si rien n’était entrepris, pouvait déboucher sur une crise sérieuse de
solvabilité. La cessation de paiements se traduirait alors par un retrait des financements
extérieurs et un effondrement des importations qui aurait des incidences sur la
production par le biais des nombreux secteurs qui recourent à des biens d'équipement
importés.
Pourtant, en 1960, le Sénégal était le pays le plus industrialisé et le mieux doté en
infrastructure d’Afrique noire francophone. Le pays a joui, au plan interne, d’une relative
stabilité politique. Malgré ces conditions favorables au développement, les performances
économiques et sociales ont été bien médiocres et sur une longue période, de 1960 à
2012, la croissance économique annuelle moyenne n’a été que de 2,9 % ce qui
équivaut, par moment à peine, au croît démographique qui a évolué entre 3,4 à 2,6% et
dans le même temps, le taux de croissance par tête d’habitant n’a que rarement dépassé
1%. De 615$ en 1960 (en dollar constant de 2000), il est retombé à 560$ en 2010.
Taux de croissance moyen du Sénégal de 1960-2000 (%)
Année
1960-1969
1970-1979
1980-1984
1985-1993
1994-2000
Indicateurs
PIB
2,2
3,0
1,8
2,2
4,9
PIB/tête
-0,5
0,3
-0,9
-0,4
2,1
Cependant, en 1960, le PIB par habitant du Sénégal dépassait celui de la plupart
des pays d’Afrique et même d’Asie de l’Est comme la Corée du Sud. Ce pays par les

5
réformes et l’ouverture opérées à partir des années 1970 lui ont permis, en 2010, d’être
une grande puissance industrielle et d’avoir un PIB plus de 20 fois supérieur à celui du
Sénégal
2
Cette période marque le début, au Sénégal, de la mise en œuvre de
l’ajustement structurel avec une politique de stabilisation en 1978, la mise en œuvre du
Plan de Redressement Economique et Financier (PREF). Un programme d'ajustement
structurel à moyen et long terme (PAMLT) de 1985 à 1992.
Tout au long du demi-siècle (1960 à 2012), l’économie sénégalaise n’a jamais été
une économie de forte croissance avec une évolution contrastée comme le montre le
schéma de croissance du PIB.
Cette évolution erratique de la croissance avec une phase enclenchée à partir de
la fin des années 70 se caractérisant par la stagnation de la production nationale, la
dégradation des équilibres financiers internes et la montée de l'endettement extérieur
trois années. Elle sera suivie par une phase un peu plus favorable mais de courte durée
ce qui apparait dans cette évolution de la croissance annuelle du PIB est la suivante
3
:
Définition. Le Produit intérieur brut (PIB) est l'indicateur le plus retenu pour évaluer la production de biens et
services d'un pays pendant une année. Il illustre l'importance de l'activité économique d'un pays ou encore la
grandeur de sa richesse générée. Quand il est formulé en dollars constants, comme c'est ici le cas, on peut
procéder plus adéquatement à des comparaisons à travers les années puisqu'on tient alors compte de
l'inflation ou de la déflation. Cette information est une somme qui ne tient pas compte du nombre d'habitants
du pays. Dans certains cas, il sera utile d'examiner le même indicateur «par habitant». Enfin, pour des
comparaisons internationales plus adéquates on doit examiner les données formulées en PPA (parité pouvoir
d'achat). Pour mieux comprendre les possibilités de cet indicateur économique, consulter notre outil sur les
composantes du PIB: PIB des États-Unis. Source: La Banque Mondiale
2
3
Définition. La croissance annuelle du Produit intérieur brut (PIB) en % représente la variation relative d'une
période à une autre du volume du PIB en dollars constants d'une année de référence. Elle reflète
l'augmentation (ou la baisse dans le cas d'une croissance négative) du niveau d'activité économique dans un
pays. Il s'agit d'un indicateur souvent retenu lorsque l'on veut faire des prévisions à court et à moyen terme sur
la situation économique d'un pays. Normalement, une croissance économique équivaut à un enrichissement.
Cependant, cet indicateur pourrait s'avérer trompeur dans la mesure où la croissance du PIB serait redevable
d'une croissance démographique et non d'une amélioration de l'économie. Il importe alors de considérer la
croissance du PIB par habitant.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%