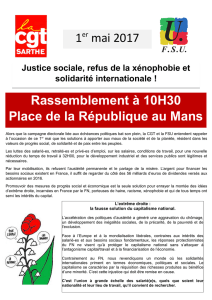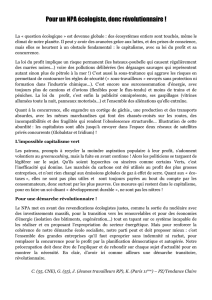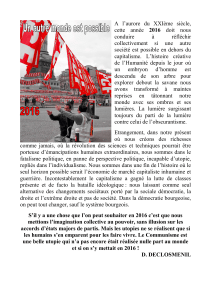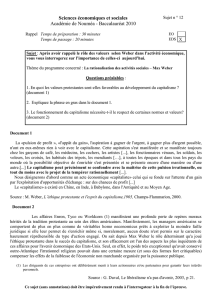LA DYNAMIQUE DU CAPITALISME

1
LA DYNAMIQUE DU CAPITALISME
BRADEL,2004,Flammarion
Chapitres I et II (les trois premières parties)
Plan du livre
Chapitre I – en repensant à la vie matérielle et à la vie économique
Chapitre II – les jeux de l’échange
Chapitre III – le temps du monde
Plan du texte
Chapitre I
Introduction
I – l’histoire économique en général
II – la vie matérielle(exploration)
III – la vie économique(présentation)
IV – la vie économique siècle par siècle et ouverture de l’étude aux autres pays
Chapitre II
Introduction
I – l’économie de marché
II – capitalisme, explication du choix du terme
III – différence entre capitalisme et économie de marché

2
CHAPITRE I : EN REPENSANT A LA VIE MATERIELLE ET A LA VIE
ECONOMIQUE
INTRO
Ce livre est l’apostille de Civilisation matérielle, économie et capitalisme. Cet ouvrage de
Braudel porte exclusivement sur l’économie.
« l’économie en soi, cela n’existe évidemment pas ».
L’économie est un sujet qui pose problème. L’histoire de l’économie encore plus, car le
temps n’est pas statique et les événements ne sont jamais identiques.
I – l’histoire économique en général
« l’histoire économique[…]est l’histoire entière des hommes, regardés d’un certain point de
vue ». Le problème c’est qu’il y a 4 siècles à prendre en compte et ce, à l’échelle mondiale.
Braudel choisit d’étudier les équilibres et déséquilibres profonds du long terme.
Il s’intéresse à l’économie pré-industrielle où la coexistence des rigidités, des inerties, des
pesanteurs d’une économie encore élémentaire avec les mouvements limités mais vifs et
puissants d’une croissance moderne est primordiale.
Les inerties Braudel part du quotidien, de la routine qui nous vient du passé et que nous
reproduisons de manière inconsciente : la vie matérielle
II – la vie matérielle(exploration)
*La démographie
Les humains sont soit trop nombreux, soit pas assez. « le jeux démographique tend à
l’équilibre, mais celui-ci s’atteint rarement ».
1450 forte augmentation du nombre d’homme liée à la fin de la peste puis reflux. C’est
un cycle.
XVIIIe éclatement du cycle : le nombre d’homme ne cesse plus d’augmenter. Les reflux
sont dû aux pénuries, disettes, famines, conditions de vie difficiles, guerres, maladies.
La mortalité infantile est énorme. « jusqu’à des temps récents, une réalité biologique
malsaine domine implacablement l’histoire des hommes. »
*Les habitudes alimentaires et vestimentaires
Apparition de nouveaux produits alimentaires(sucre, café, thé, alcool)qui constituent des
flux importants d’histoire.
L’importance des céréales résulte de choix très anciens qui sont devenus des choix de
civilisation.
*Les techniques
« tout est technique depuis toujours ».
Depuis toujours les techniques et les éléments de la science s’échangent à travers le monde.
« Il y a diffusion incessante ».
Le problème est que les associations de technique sont mal diffuées. Or le capitalisme est
une association aussi. Il fait la suprématie de l’Europe car il a été créé là et n’est pas diffusé
par masses entières.

3
*la monnaie et les villes
Ce sont des inventions très vielles qui font partie de la tradition, mais elles ont la faculté de
s’adapter aux changements et même de l’aider.
Les villes et la monnaie ont fabriqué la modernité, et réciproquement(d’après Georges
Gurvitch)la modernité a poussé l’expansion de la monnaie et à construit « la tyrannie des
villes ».
« Villes et monnaie sont des moteurs et des indicateurs. Elles provoquent, elles signalent le
changement. Elles en sont aussi la conséquence ».
III – la vie économique(présentation)
L’ économie d’échange=production+consommation.
Entre 1400 et 1800 : économie d’échange imparfaite : elle n’arrive pas à joindre toute la
production à toute la consommation.
« L’économie de marché est en progrès. » La production s’organise et la consommation
s’oriente et se commande.
L’économie d’échange est la liaison et le moteur de la production et la consommation.
*Les marchés élémentaires sont une limite basse de l’économie. Ce qui est en dehors a une
valeur d’usage, ce qui est dedans prend une valeur d’échange.
Parallèlement à l’apparition des boutiques, il y a l’apparition du crédit : les dettes et les
créances font les échanges.
*les foires et les bourses jouent un rôle supérieur. Elles sont dominées par les gros
marchands, les « négociants ».
IV – la vie économique siècles par siècles et ouverture de l’étude aux autres pays
XVe s=reprise générale de l’économie, montée des prix industriels donc développement des
villes tandis que les campagnes subissent une stagnation voire une baisse des prix agricoles.
Les marches urbains ont le rôle moteur.
XVIe s=l’économie se complique(à cause de sa vitesse pendant le siècle précédent et de
l’élargissement de l’économie atlantique).
Les foires ont le rôle moteur, c’est leur apogée. Importance du crédit.
Effondrement du crédit dans les années 1920.
XVIIe s=la vie active se développe à travers l’océan atlantique
époque de recul ou de stagnation économique(ex :Italie). Cependant la montée
d’Amsterdam est un contre-exemple.
L’activité s’appuie sur un retour à la marchandise(échange de base).
Elément moteur=les bourses.
Epanouissement des boutiques.
XVIIIe s=accélération économique générale.
Amplification de l’activité des bourses.
Développement de Londres et de Paris.
Amsterdam prête(notamment à Genève et à Gènes)
Ré-instauration du crédit
Baisse de l’hégémonie des foires(saufs dans les endroits encore marginaux de
l’économie européenne)

4
Forte animation des marchés urbains et des boutiques
Développement du « private market »qui s’oppose au « public market »(dominé
par les autorités)d’abord en Angleterre développement du contre marché en Europe.
Qu’en est-il pour les pays non-européens ?
Les rouages de l’échange en Europe sont les mêmes en orient.
Braudel va comparer les deux pour chercher à expliquer le fossé qui se creuse entre eux au
XIXe s.
Les marchés sont en place partout.
En Chine les boutiques et les colporteurs sont nombreux mais les foires et les bourses ne
sont quasiment pas développées.
Au Japon il y a une meilleure organisation de l’échange.
En Inde il y a un fort développement des foires.
Dans le monde islamique, les foires ont moins d’importance qu’en Inde.
« L’économie européenne semble avoir dû son développement plus avancé à la suprématie
de ses instruments et de ses institutions : les bourses et les diverses formes de crédit ».
Braudel établit une hiérarchie de l’échange : d’abord le japon,
l’Insulinde(Indonésie+Philippines)et l’islam, ensuite l’Inde puis la Chine et sous la Chine, les
autres économies primitives. Au-dessus de l’économie de marché prospère le capitalisme.
CHAPITRE II : LES JEUX DE L’ECHANGE
INTRO
Entre le XVe et le XVIIIe s on constate la place énorme de l’autoconsommation(qui est
différente de l’échange).
Ce chapitre traite de l’échange c’est-à-dire économie de marché+capitalisme.
Jusqu’au XVIIIe l’économie de marché et capitalisme sont minoritaires. La vie matérielle
domine.
L’économie de marché est en extension mais elle manque d’épaisseur.
Le capitalisme ne saisit pas l’ensemble de la vie économique et ne crée pas son mode de
production.
I – l’économie de marché
L’économie de marché n’est qu’un fragment d’un vaste ensemble. C’est la liaison entre la
production et la consommation. Elle se trouve entre la vie matérielle et le capitalisme.
Entre le XVe et le XVIIIe l’économie de marché ne cesse de s’élargir. On le constate dans
la variation des prix dans le monde entier.
« Le marché, entre production et consommation n’est qu’une liaison
imparfaite[car]partielle ».
II – capitalisme, explication du choix du terme
Capitalisme est un anachronisme. «Pas de capitalisme avant la Révolution Industrielle ».
« Capitalisme »est pourtant le mot qui qualifie le mieux la situation, car le présent n’est que
le passé grossit . Il n’y a pas de discontinuité.
III – différence entre capitalisme et économie de marché
Le capitalisme est compris entre le capital et le capitaliste.

5
Capital : « Résultat utilisable et utilisé de tout travail antérieurement accompli ».
Dès le XVe s, le « private market » prend de l’importance. Ce nouveau marché cherche à se
séparer des règles du marché traditionnel qui sont paralysantes. Il s’agit d’échanges inégaux,
la concurrence y a peu de place. Le marchand a deux avantages : il supprime le contact
producteur/consommateur et il a de l’argent comptant. Ainsi entre production et
consommation s’établissent des chaînes de marchands qui en s’allongeant échappent de plus
en plus aux règles. C’est le processus du capitalisme. Il y a accumulation de capitaux
considérables. Le capitaliste, quant à lui, dépasse vite les limites « nationales » il manie le
crédit, a la supériorité de l’information, de l’intelligence et de la culture. Il supprime la
concurrence. Les capitaux se déplacent.
Le monde de l’échange est hiérarchisé :des métiers humbles aux négociants. La division du
travail n’atteint pas les négociants, et ce pour trois raisons :
-le marchand ne se spécialise pas car aucune branche n’est suffisante pour absorber son
activité.
-le marchand change d’activité car il suit le profit qui lui n’est pas statique.
-la spécialisation chez le marchand n’a pas de succès de longue durée.
Capitalisme économie de marché
Pas de concurrence possibilité de concurrence
« économie sophistiquée « économie terre à terre »
dominante
« tout capitalisme est à la mesure […]des économie qui lui sont sous-jacentes ».
1
/
5
100%