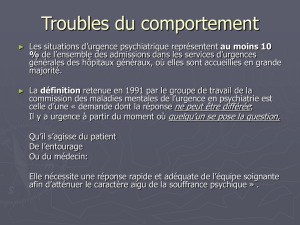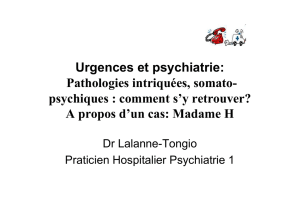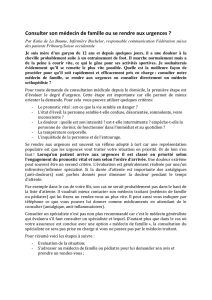l`intervention de crise

Intervention de Crise. Cours de DES mai 2004. Dr A Mathur
1
L ’intervention de Crise
Crise
Le modèle d ’une stratégie
thérapeutique

Intervention de Crise. Cours de DES mai 2004. Dr A Mathur
2
L’INTERVENTION DE CRISE
1. Le Concept
-définition
-rappel historique
2. Les objectifs
3. La « barrière au traitement »
4. Les moyens
-équipe
-cadre temporel
-les modes de traitement
5. Le déroulement
6. Un exemple clinique
7. Urgences et crise
-différences
-transformer l’urgence en crise
-intervention de crise aux urgences
8. La consultation de crise à Casselardit
9. Bibliographie

Intervention de Crise. Cours de DES mai 2004. Dr A Mathur
3
Dans un premier temps je vais vous décrire un peu ce qu’est le concept de Crise au
niveau théorique, en soulignant le fait qu’elle s’appuie sur le modèle psychanalytique,
puis dans un second temps je vais m’orienter sur les applications dans le cadre
spécifique ainsi qu’ en dehors du cadre dans lequel elle a été développée.
1. LE CONCEPT DE CRISE
Définition
La crise est un concept général qui parle à chacun de nous et qui même dans le
domaine de la psychiatrie donne lieu a des interprétations différentes.
Dans le domaine de l’intervention de crise, la crise est considérée comme
un moment de rupture dans l’équilibre intrapsychique ou interpersonnel
qui mène à une prise de contact avec un professionnel de la santé
mental. Il y a souvent une intensité importante dans la souffrance du patient
qui à première vue n’admet pas un grand délai de réponse.
Dans cette définition tirée du livre de Nicolas de Coulon « La crise », nous avons
d’abord le mot crise même qui selon le dictionnaire dans sa le cadre médical est
défini comme « moment d’une maladie caractérisé par un changement subit et
généralement décisif, en bien ou en mal »
La temporalité est intégré à cette définition succincte. L’origine grecque du mot vient
de krinomai qui était le moment du jugement, des décisions à prendre, un
croisement imposant un choix de la route à prendre.
La définition de de Coulon met en exergue le fait que la cirse au niveau psychiatrique
n’existe pas tant qu’en elle-même, mais dans les yeux du psy (psychiatre ou
psychologue ou infirmier) qui la reconnaît comme telle dans la dimension
intersubjective au moment de la rencontre.
Ceci pour vous dire que travailler la crise c’est d’abord un état d’esprit chez le
soignant.
Nicolas de Coulon précise alors sa définition en rajoutant :
L’urgence contient la notion fluctuante de danger pour des tiers ou pour la
personne elle-même . Elle exige une intervention immédiate.
La crise admet un délai (même bref) dans la réponse, jusqu’à 24 heures.
Si la personne peut attendre plus longtemps, elle se retrouve « simplement »
aux prises avec un problème psychologique
Contrairement à la notion de décompensation, celle de crise suppose qu’il ne
s’agit pas seulement d’une désorganisation mais d’une ouverture : d’ou l’idée
de moment fécond

Intervention de Crise. Cours de DES mai 2004. Dr A Mathur
4
Comment la crise se présente à nous au niveau institutionnel ?
Il peut s’agir le plus souvent de tentatives de suicide ou de menaces suicidaires,
d’alcoolisations pathologiques, de crises d’agitation, de délire aigu … On peut aussi
imaginer dans d’autres lieux, qu ‘elle se présente sur appel du médecin traitant qui
identifie chez son patient des idées suicidaires, ou qui trouve un patient agité chez lui
suite à un conflit familial. L’intervention de crise a été développé pour répondre à
cette demande parfois bruyante. La crise qui pousse l’individu à consulter de lui-
même en raison d’un sentiment intime de volonté de changement a comme réponse
dans le meilleurs des cas une psychothérapie. Nous ne parlons pas de cette « crise
intime. »
Cependant, malgré la forme bruyante que peut prendre la crise on ne doit pas se
leurrer : un état de crise peut se répéter plusieurs fois dans la vie d’un patient. Il y a
des patients qui ne consultent qu’à l’occasion de nouvelles crises . Etat de crise
n’est pas prise en charge de type crise. Certaine crises se prêtent mieux que d’autre
à une prise en charge de type crise.
Une xème alcoolisation aiguë chez un patient présentant une dépendance à l ‘alcool
déjà connue n’est pas une situation justifiant une intervention de crise en priorité.
Une 1ère alcoolisation aiguë le serait d’avantage.
C’est pour cela que je voudrais insister sur le caractère spécifique du concept de
crise et de l’intervention de crise. La crise en devient une lorsqu’on peut dépasser
l’urgence et la transformer en une véritable situation de crise, c’est à dire un
moment potentiellement fécond, une ouverture vers un possible changement.
La crise s’apparent aux psychothérapies brèves plus qu’autre chose, sans en faire
véritablement partie. Les points qui les différencient sont illustrés dans en fin de texte
sous forme d’un tableau.S’appuyant sur la théorie psychanalytique, elle correspond
à une forme de psychothérapie adaptée à la pratique psychiatrique.. Elle sert une
conception préventive des soins qui fait de la mise à jour et de la négociation des
conflits l’objectif princeps de son travail . La crise ne repose pas sur une nouvelle
théorie, elle repose plutôt sur une nouvelle vision de la psychiatrie. Sur le plan
théorique, elle s’appuie comme je me disais sur la psychanalyse : ce sont des
psychanalystes qui théorisent sur la Crise en Europe. En pratique, en relation avec le
patient différents modèles sont utilisés. Il peut y avoir l’utilisation de pratiques
systémiques ou cognitives en particulier.
L’intervention de crise doit servir à inscrire le patient qui pourrait en bénéficier à un
traitement au long cours. Elle ne se suffit pas à elle-même et doit donc être insérée
dans un réseau de soins, avec à l’aval des services pouvant proposer des soins de
longue durée.
Pourquoi est-ce que je pense que c’est une concept qui peut vous intéresser alors
que nous n’avons pas ce fameux dispositif de crise, du moins pas encore ?
Parce que je pense que la crise est un modèle qui préconise la véritable rencontre
avec le patient. Quand on réfléchit sur un mode de crise, rien n’est joué d’avance, ni
pour nous ni pour le patient ,ni pour son entourage. Nous nous préoccupons moins
des symptômes que de la situation et de ce qu’elle signifie pour le patient et son
entourage. Nous ne nous préoccupons pas du patient comme d’une personne isolée,

Intervention de Crise. Cours de DES mai 2004. Dr A Mathur
5
seule concernée, seule responsable de ce qui lui arrive. Il est donc totalement anti-
crise de prendre un décision d’hospitalisation au cours du premier entretien (voir
avant). Finalement le modèle de crise est une des percées de la psychanalyse dans
l’institution. Vous verrez que pour faire un vrai travail de crise lege artis, il faut au
moins une supervision par un psychanalyste.
Rappel historique et raison d’être de l’intervention de crise
La crise est née avec la psychiatrie communautaire des années 60 dans les pays
anglo-saxons. Elle n’est pas à confondre avec les interventions en post-catastrophe,
type debriefing, mais elles trouvent une partie de leurs origines dans ces
interventions qui ont commencé pendant la 2ème Guerre Mondiale chez les
« névrosés de guerre ». Le premier auteur américain à publier sur ce le concept de
crise est Caplan qui avait articulé le concept de crise à une conception
interpersonnelle du trouble de l’adaptation. Il avait comme objectif la transformation
des dynamiques intersubjectives qui influent sur l’émergence clinique et sur la
chronicisation avec un souci de prévention. Sa théorie de l’intervention de crise
mettait en évidence les conflits interpersonnels.
Plusieurs phénomènes ont contribué à son développement et à sa mise en pratique .
D’abord, le développement de traitements psychotropes puissants et efficaces dans
une certaine mesure devaient permettre une meilleure insertion des malades dans la
société . L’espoir est né de pouvoir faire sortir des patients hospitalisés au long cours
en institution et de les resocialiser.
Ensuite, une crise institutionnelle, qui a été particulièrement forte aux Etats-Unis, a
mené à la fermeture de nombreux hôpitaux psychiatriques. Il y a eu au début
ouverture d’un nombre important de lieux de soins extra-hospitaliers . Malgré ceci on
n’a pas assisté à une diminution du nombre d’hospitalisations, car le phénomène de
la porte tournante est apparu : nombre de patients sortaient de l’hôpital pour y
revenir peu de temps après. Le point de vue de Caplan qui avait axé son travail sur
l’axe des conflits interpersonnels était négligé. Sans un travail spécifique au moment
de l’hospitalisation la situation perdurait. Il est devenu nécessaire de développer un
nouveau modèle d’intervention. Nous voyons maintenant cette politique de
fermeture des lits pratiquement dans toute l’Europe, et en France également.
Malheureusement, les dispositifs ambulatoires n’on pas suivi.
Par ailleurs, il y a eu une prise de conscience que l’hospitalisation est une véritable
rupture concrète des relations du patient et une aliénation familiale et sociale.
Réfléchissez un peu à l’impact de l’hospitalisation. Je ne remets pas du tout en
question la nécessité d’hospitaliser un grand nombre de patients. Mais que signifie
une hospitalisation psychiatrique : d’abord pour le patient cela veut dire qu’il ne peut
plus fonctionner de manière autonome. Ensuite pour la famille / entourage, cela
traduit bien le fait que c’ est le patient qui est en cause, qu’il est malade, qu’il est
dangereux… qu’on ne peut plus le laisser en liberté. Dans le cadre d’un couple
dysfonctionnant, dès que l’un est étiqueté de malade, il est difficile de faire une
thérapie de couple dans de bonnes conditions. Les partenaires ne se considèrent
pas comme égaux dans la relation. L’hospitalisation du fait de sa rupture concrète
des relations du patient et de son groupe sanctionne une certaine aliénation du
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%