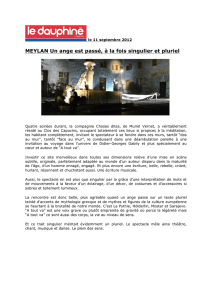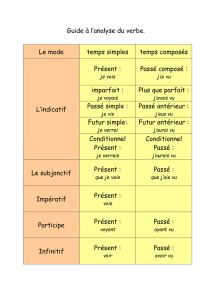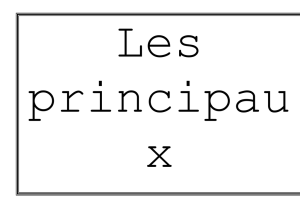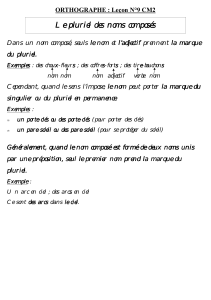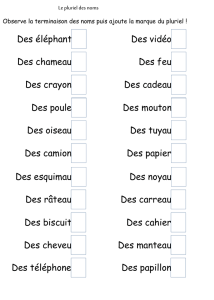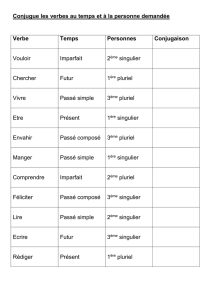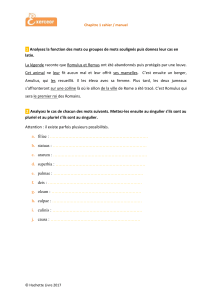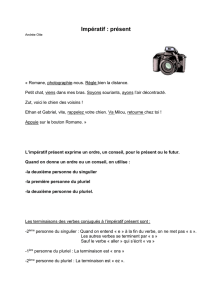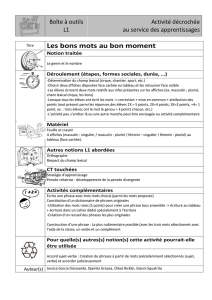Le substantif

Fiche d’ancien français
Envoyé par Mathilde
Le substantif
MORPHOLOGIE
Le genre : pas toujours le même qu’en FM…surtout pour les
inanimés (abstraits en -or /-eur, -our…)
Le nombre : se combine avec la marque flexionnelle, cpdt en AF :
- substantifs en –e à valeur collective, en général féminins (<
neutres pluriels lat. en –a) doie = les doigts ; crin et crine = chevelure, cheveux ; …
- substantifs à valeur collective, qui appartiennent
morphologiquement au singulier, mais entraînent svt un verbe au pluriel
lorsqu’ils sont sujets gent ; clergié ; mesnie ; chascun…
- un duel, marqué par l’article uns / unes déterminant des
substantifs au pluriel désignant des objets composés de 2 éléments
symétriques uns ganz ; unes force ; unes narines ; unes levres…
ou des ensembles formés d’éléments cpltaires uns dras = des vêtements…
Le cas (fonction grammaticale) :
MASCULIN
1ère déclinaison : -s de flexion au CSS
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
Sing.
Plur.
CS
CR
li murs
le mur
li mur
les murs
l’escuz
l’escu
li escu
les escuz
li hiaumes
le hiaume
li hiaume
les hiaumes
= quasi totalité des subst.masc. , v.a. subst. en –age, les infinitifs
substantivés li veoirs, li lires
2ème déclinaison : pas de –s de flexion au CSS
Singulier
Pluriel
CS
CR
li pere
le pere
li pere
les peres
= subst. en -e sourd
3ème déclinaison : alternance du radical (déplact accent + ê humain)
Singulier
Pluriel
Singulier
Pluriel
CS
CR
l’emperere
l’empereor
li empereor
les empereors
li ber
le baron
li baron
les barons
CS
CR
li pastre
le pastor
li pastor
les pastors
li garz
le garçon
li garçon
les garçons
= noms d’agent en –ere / -eor, iere / -eor, -re / -or
seuls cuens, conte ; (h)om, (h)ome ne présentent pas déplacemt d’accent
Très tôt, tendance à normaliser : on a mis un –s analogique aux CSS
comme pour la 1ère décl. ou on a supprimé les alternance radicales en
alignant sur le CSS ou sur le CR. Mais souvent, anarchie…
FEMININ
1ère déclinaison : subst. en –e sourd
singulier
pluriel
CS/CR
la fille
les filles
2ème déclinaison : subst. terminés par une consonne ou voyelle
accentuée + a un –s de flexion au CSS
singulier
pluriel
singulier
pluriel
CS
CR
la flors
la flor
les flors
la citez
la cité
les citez
Tendance à l’alignement du CSS sur le CRS non fléchi (rarement
CRS sur CSS)
3ème déclinaison : alternance du radical
singulier
pluriel
singulier
pluriel
CS
CR
la none
la nonain
les nonains
la suer
la seror
les serors

Fiche d’ancien français
mêmes remarques que pour le masculin
les accidents phonétiques liés à la flexion
combinaison de la cons. finale du mot avec le –s de flexion :
-t + s > z (la dentale étymologique encore prononcée en AF avant
fin XIII° n’est tombée qu’une fois réduc° de l’affriquée.
Dialectalement, est restée jusqu’à fin M-Age d’où alternances
pié, piez ; vertu, vertuz…, v.a. participes passés faibles : amé,
amez ; feni, feniz…)
(cons +) -n + s > z an, anz
-ing + s > nz coing, coinz; compaing, compainz
-il + s > iz fil, fiz
-st + s > z ost, oz; forest, forez; fust, fuz
Avec réduction rapide de l’affriquée [ts] à [s], les graphies –s pour –z
et inverse sont fréquentes.
effacement de la cons. finale devant le –s de flexion qd la cons. est
une labiale (p, b, m), une labiodentale (f), une vélaire (c), un l précédé de
i, u, eu.
vocalisation du l derrière voyelle :
-al, -aus (-ax) -iel, -ieus -ol, -ous
-ail, -auz -iel, -ieuz -oil, -ouz
-el, -eaus / -iaus -uel, -ieus / -eus
-el, -eus / -ieus -ueil, -ieuz
-eil, -euz
SYNTAXE
La déclinaison permet de repérer la fonction des groupes (sujet ou cplt).
Progressivement, ruine de la déclinaison (dispari° du –s au CSS puis
généralisa° du CR donc - au singulier / -s au pluriel). Le pronom est
resté plus lgtps décliné donc parfois donne le cas et le subst. le nombre.
CAS SUJET
= fonction sujet ou en relation avec le sujet (épithète, attribut,
apposition), que le verbe soit exprimé ou sous-entendu.
li jorz fu biax et granz ; je sui uns clers
le substantif « sujet réel » d’un tour impersonnel est souvent au CR !
l’apostrophe, d’abord au CS ds les txt, oscille très tôt entre CS et
CR.
CAS REGIME
= COD, attribut de l’objet, apposition à l’objet
= COI, COS de certains verbes impliquant une idée d’attribution,
d’appartenance, de convenance, de parole (dire qc).
= complt déterminatif du substantif exprimant liens de parenté,
possession, dépendance. En gal, le déterminé précède le déterminant (tjrs
une personne) : dé + da au CR
L’indéfini autrui, le relatif cui sont tjrs placés devant le nom dt ils sont
compléments, ( celui)
La mort celui ki jugier nos vandrait = la mort de celui qui viendra nous juger
L’autui joie = la joie d’autrui
Cette construction est concurrencée par des tournures préposition-
nelles : a + da a valeur général ou non identifié cort a roi
qui désigne un animé ( personne) le cri au chien
animé pluriel les deus escuz as deus chevaliers
de + da inanimé le fonz d’une valee
nom propre de villes et pays la cité de Kamaalot
termes génériques cors d’ome
da pronom peronnel l’ame de moi
Selon le contexte, de introduit un cplt à valeur objective ou
subjective. La construction directe a une valeur uniquement subjective
la pitié de son seignor = pitié qu’éprouve le seigneur ou dt il est objet
La pitié son seignor = pitié qu’éprouve le seigneur

Fiche d’ancien français
= CO interne et Ccirconstanciel indiquant
la direction troi avugle un chemin aloient = 3 aveugles suivaient un chemin
la distance il n’ot pas une archiee alee =il ne s’était pas avancé d’1portée d’arc
la date, durée L’endemain de la saint Jean ; el plorroit tout le lonc del jor
le prix, l’estimation valent vint mars d’argent
la cause tranbla les fievres = il tremblait de fièvre
la manière, l’attitude cil gist gole sovine = il est étendu la face tournée vers le ciel
l’allure son ami i vient le cors = en courant, à la course
= Cplt prépositionnel, derrière toutes les prépositions
sauf derrière la prép. exceptive fors, lorsqu’elle excepte un sujet &
derrière les prép. a et por introduisant l’attribut d’un pronom réfléchi,
après avoir (a) non (= avoir pour nom), on a le CS :
Il n’est joie ne li anuit fors seul li penssers a cesti = il n’y a pas de divertissement qui
ne l’ennuie, si ce n’est de penser à elle
Por fos me puis tenir = je peux me considérer comme fou
= apposition à tout cplt
Fils sui Guion, le duc qui tint Ardane = je suis le fils de G., le duc qui tenait l’Ardenne
* *
*
Complément circonstanciel : peut être supprimé et déplacé mais pas
pronominalisé.
Complément essentiel : ne peut pas être supprimé ni déplacé mais peut
être pronominalisé. Ex/ COD ou certains cplts:
je vais à Paris (y, je vais, à P. je vais)
Verbes impersonnels : ex : il pleut
Construction impersonnelle : le verbe n’est pas impersonnel, il a un
« sujet réel » appelé aussi « régime » de l’impersonnel et qui est toujours
un CR. il tombe de la neige
1
/
3
100%