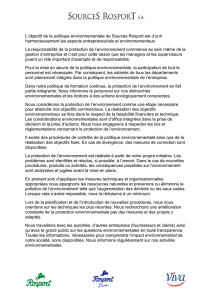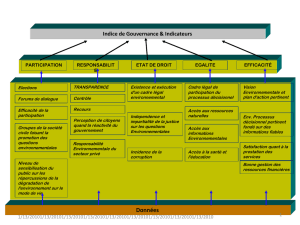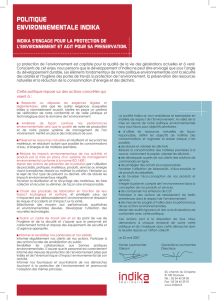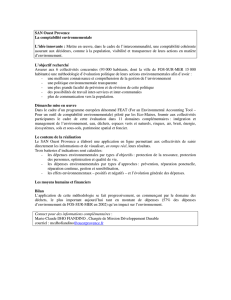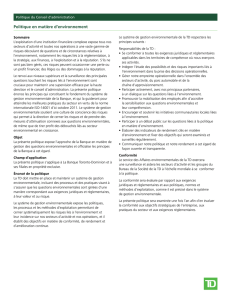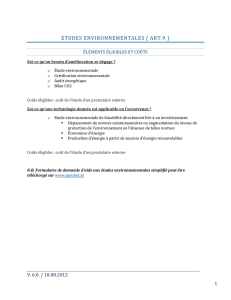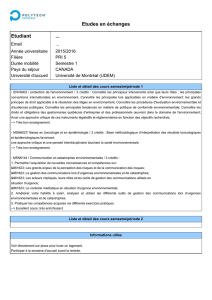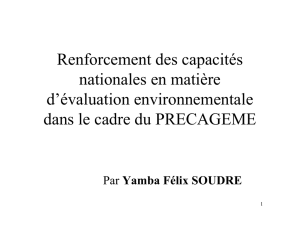Reverdy Metro

COMMENT L’INDUSTRIE S’EST ELLE REAPPROPRIEE L’ENVIRONNEMENT :
ARTICULATION ENTRE L’ACTION PUBLIQUE ET LES DEMARCHES VOLONTAIRES
Thomas Reverdy
Aujourd’hui, la question de l’acceptation des contraintes environnementales est une question
majeure : on sait que ces contraintes vont aller croissantes, à un rythme probablement assez rapide,
mais on comprend que l’acteur public hésite à imposer des mesures impopulaires. Se pose donc la
question de l’acceptabilité des nouvelles contraintes associées à la lutte contre le changement
climatique, contraintes dont on sait qu’elles vont transformer la vie économique autant que notre vie
quotidienne.
Dans un débat aussi vaste, ma contribution à cette question sera modeste. Elle s’appuie sur mon
expérience de l’intégration de l’environnement dans les entreprises industrielles, et elle suppose une
reformulation de la question. Je ne parlerais pas beaucoup de changement climatique : et pour cause,
on a très peu de recul sur les instruments de l’action publique, leur acceptation, leurs effets ! Si les
instruments existent (permis d’émission négociable, certificats), ils n’ont pas encore eu des effets
flagrants compte tenu d’un prix du CO2 qui, après avoir connu un niveau significatif, est devenu
quasiment nul.
Je parlerais donc plutôt de l’action réglementaire ou incitative de l’Etat en direction des entreprises
durant les 20 dernières années en matière d’environnement, et en particulier dans le cas de la France.
Soumis à une réglementation européenne de plus en plus exigeante, notre pays a rattrapé son retard
dans la réduction des pollutions des grands sites industriels. Cette communication détaille les
différents mécanismes à l’œuvre dans cette transformation : le rôle de la réglementation, le rôle des
incitations économiques, le rôle des actions volontaires des entreprises. Il me semble que ce bilan
(même s’il est un peu caricatural) est utile alors que de plus en plus d’acteurs économiques et
politiques défendent l’idée selon laquelle les entreprises seraient devenues des acteurs privilégiés du
progrès environnemental et que leurs actions volontaires suffiraient à ce que ce progrès se poursuive.
Ainsi, la première partie de cette communication s’intéresse à l’action de l’Etat, action réglementaire
et économique. Nous essayons d’en expliquer les fondements, les instruments et les effets. Nous
montrons que la réglementation procède principalement par la traduction et l’adaptation aux contextes
spécifiques des entreprises, mais qu’elle a vraiment trouvé son efficacité dans l’articulation avec les
dispositifs de financement. Nous introduisons aussi la nuance suivante : parfois, à trop vouloir adapter
ses exigences aux conditions locales, compte tenu du poids des enjeux et négociations locales, l’Etat a

parfois manqué sa cible. A trop vouloir « traduire », les ambitions ont été « trahies » (pour reprendre
les termes de Callon, 1998). La politique de gestion des déchets en est une belle illustration. Ainsi, si
les entreprises ont progressé dans leur performance environnementale, c’est, la plupart du temps, parce
que cette performance a été à la fois « exigée », par des réglementations, et « soutenue », par une
articulation avec des instruments économiques incitatifs.
La seconde partie s’intéresse aux actions volontaires des entreprises, c'est-à-dire les actions engagées
en faveur de l’environnement sans réglementation déjà existante et sans dispositif incitatif. Trois
mécanismes permettent en principe à l’entreprise de tirer bénéfice d’une action volontaire. Le premier
mécanisme est l’amélioration de son image auprès du public, des clients et des actionnaires et qui
suppose que les clients par exemple, soient prêts à payer plus cher un bien écologique. Le deuxième
mécanisme est le jeu concurrentiel, mais dans un contexte où la réglementation devient plus sévère :
celui qui l’anticipe bénéficie en général d’un avantage de « first mover » sur son marché (exclusion
des concurrents ou coûts plus élevés…). Le dernier mécanisme concerne des actions volontaires qui
visent à organiser la réponse de l’entreprise, à intégrer les exigences réglementaires dans l’activité, et
ainsi faciliter l’acceptation de ces exigences. Ce mécanisme est probablement le plus courant.
L’essentiel des actions volontaires visent les moyens, l’organisation. Elles facilitent le déploiement des
exigences environnementales dans l’ensemble des activités de l’entreprise, de la stratégie jusqu’aux
activités quotidiennes.
Au cours de notre travail de thèse (financée par l’ADEME), nous avons eu l’occasion de participer,
comme stagiaire ingénieur, à plusieurs projets d’amélioration des performances environnementales
dans un site industriel important de la chimie de base pendant 5 mois, et dans un site de construction
mécanique. La pratique de l’observation participante ainsi que des entretiens informels approfondis
nous ont permis de recueillir des informations sur les attitudes des diverses personnes face aux
différents projets. Par ailleurs, nous avons eu l’occasion d’encadrer des stages d’élèves ingénieurs dans
les équipes environnement dans divers sites industriels, dans l’industrie chimique, l’industrie
mécanique, électrique et électronique. Nous avons réalisé deux enquêtes sur la gestion des déchets
industriels dans le cadre de recherches financées par l’ADEME (40 responsables environnement
interviewés).
Je m’appuie sur la nouvelle théorie institutionnelle en théorie des organisations (Hargrave. Van de
Ven, 2006) : elle s’intéresse aux « institutions » c'est-à-dire les schémas, les normes, les règles, les
dispositifs, qui rendent possible ou contraignent le comportement des acteurs et rendent le monde
prédictible et compréhensible. Je m’intéresse donc principalement aux « institutions » qui véhiculent
la question environnementale au sein de l’entreprise : la réglementation et les incitations économiques,
mais aussi l’action managériale (discours, décisions d’investissement, pratiques de management) et
enfin l’action « collective » des membres de l’organisation (comment ils coopèrent entre eux).

Comme on le verra dans la première partie, l’action incitative et coercitive de l’Etat est nécessaire,
mais elle ne suffit pas. Elle rencontre de nombreux obstacles dans sa traduction concrète. La seconde
partie montrera que l’action de l’Etat n’a été effective que parce qu’il y a eu, en même temps, des
changements organisationnels et culturels, facilités par la diffusion des démarches dites
« volontaires ». Ces démarches sont parfaitement complémentaires à l’action publique (et non
opposées) car elles accroissent la légitimité des exigences environnementales dans l’entreprise, les
véhiculent et le traduisent au cœur de l’organisation industrielle. Ainsi, ces démarches volontaires ne
doivent pas être pensées comme des alternatives à l’action de l’Etat, mais comme complémentaires, et
même comme catalyseurs de l’action de l’Etat.
Le rôle et les limites de l’action de l’état.
Cette première partie vise tout d’abord à rendre compte du rôle central de l’action de l’Etat dans le
progrès environnemental. Ce rôle a été d’autant plus important qu’il s’appuyait sur deux types
d’instruments : la réglementation, et en particulier le droit des installations classées, et les incitations
économiques, comme les subventions des Agences de l’Eau. Mais elle montre aussi la limite de cette
action si aucune entreprise n’accepte d’innover, de se réorganiser…
Le droit des installations classées : un instrument pragmatique
Le premier point que je souhaite questionner est la façon dont le droit des installations classées a
facilité l’acceptation des exigences environnementales par le monde économique. Le droit des
installations classées est un droit pragmatique, conçu dans une visée instrumentale, un instrument
parmi d’autres d’une politique de modernisation environnementale de l’industrie. Pierre Lascoumes,
dans son ouvrage « l’éco-pouvoir », montre, à travers l’histoire de ce droit et des institutions en charge
de son application, combien celui-ci a eu pour objectif de protéger à la fois la liberté d’entreprendre et
la limitation des nuisances à autrui.
Il nous explique aussi que le droit des installations classées est le produit d’un « transcodage
juridico-technique » (concept largement enprunté à la notion de « traduction » de Callon), où les
inspecteurs des installations classées interviennent à différents niveaux pour définir un niveau
d’exigence acceptable par les entreprises industrielles. Ce droit est très critiqué par les juristes, compte
tenu du pouvoir exorbitant qu’il donne à l’administration en charge de son application. La législation
européenne est d’ailleurs assez cohérente avec le droit qui s’appuie sur le « principe de prévention » :
« le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à
l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable » (Commission Européenne). Ce principe justifie une action administrative en amont de la
pollution pour limiter celle-ci et s’oppose à une logique purement judiciaire de l’environnement. C’est

aussi un principe pragmatique : il conditionne l’action administrative à la disponibilité des solutions,
qui doivent être économiquement acceptables. Selon ce principe, dès qu’il existe une technologie
moins polluante, l’Etat intervient pour obtenir des entreprises son adoption.
On peut avoir plusieurs interprétations de ce principe, et la Commission Européenne, selon les
thèmes, oscille entre les deux :
- normes de rejets génériques (avec des valeurs censée être les mêmes pour tous les sites
industriels) à partir du moment où une technologie de traitement est disponible ;
- normes de rejets spécifiques, adaptées aux entreprises dans leurs spécifiés techniques,
environnementales, économiques.
De son côté, l’Etat français est toujours resté fidèle à sa doctrine des normes de rejet spécifiques.
Ainsi, l'Arrêté Intégré du 2 février 1998, texte qui traduit en droit français un ensemble de directives
européennes fondées sur des normes de rejets génériques (avec des valeurs censées être les mêmes
pour tous les sites industriels), ne prévoit pas une application unilatérale, mais une adaptation site par
site pour les installations existantes. Ce texte offre des marges d’interprétation. Du point de vue de
certains industriels et inspecteurs, une mise en œuvre trop stricte des exigences génériques pourrait
conduire à des aberrations : par exemple, pour la pollution de l’air, l’Arrêté impose des limites de
concentration d’un polluant donné dans l’air rejeté, ce qui peut conduire à un très haut niveau
d’exigence sur une source minime de pollution quand celle-ci est peu diluée, et à l’absence d’action
sur des sources importantes mais très diluées. Pour avoir du sens, une norme générique doit être
accompagnée d’autres prescriptions (par exemple sur les équipements, pour éviter une dilution) et par
une connaissance du site industriel.
L’action administrative fondée sur le principe de prévention, a fortiori quand elle vise à établir des
obligations spécifiques à chaque activité, rencontre une difficulté majeure : en effet, l’acteur public ne
peut agir qu’à condition qu’une technologie moins polluante soit effectivement disponible. Or, dans la
majorité des cas, il n’est pas de l’intérêt du pollueur de développer une telle technologie (nous verrons
plus loin les exceptions). Si le droit des installations classées a pu conduire à de vrais progrès, c’est
aussi parce que s’est développée conjointement une industrie de la dépollution (ou éco-industrie).
Cette industrie s’est fortement mobilisée dans des politiques d’innovation et de développement
technologique. Selon le principe des meilleures technologies disponibles, de nouvelles exigences
réglementaires ont été définies à partir de cette offre (par exemple, la valeur limite de concentration
d’un polluant dans un rejet dans l’air correspond exactement à la capacité des équipements de
traitement de l’air). Et les nouvelles exigences réglementaires ont créé un marché important pour ces
industriels de la dépollution (qui par ailleurs, n’avaient pas à subir les coûts de cette réglementation).
En 1996, avec la directive IPPC (IPPC signifie Integrated Pollution Prevention and Control),
l’Union européenne a voulu créer une dynamique européenne de partage des connaissances entre les
pays sur les technologies de production utilisées et leur performance environnementale : des
documents détaillés ont été rédigés sur la base d’enquêtes auprès des industriels et administrations des

pays membres et détaillent les technologies les plus performantes. Aujourd’hui ces documents sont
rédigés, mais il est difficile de dire comment ils sont utilisés par les administrations pour fixer les
niveaux d’exigence pour les sites.
Un droit inégalement appliqué
La traduction des exigences environnementale peut aussi conduire à d’importantes disparités, au-
delà de ce qui a été prévu par les textes. Un texte dont l’application initiale est prévue comme
particulièrement stricte, dans les faits, peut connaître un retard ou une application incomplète. Prenons
l’exemple de l’arrêté ministériel de 1985 concernant les activités de traitement de surface (déchet,
rejets accidentels, pollution atmosphérique, pollution de l’eau) : les dispositions sont applicables le 1er
janvier 1991. Un rapport publique de la DRIRE Rhône Alpes explique que, dans cette région, en 1991,
55 % des installations sont non conformes. En 1996, 22 % sont non conformes. En Ile de France, le
rapport publié en 2000 explique que 1/3 des ateliers ne respectent pas les normes, 1/5 ne pratiquent pas
d’auto-surveillance, 1/5 ont une rétention insuffisante, 1/5 ont des alarmes de pH défaillantes.
Pierre Lascoumes constate dans son ouvrage que l’administration hésite à poursuivre les entreprises
qui ne respectent pas leur arrêté d’autorisation. L’administration se limite à des procès verbaux, et ne
les transmet pas à la justice, préférant rester dans une logique de régularisation de l’infraction plutôt
que d’entrer dans une logique judiciaire. En effet, les DRIRE souhaitent rester maître de la négociation
avec les sites pour planifier les mises en conformité, afin de préserver aussi les enjeux économiques et
sociaux des activités concernées. P. Lascoumes note cependant, en 1994 déjà, une augmentation
sensible du nombre de sanctions administratives, qu'il explique par la pression de plus en plus
importante de la société civile. Son constat est confirmé par E. Viardot (1998). En revanche, la
régularisation est en général obtenue pour une large majorité des infractions avant de passer à des
sanctions pénales, dont le nombre est resté stable.
Une évolution majeure de ce droit des installations classées ou plus globalement du droit de
l’environnement, a été l’obligation d’information (c’est grâce à cette obligation que l’on peut se
renseigner facilement sur la situation des entreprises) et la possibilité des associations d’attaquer en
justice les entreprises qui ne le respectent pas. C’est pourquoi l’application du droit des installations
classées connaît aussi une certaine radicalisation, l’administration craignant que sa responsabilité soit
mise en cause.
Articulation entre les instruments juridiques et économiques, comme condition de
l’acceptabilité des exigences environnementales
Le droit de l’environnement n’est véritablement décliné, mis en œuvre, que lorsqu’il se combine à
d’autres formes d’action publique et en cohérence avec elles. L’action de l’Etat en matière de
pollution de l’eau d’origine industrielle a été un succès. Pourquoi ? Parce qu’il y a eu une articulation
étroite entre une action réglementaire et une incitation économique par les Agences de l’Eau (qui a
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%