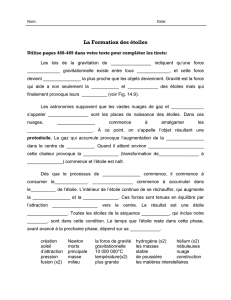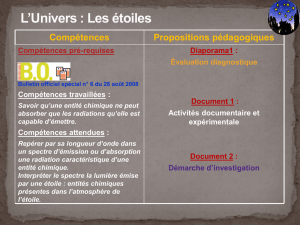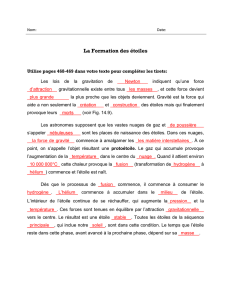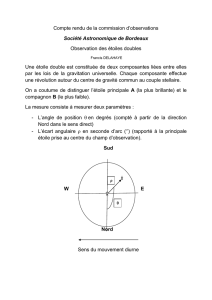etoile-corrige

Formation ABE-CAMPUS
Page n°1
E
ET
TO
OI
IL
LE
E
F
FI
IL
LA
AN
NT
TE
E
"Illusion d'optique" produite par une étoile qui s'éteint.
Partie d'une étoile qui s'est détachée de sa base, qui tourne autour d'un axe à une vitesse
plus grande, qui fonce vers la terre et se désagrège dans l'atmosphère après une explosion
de ses éléments constitutifs et qui est lumineux grâce aux frottements.
Dans le diagramme de Hertzsprung-Russel l'étole filante est :
soit dans un de ses premiers stades d'évolution dans les constellations;
soit tombée de la position où elle s'était formée et, par suite de réactions nucléaires,
serait dans sa phase finale.
E
ET
TO
OI
IL
LE
E
P
PO
OL
LA
AI
IR
RE
E
Pour encore 150 ans, le pôle céleste N est très près d'une étoile assez brillante
et isolée dans le ciel, Ursac Hinoris (Petite Ourse); il s'en trouve à moins de 1° et va
s'en rapprocher jusqu'à 28°.
Elle est binaire spectroscopique et a un compagnon visuel de 9° graduer à
18".
La polaire est à quelque 300 années de lumière de nous. de magnitude 2.2,
Umi est une variable céphéide (période : 3.97 j; amplitude 0.2 m) de type F8,
supergéante.
E
ET
TO
OI
IL
LE
ES
S
J
JE
EU
UN
NE
ES
S
Elles constituent le disque.
Elles se sont formées à partir du gaz que des étoiles de la 1ère génération ont dispersé
dans l'espace inter-sidéral lorsque, arrivées à l'épuisement de leur réserve de combustible
nucléaire, elles se sont effondrées sur elles-mêmes et dans un rebondissement gigantesque ont
soufflé à l'extérieur une partie de leur atmosphère.
Bleues car plus chaudes.

Formation ABE-CAMPUS
Page n°2

Formation ABE-CAMPUS
Page n°3
E
ET
TO
OI
IL
LE
E
H
HD
D
7
72
21
12
27
7
L'étoile HD 72127 est située à proximité d'un des filaments de la nébuleuse du Voile
qui, comme on le sait, est le reste d'une explosion de supernova. HD 72127 est située à une
distance qui ne dépasse pas 600 parsecs. Il s'agit en fait d'une étoile double, dont les
composants, d'après l'estimation de distance mentionnée ci-dessus, sont séparées d'environ
3000 unités astronomiques.
En 1974, Thackeray a étudié le spectre de HD 72127A et HD 72127B, les deux
composantes de la paire. La raie K du calcium interstellaire apparaissait dans ces spectres,
avec une structure résolue par la suite en cinq composantes distinctes, décalées les unes par
rapport aux autres par effet Doppler, suite à des mouvements différents de diverses parties de
la nébuleuse. De plus, la structure de la raie K observée dans le spectre de HD 72127A
différait de celle de la même raie dans le spectre de HD 72127B. Hobbs, Wallerstein et Hu ont
observé cette étoile en 1981 et ils ont constaté qu'ils ont constaté qu'il y avait alors six
composantes à la raie K du calcium, ce qui signifie qu'une partie du nuage animée d'un
mouvement encore différent passait entre nous et l'étoile.
Ces différentes études mettent en évidence l'inhomogénéité à courte échelle de
distance de la matière interstellaire, et montrent l'intérêt d'une observation suivie des
nébuleuses pour la meilleure compréhension du milieu interstellaire.
E
ET
TO
OI
I
L
E
E
5
51
1
P
PI
IS
SC
CI
IU
UM
M
L'étoile 51 Piscium, de magnitude 5.7, devait subir le 3
janvier 1971 une occultation rasante par la lune.
Néanmoins, au moment de l'observation, l'étoile ne put
être trouvée.
On sait depuis longtemps que 51 Psc est en fait un
système double, dont les deux composantes (de
magnitude 5.7 et 9.7) sont distantes de 28"; depuis
1976, on pense que la primaire est en fait une triple très
serrée (de magnitudes 6.6, 6.9 et 8.8); donc que le
système global est en fait quadruple.
D. Hoffleit, du Yale University Observatory, note
qu'une étude des données antérieures relatives à cette
étoile ne montre aucune variation; de même les
observations ultérieures à 1971 n'ont pas permis
d'observer de changement d'éclat.
Alors ? A l'examen de la courbe de luminosité obtenue
en 1971, deux possibilités subsistent : ou 51 Psc est une
variable irrégulière ou c'est une variable à éclipses. Il

Formation ABE-CAMPUS
Page n°4
est en effet possible, par exemple, qu'avec une période
voisine de cinq and, deux minima ne puissent être
observés que s'ils sont séparés par une dizaine de
cycles, c'est-à-dire 50 ans !
L
LE
ES
S
P
PR
RE
EM
MI
IE
ER
RE
ES
S
P
PH
HA
AS
SE
ES
S
D
DE
E
L
LA
A
F
FO
OR
RM
MA
AT
TI
IO
ON
N
D
D'
'U
UN
NE
E
E
ET
TO
OI
IL
LE
E
Durant la dernière décennie, la recherche pour comprendre
la formation d'une étoile est devenue l'une des plus actives
parmi les recherches qui concernent la Voie Lactée. Il y a
trente ans, beaucoup d'entre nous qui travaillaient sur des
problèmes concernant la Voie Lactée. Il y a trente ans,
beaucoup d'entre nous qui travaillaient dur des problèmes
à la question de la formation des étoiles; il étai apparu que
les processus requis se produiraient probablement dans la
matière interstellaire où des nuages de gaz et de poussières
semblaient alors - et semblent toujours - sur le point de se
contracter en proto-étoiles. En 1947, nous avons tenu un
mini-symposium sur le sujet, dont les résultats furent
publiés dans "Harvard Observaty Monograph n°7" (1948);
il contenait des articles de L. Spitzer, F. Whipple et de
moi-même. Mais il était difficile de faire des progrès car
nous étions limités à essayer nos petits morceaux de
théorie soutenue seulement par des observations optiques
dans une région du spectre allant du violet au proche
infrarouge.
Toutes ces choses ont changé durant les quinze dernières
années. La radio-astronomie nous a permis d'observer 50
variétés de molécules interstellaires. L'astronomie
infrarouge a fait un bon en avant. L'équipement pour le
domaine de longueurs d'onde entre 1 et 10 microns, dans
le proche infrarouge, est maintenant tout à fait prêt pour
découvrir et observer les étoiles jeunes enfoncées dans de
denses nuages opaques et les recherches à 2 microns se
sont montrées particulièrement efficaces. dans l'infrarouge
lointain (100 à 1000 microns), les études du "Kuiper
Airborne Obsevatory" ont révélé bien du nouveau, tant à
propos des plus jeunes étoiles qu'à propos des nuages de
gaz et de poussières au bord de la contraction.
Il y a maintenant un pont ferme connectant des études dans
l'infrarouge très lointain avec celles aux plus courtes
longueurs d'onde. Ces études, combinées avec des
observations spectrographiques d'objets qui étaient
impossibles il y a 10 ans, nous ont donné une image

Formation ABE-CAMPUS
Page n°5
complète et fascinante des conditions physiques et des
processus à l'œuvre dans les nuages de gaz et de
poussières. Nous suspectons ces nuages d'héberger des
proto-étoiles et dans plusieurs cas, nus avons trouvé
quelques très jeunes étoiles.
Les astronomes observant dans les domaines optiques,
radio et infrarouge ont participé à ce rassemblement de
preuves observationnelles. Les astrophysiciens théoriciens
présentent actuellement des modèles basés sur les
observations, pour des nuages de gaz et de poussières qui
semblent être ou bien en état de contraction ou bien à la
veille d'un tel état. Nous connaissons des distances et des
dimensions linéaires pour beaucoup de ces nuages. Leur
masse peut être estimée optiquement à partir de leur
contenu en poussière par radio, ces données peuvent être
tirées des études du monoxyde de carbone, de l'ammoniac
et du formaldéhyde. A partir des observations radio, nous
pouvons aussi déduire le contenu de chaque nuage en
molécules d'hydrogène (H2), cet élément étant le
constituant principal.
Quelques commentaires généraux viennent à l'esprit. Nous
devons rappeler que dans pratiquement tous les procédés
de formation stellaire envisagés, la première étape est la
concentration de matière en nuages individuels d'atomes et
de molécules (les espèces d'hydrogène sont en tête de
liste). Beaucoup de ces nuages contiennent en proportions
faibles mais non insignifiantes des mélanges de poussières
cosmiques. Certains de ces éléments sont très complexes.
Par exemple, nous verrons que de très grands nuages de
molécules peuvent avoir des masses équivalant à plusieurs
centaines de milliers de masses solaires. Mais nous
observons aussi de très petits nuages : les globules, par
exemple, qui ont des masses qui n'excèdent pas 20 masses
solaires. Tout ce que ces nuages ont en commun est qu'ils
devraient se contracter, principalement sous l'effet de leur
propre gravitation avec probablement une poussée due à
des pressions extérieures.
 6
6
 7
7
1
/
7
100%