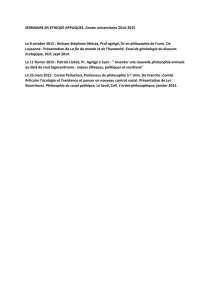3.1.2. Les questions d`ordre évaluatif

PHIPOL1314.01.Intro 1
Université de Namur Namur John Pitseys
Louvain-la-Neuve/ 2016-2017
Philosophie sociale et politique
Qu’est-ce que la philosophie sociale et politique ?
Pour comprendre ce qu’est la philosophie sociale et politique, il faut répondre à trois
questions.
1. Qu’est-ce que la philosophie ?
2. En quoi consiste la dimension sociale et la dimension politique de
l’existence humaine ?
3. Qu’est-ce que la philosophie sociale et politique peut nous dire sur cette
dimension sociale et politique ? En quoi son approche se distingue-t-elle
des /s’articule-t-elle aux approches scientifiques ?
1. Qu’est-ce que la philosophie ?
Etymologie
Le mot “philosophie” vient du grec ancien “philosophia”. On rencontre aussi
l’adjectif “philosophos” (philosophe) et le verbe “philosophein” (philosopher). Ces
mots apparaissent, selon toute vraisemblance, au Ve s. av. JC. C’est le siècle de Périclès,
celui où la cité-Etat d’Athènes domine politiquement et économiquement le monde grec
et y rayonne intellectuellement et culturellement. Le mot “philosophos” (“philosophoï”
au pluriel) est alors utilisé pour désigner des hommes qui, au VIe s. et au Ve s.,
développèrent une manière de penser que l’on considère alors comme nouvelle et qui va
profondément marquer notre culture occidentale. Le plus célèbre est Socrate (470-399).
Il va devenir la figure emblématique du philosophe. Mais il est d’autres philosophes,
moins connus, qui précèdent Socrate et que l’on qualifie, pour cette raison, de
présocratiques.
“Philosophia” et ses dérivés sont forgés à partir de deux autres mots: “philein” (=
aimer, avoir un penchant pour) et ”sophia” (sagesse). Le philosophos est donc celui qui
recherche la sagesse.
La découverte de la raison
Le mot “sagesse” a, comme le mot “sophia” en grec ancien, un double sens. Il
renvoie à l’idée d’une perfection morale dans la manière de vivre : le sage est celui qui
mène une vie exemplaire (Gandhi était un sage). Le mot “sagesse” renvoie aussi à l’idée
de connaissance : le sage, c’est celui qui sait, qui a une connaissance des choses, au
moins des choses les plus fondamentales. Le mot grec “sophos” signifie donc à la fois
“sage” et “savant”. Les deux significations du mot, moral et cognitif, sont étroitement
liées. Ce n’est pas un hasard. Car les premiers philosophes sont précisément des gens
qui considèrent que l’accès à la perfection humaine passe par la connaissance acquise
par la raison. Pour ces philosophes, la connaissance rationnelle est fondamentalement
nécessaire à l’être humain pour qu’il puisse devenir meilleur, pour qu’il puisse bien
vivre (eudaïmonia = vie bonne). La perfection humaine passe par la quête du vrai
savoir. C’est cette conviction qui va animer la vie et la pensée de ceux que les Grecs
vont appeler les “philosophoï” (sur ces origines, voy. notamment Châtelet 1992).

PHIPOL1314.01.Intro 2
La naissance de la philosophie procède ainsi d’une découverte : celle de la raison
(logos). L’être humain dispose d’une faculté de raisonner qui lui permet de comprendre
la signification et d’éprouver la valeur des idées relatives à l’ordre du monde, au sens de
l’existence, et à l’ordre socio-politique. Cette faculté se manifeste dans langage, lequel
n’est pas simplement un instrument de communication mais un moyen de toucher l’être
même des choses. Toute réflexion philosophique procède de cette découverte de la
raison, de son pouvoir, mais aussi de ses limites.
C’est là tout le sens de la démarche de Socrate : il va questionnant ses contemporains
sur le sens de la vie bonne afin de les amener à user de leur faculté de penser et de
raisonner pour trouver par eux-mêmes la réponse à la question « comment dois-je
conduire ma vie ? » (Cf. les dialogues de Platon).
Philosophie et sciences
Il est vrai que la démarche qui consiste à mettre à l’épreuve de manière systématique
des croyances, des affirmations ou des opinions est aussi caractéristique des sciences.
Or, nous distinguons la philosophie et les sciences, alors que les Grecs de l’antiquité ne
faisaient pas cette différence. Pour eux, la science (au singulier) devait procurer une
connaissance englobante de l’ordre du cosmos laquelle est source de sagesse, de
perfection intérieure, puisqu’elle permet de mettre en phase l’expérience intérieure avec
l’ordre des choses.
Mais à partir de l’époque moderne, avec l’avènement de la physique newtonienne, on
voit émerger une différenciation progressive entre la démarche scientifique à visée
explicative et s’appuyant sur une méthode empirique et la démarche philosophique à
visée éthique et s’appuyant sur une méthode réflexive, c’est-à-dire sur une élucidation
des présupposés de nos expériences, croyances et opinions. Cette démarche est bien une
démarche intellectuelle, rationnelle. Mais elle n’est pas du même ordre que la démarche
scientifique.
D’une part, la raison scientifique s’autonomise : elle développe des protocoles et des
méthodes propres. D’autre part, la philosophie conduit à aborder des questions
fondamentales, que la raison scientifique ne semble pouvoir traiter. Selon Emmanuel
Kant (1724-1804), qui fut un des premiers philosophes à prendre acte de cette
séparation entre sciences et philosophie, les questions philosophiques se ramènent à
celles-ci :
Que puis-je connaître ?
Que dois-je faire ?
Que m’est-il permis d’espérer ?
Qu’est-ce que l’homme ?
Pour tenter de cerner l’objet de la philosophie sociale et politique et en même temps
illustrer la démarche philosophique, nous pouvons partir de cette dernière question.
2. L’homme : un animal social et un animal politique.
Un animal social
Les êtres humains vivent en société. Cela ne signifie pas simplement qu’ils ont des
relations avec certains de leurs semblables. Cela ne signifie pas simplement qu’ils
vivent en groupe. Cela signifie avant tout que les rapports qu’ils ont entre eux sont

PHIPOL1314.01.Intro 3
structurés par des institutions (l’école, l’entreprise, l’hôpital, la famille, la sécurité
sociale, etc.) qui forment système et qui assignent des rôles. On entend par institution
sociale, une réalité sociale, propre à une société ou à un groupe, relativement autonome,
stable ou régulière, contraignant les individus par des règles et ayant une fonction
sociale spécifique.
Un rapport social est donc différent d’une relation interpersonnelle. Dans la simple
relation interpersonnelle, l’autre m’apparaît comme une personne singulière que je
rencontre et qui a un visage. En revanche, dans un rapport social, l’autre m’apparaît
comme un socius, qui a un statut, un rôle social. Distinguant le prochain et le socius, P.
Ricœur écrit: “le socius, c’est celui que j’atteins à travers sa fonction sociale; la relation
au socius est une relation médiate; elle atteint l’homme en tant que...”
1
. C’est ainsi que
je puis avoir un rapport social avec un individu sans avoir de relation interpersonnelle
avec lui. En tant que salarié, je cotise à la sécurité sociale et j’entre ainsi dans un rapport
avec toutes les personnes qui cotisent et sont assurées par la sécurité sociale comme
institution. Mais il est évident que je n’ai pas de relations personnelles avec la plupart
de ces individus et, si j’en ai éventuellement, ces relations n’ont rien à voir avec notre
affiliation à la sécurité sociale. La solidarité sociale ainsi instituée n’est pas réductible à
un lien de sympathie interpersonnelle. Une société est donc toujours donc plus qu’un
ensemble d’individus.
Un animal politique
L’expression est d’Aristote (384-324 av. JC). En quoi l’homme est-il un animal
politique ?
Une première réponse, qui semble à première vue la plus évidente, consisterait à
considérer le politique comme un sous-ensemble du social. Parmi les institutions qui
règlent les rapports entre les hommes, il y en a d’une espèce particulière : les
institutions politiques, institutions qui forment un système que l’on a pris coutume
d’appeler « Etat » dans les sociétés modernes. On pourrait ainsi étudier les institutions
politiques comme on étudie d’autres types d’institutions (scolaires, économiques,
religieuses, etc.).
Pourtant, on aurait tort de réduire la politique à des institutions ou au fonctionnement
de l’Etat. La politique peut aussi, et avant tout, se caractériser par des pratiques. Celles
de l’Etat bien sûr, mais aussi celle des citoyens. Car l’Etat lui-même n’est qu’un
instrument au moyen duquel les êtres humains visent à agir de manière collective sur
leurs conditions sociales d’existence. On peut donc définir la politique (certains diront
plutôt « le politique ») par les pratiques par lesquelles des êtres humains visent à agir de
manière concertée sur leurs conditions sociales d’existence. Ces pratiques s’opèrent le
plus souvent, mais pas toujours, dans le cadre d’institutions politiques qui sont censées
être des moyens au service de cette action. La politique c’est donc l’action délibérée sur
le social, la pratique auto-instituante de la société.
3. Qu’est-ce que la philosophie politique ?
3.1. La vie sociale et l’agir politique en questions
La vie sociale et l’agir politique nous confrontent à des questions. Nous pouvons
faire appel à notre intelligence, à notre raison, pour tenter d’y répondre de manière
adéquate. On peut distinguer différents types de question. Selon le type de la question,
1
P. RICŒUR, Histoire et vérité, Paris, Seuil, 1955, p. 102.

PHIPOL1314.01.Intro 4
la démarche rationnelle pour la traiter sera différente, tantôt scientifique tantôt
philosophique.
3.1.1. Les questions d’ordre cognitif
Ces questions se rapportent à la description, la compréhension et à l’explication des
phénomènes sociaux et de pratiques politiques.
Quelle est l’ampleur du chômage en Région wallonne ?
Quel sens et quelle valeur les chômeurs attribuent-ils au travail ?
Pourquoi le taux de chômage est-il plus élevé en Wallonie qu’en Flandre ?
Quelle est la part d’enfants d’ouvriers à l’université ?
Pourquoi les enfants venant de milieux défavorisés accèdent-ils moins souvent à
l’université ?
Qui sont les électeurs de l’extrême-droite ?
Quelles représentations les électeurs d’extrême droite ont-ils des étrangers ?
Pourquoi l’extrême-droite a-t-elle augmenté significativement son électorat ?
Nous pouvons avoir des opinions spontanées sur les réponses à ces questions. Et les
opinions des uns peuvent parfois être différentes de celles des autres. L’ambition des
sciences sociales - sociologie, économie, science politique, psychologie sociale, etc. -
est d’apporter à ce type de questions des réponses aussi objectives que possibles, car
mises à l’épreuve de manière rigoureuse et systématique. Cette mise à l’épreuve
s’appuie sur des méthodes d’observation des phénomènes et d’analyse de ces
observations. Ces méthodes exigent le recours à des concepts, qui proviennent de cadres
théoriques (qui peuvent être plus ou moins élaborés). Ainsi pour décrire l’ampleur du
chômage on le mesurera par rapport au volume de la population active, concept qui a un
sens bien précis en économie : l'ensemble des personnes en âge de travailler qui sont
disponibles sur le marché du travail, qu'elles aient un emploi (population active
occupée) ou qu'elles soient au chômage (population active inoccupée). De même, pour
expliquer son évolution en recourra aux concepts d’offre et de demande de main
d’œuvre, considérant qu’il y a un ‘marché du travail’.
On distingue communément trois visées pour les sciences sociales : décrire- -
comprendre-expliquer. La visée ultime est l’explication.
Décrire
La démarche scientifique vise d’abord à rendre compte de manière systématique de
phénomènes. Cette description n’est toutefois jamais le fruit d’une observation ‘pure’ et
spontanée car elle fait usage de concepts qui ‘encadrent’ et structurent l’observation.
Ex. en démographie : description d’une population et de ses évolutions au
moyens de concepts tels que : taux de natalité, espérance de vie, taux d’activité,
solde migratoire, etc.
Comprendre
La compréhension scientifique vise à rendre compte du sens (signification) que des
acteurs donnent à tel ou tel aspect de la vie sociale. Elle repose sur une interprétation
(herméneutique) des significations que les acteurs attribuent intuitivement à des actes, à
des événements, à des paroles, à des règles, etc. et sur une mise en synthèse
(globalisation) de ces significations.

PHIPOL1314.01.Intro 5
Ex. en sociologie: compréhension de la signification et de la valeur que les
jeunes donnent aujourd’hui au mariage. En quoi cette signification est-elle
différente de celle que lui donnaient leurs parents ?
Expliquer
L’explication vise à démontrer qu’un fait découle d’un (de plusieurs) autre(s) fait(s)
en vertu d’une loi ou d’une théorie. Elle suppose souvent un travail de généralisation,
l’élaboration de lois voire de théories.
Sous sa forme la plus élémentaire, l’explication scientifique peut souvent être
schématisée dans un syllogisme (syllogisme explicatif).
Ex. en économie :
Conditions initiales
La demande de pétrole a baissé au cours des
derniers mois. La production est restée
constante
Loi
Loi de l’offre et de la demande : lorsque la
demande baisse par rapport à l’offre, les prix
baissent.
Fait à expliquer
(explicandum)
Le prix du baril de pétrole a baissé au cours des
derniers mois.
L’explication scientifique peut se focaliser
tantôt sur l’identification des conditions initiales ;
tantôt sur la formulation d’une loi/théorie scientifique.
Une théorie est « …un ensemble de propositions logiquement reliées, encadrant un
plus ou moins grand nombre de faits observés et formant un réseau de généralisations
dont on peut dériver des explications pour un certain nombre de phénomènes… »
(Gingras, cité par Giroux 1998, pp. 11-12).
On notera toutefois que toute explication scientifique ne prend pas nécessairement la
forme d’un syllogisme explicatif. C’est notamment le cas en sciences sociales, où les
causes ou déterminants d’un phénomène peuvent être multiples et complexes. Quoiqu’il
en soit, la visée explicative suppose la mise en relation de faits ou variables. Et une
explication ne pourra toutefois être considérée comme scientifique que si elle fait l’objet
d’un processus objectif et méthodique de validation au moyen d’observations précises
et, autant que possible, réitérables.
La vie en société et la pratique politique ne suscitent pas que des questions d’ordre
cognitif (décrire, comprendre, expliquer). Elle soulèvent au moins deux autres types de
questions : d’ordre évaluatif et d’ordre normatif. Pour traiter de ces questions de
manière rigoureuse, il est indispensable de se tourner vers la philosophie.
3.1.2. Les questions d’ordre évaluatif
Il s’agit de questions se rapportant au caractère désirable ou indésirable, appréciable
ou non, de certains aspects de la vie sociale ou politique. En effet, nous avons
spontanément tendance à poser des jugements de valeur sur le monde social et politique.
Le chômage est un fléau social
Notre enseignement universitaire est trop élitiste
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%