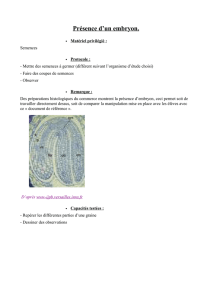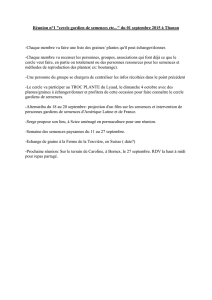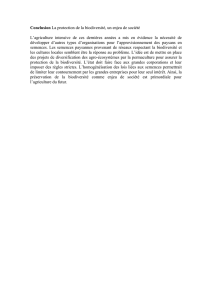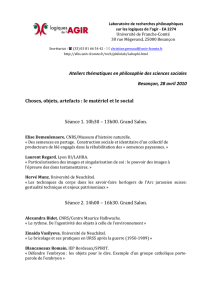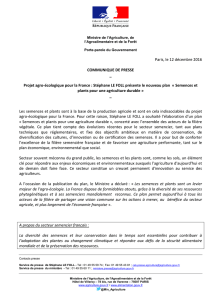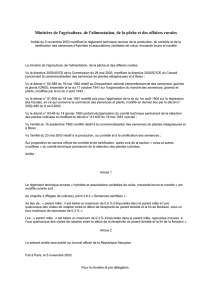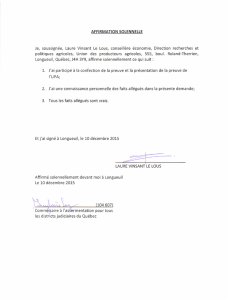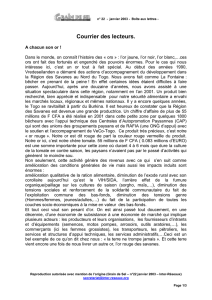En quoi et comment les brevets sur les semences mettent

En quoi et comment les brevets sur les semences mettent-
ils « en danger » l’Agriculture du Sud ?
Je ne comprends pas, à la lecture de Grain de Sel N° 28 Septembre 2004 ( p.
32 et 33), en quoi le brevetage des semences mettrait en péril l’agriculture du Sud.
Selon moi, le problème réside plutôt dans la faible qualité technique et génétique des
semences pour ces agricultures et la faiblesse des moyens consacrés à la recherche
génétique dans ces zones.
Petit rappel historique.
Depuis les débuts de l’agriculture (il y a quelques 5 000 ans), l’Homme a été
confronté au problème de la mauvaise qualité des semences qui lui sont fournies
spontanément par la nature, dés lors qu’il a commencé à semer pour cultiver. Il y a,
pour développer la production agricole, beaucoup de gènes intéressants dans les
éco-systémes au niveau des différentes plantes qui existent à l’état spontané, mais
en général ces gènes sont mal combinés et l’Homme s’est aperçu qu’il pouvait mieux
faire que l’existant. Bien sur des plantes ont été identifiées depuis longtemps pour
leurs qualités spécifiques. Mais ce n’est pas suffisant : l’homme a donc du se lancer
dans un travail patient de sélection pour obtenir de « bonnes » combinaisons
génétiques et pouvoir se nourrir correctement : c’est toute l’histoire des progrès de
l’agriculture au travers de la sélection génétique. Il a même fini par créer des
espèces de toute pièce ou même modifier tellement des espèces qu’elles sont
devenues totalement dépendantes de l’homme pour continuer à se reproduire (cf.
travail des Mayas sur le maïs).
Nous passerons rapidement sur les différentes techniques utilisées pour
parvenir à cet objectif, mais indiquons qu’elles sont devenues de plus en plus
sophistiquées au cours des siècles. On est ainsi passé de populations plus ou moins
fixées à des variétés améliorées et fixées. Puis la génétique est devenue une
science et la sélection est passée des agriculteurs ou des communautés rurales aux
chercheurs : c’est ce que nous avons connu au cours des deux derniers siècles avec
le passage d’une approche empirique à la démarche scientifique de la génétique.
Deux types de recherche sont maintenant en concurrence autour des
semences :
Une recherche publique (les centres de recherche agronomique)
financée par les Etats,
Une recherche privée, souvent initiée par des agriculteurs imaginatifs
(souvenons nous de VILMORIN) et passionnés, et qui est passée
récemment en grande partie sous contrôle de l’agro pharmacie (cf.
prise de contrôle de PIONNEER par DUPONT DE NEMOURS).

Qui parle de recherche parle de coût. Publique ou privée, la recherche de
nouvelles variétés mobilise des capitaux. Et donc pose la question : comment la
financer ?
Dans le cas de la recherche publique, c’est l’Etat, donc le contribuable (qui est
quelqu’un qu’il faut bien nourrir), qui s’en charge (ce n’est pas illogique).
Dans le cas de la recherche privée, c’est nécessairement l’acheteur qui paye
en achetant la semence. Tout le monde trouve cela logique quand il achète un bien
industriel ; alors pourquoi pas pour les semences ?
Dans le cas de la semence, c’est plus compliqué, puisque obtenue par les
voies « naturelles » une semence, une fois « fixée », devient reproductible par
l’acheteur sans perdre trop de qualités sur 2 ou 3 générations (au moins pour les
plantes autogames). Quand on achète une semence à un établissement semencier,
on achète ainsi un génome, et de la recherche. On comprend le risque économique
que prend le semencier en vendant ses semences : celui de ne pas retrouver l’argent
investi dans le produit. Et on comprend que pendant longtemps cette recherche
privée ait été l’apanage de PME familiales ou de société d’agriculteurs, tant les
marges étaient faibles.
Donc, problème pour les entreprises semencières privées : comment faire
rémunérer leur recherche ? Avec des garanties juridiques (COV en France, puis en
Europe qui a adopté la législation française ; marques et brevets aux Etats-Unis).
Mais cela protége de la concurrence des autres semenciers, cela n’empêche pas la
multiplication à la ferme d’où la faible profitabilité de l’industrie semencière jusqu’au
milieu du XXiéme siècle.
C’est alors qu’arrivèrent les hybrides au milieu du siècle dernier. Les
semenciers privés firent un grand pas en avant pour garantir leurs profits. Grâce à
cette technique, mise au point sur le maïs où c’était le plus facile, les semenciers
résolvaient la quadrature du cercle : proposer des variétés apportant des gains
significatifs de productivité aux agriculteurs, et empêcher l’agriculteur de s’approprier
le génome de la variété hybride obtenue par la recherche dés lors que les
descendants de l’hybride perdent les qualités des parents. Les semenciers peuvent
ainsi rémunérer leurs efforts de recherche. L’agriculteur paye sa semence beaucoup
plus cher et chaque fois qu’il implante sa culture ; il ne peut pas ressemer les
descendants de l’hybride qu’il a acheté ; mais l’achat de la semence lui coûte
toujours moins cher que l’augmentation de ses marges qui en résulte : ce n’est pas
« exorbitant », car si il en était ainsi, l’agriculteur n’achèterait pas, car, en général, il
sait compter… Le succès de la formule a été explosif et depuis plus de cinquante ans
les agriculteurs du Nord achètent des semences hybrides qu’ils ne peuvent pas
ressemer.
Le cas le plus significatif pour le grand public, c’est celui du Tournesol,
emblème des Verts, et dont la culture a pu être relancée au début des années 80,
car à la mise au point d’une technique d’hybridation très sophistiquée et l’introduction
de gènes de résistance au mildiou…

Ainsi les agriculteurs du monde entier ont le choix entre quatre types de
semences :
Des graines de ferme autoproduites sur l’exploitation par l’agriculteur
comme bon lui semble, car aucune loi ne peut l’en empêcher : il
faudrait mettre un gendarme sur chaque exploitation agricole. Il peut
même réaliser ses propres sélections, s’il en a envie.
Des semences de populations plus ou moins fixées, vendues les moins
chers mais avec un faible potentiel productif.
Des semences classiques pour des variétés sélectionnées et fixées, et
achetées à des sociétés semencières. Pour les céréales autogames,
comme le blé,l’orge ou le riz, c’est le type dominant car la recherche
privée n’a toujours pas réussi à apporter des augmentations
significatives de rendement avec des variétés hybrides (il faut dire que
l’homme travaille depuis 5000 ans sur l’amélioration variétale du blé…).
Ces semences sont proposées tantôt par des sociétés privées, tantôt
par des instituts publics.
Des semences hybrides (maïs, tournesol, colza, légumes, etc.…)
fournies elles aussi par des sociétés semencières, mais beaucoup plus
cher et beaucoup plus performantes. Elles sont proposées uniquement
par des sociétés privées comme PIONNEER, MONSANTO (ou parfois
coopératives, cf. COOP de PAU ou LIMAGRAIN).
Ajoutons que pour les espèces qui peuvent se reproduire par voie non sexuée
(arboriculture, viticulture, autres pérennes), la sélection est restée l’apanage du
secteur public ou de petites sociétés privées : aucun contrôle de la multiplication à la
ferme n’est possible.
Et les OGM ? Ils sont à rattacher à la quatrième catégorie, puisqu’il s’agit
simplement de techniques de sélection plus sophistiquées, mais qui n’induisent pas
de modifications significatives par rapport aux hybrides cultivés sans problèmes
depuis plus de 50 ans à la satisfaction générale. La question se complique dans le
cas de plantes autogames comme le Soya où les techniques d’hybridation semblent
plus difficiles à mettre en œuvre et où les firmes recherchent des solutions juridiques
(le brevet) ou techniques (stérilité des graines produites) pour garantir le financement
de leur investissement.
Le vrai débat.
Ainsi le constat selon lequel « les paysans se voient interdire de replanter,
d’échanger ou de vendre des semences issues de leurs récoltes, puisqu’une
variété ne peut être reproduite librement » est une réalité à laquelle sont
confrontés depuis plus de 50 ans les paysans qui utilisent des hybrides, puisque
c’est cet artifice technique qui empêche de reproduire la semence achetée. Mais
personne n’est obligé d’aller acheter un hybride ou un OGM : il dispose des
semences ouvertes de la recherche publique ou des semences de populations.
Il est faux de dire que dans les pays développés « les organisations
paysannes militent pour que la pratique du recours aux semences de ferme,

qui est en outre favorable à la conservation de la biodiversité, soit reconnue et
maintenue ».
En effet, le débat sur les « graines de ferme » dans les pays développés,
porte sur la reproduction des semences de variétés classiques issues de la
recherche privée. Il est porté par deux organisations : la Coordination Rurale et la
Confédération Paysanne et porte sur le refus de paiement de royalties sur des
variétés classiques de 2éme ou 3éme génération qui sont commercialisées sous
couvert de « triage à façon ». Débat particulièrement abscons, mais qui n’a rien à
voir avec la biodiversité : puisqu’il s’agit de piratage de variétés obtenues par des
sociétés patentées. Mais après tout personne n’empêche José BOVE ou le CIRAD
de proposer des semences en freeware, aucune loi ne s’y oppose ! A quand un
LINUX des plantes ? Mais, je ne vois pas en quoi le piratage des obtentions de la
recherche privée est favorable à la biodiversité ! C’est comme si la revente de CD
piratés était favorable à la créativité artistique musicale ! Il s’agit plutôt de vouloir « le
beurre et l’argent du beurre » et de bénéficier gratuitement des efforts de la
recherche. Mais jusqu’à preuve du contraire, il est strictement impossible de
s’opposer à l’utilisation et à la reproduction des variétés traditionnelles issues de la
sélection empirique des agriculteurs eux-mêmes au cours des siècles passés.
Le vrai débat c’est la place de la recherche publique dans la production
semencière mondiale et l’abandon de pans entiers de cette production au secteur
privé. On peut en effet imaginer un autre mode de développement semencier
reposant sur la recherche publique et dans lequel le coût de cette recherche est
financé par l’impôt, ce qui donnerait un autre pouvoir aux Etats dans l’orientation de
la production agricole.
La défense de la biodiversité ce n’est pas conserver et cultiver toutes les
plantes existantes telles quelles et s’opposer à toute sélection, mais conserver le
stock de gènes disponible sur la planète toutes espèces confondues (et qui
appartient au patrimoine commun de l’humanité) pour pouvoir l’inclure dans des
recombinaisons utiles au progrès de l’humanité. Défendre la biodiversité, ce n’est
pas défendre un statu quo et s’opposer à toute sélection végétale (ou animale) !
Et les PED ?
Ce qui caractérise les PED, c’est que « les 1,5 milliards de personnes » qui
n’accèdent pas aux semences sélectionnées disposent d’un matériel génétique de
mauvaise ou très mauvaise qualité (taux de germination, potentiel génétique,
adaptation, longueur de cycles, etc.), que c’est là un des facteurs principaux de la
sous productivité de ces zones et que les firmes privées ne s’intéressent que
marginalement à ce marché.
Ecrire que « prés de 90% des semences de cultures alimentaires de base
utilisés dans les PED sont des semences de ferme. Ainsi les brevets menacent
l’autonomie des paysans en semences et en matériel végétal indispensable
pour la sécurité alimentaire », c’est faire fi du fait que le problème est précisément
cette utilisation massive de graines de ferme de mauvaise qualité. Veut-on enfermer
les paysans des PED dans des réserves les excluant du progrès génétique ? Il n’y a

pas d’EDEN précolonial, ni de retour aux Jardin des Hespérides. Ce qui menace
l’agriculture du Sud, ce ne sont pas les brevets sur les gènes, c’est la faiblesse du
potentiel génétique des semences auxquels cette agriculture a accès.
L’avenir des agricultures du Sud passe aussi par le progrès génétique et non
par un retour à un passé mythifié. Le débat est là aussi recherche publique ou
recherche privée, pour mettre à disposition des paysans des PED des semences de
qualité. La question c’est les moyens donnés aux recherches publiques des PED,
comme l’ADRAO, pour élaborer des matériels génétiques adaptés aux situations
locales, plutôt que de s’intéresser aux discussions de l’ADPIC, qui sont des débats
NORD/NORD, entre semenciers. Car, ce ne sont pas non plus les brevets sur les
semences qui feront progresser les agricultures du SUD !
Jacques MAUBUISSON
CT auprès du Centre d’Appui aux OPA de Guinée Forestière.
Agriculteur multiplicateur de semences à Castelnaudary (Aude).
1
/
5
100%