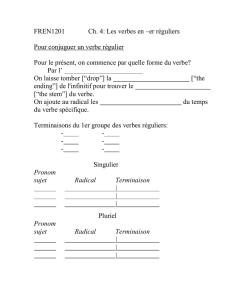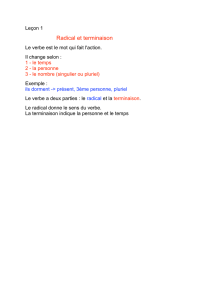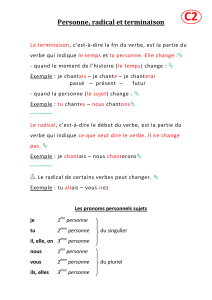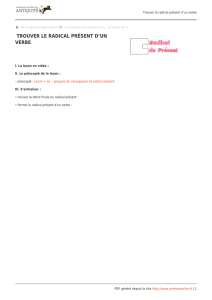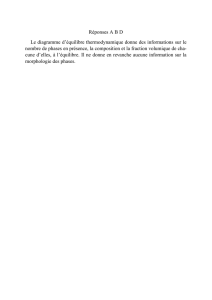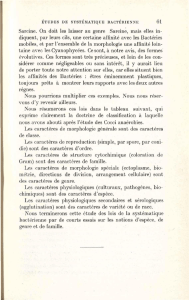Flexion - Université Paris Ouest

Deuxième journée du séminaire thématique
de formation doctorale
en Sciences du langage (1er avril 2005)
Thématique : Morphologie
La journée s’est organisée selon les trois axes :
1. Présentation de l’évolution de la morphologie dans ces trente dernières
années et plus particulièrement de la conception de Marc Aronoff, considérée
comme fondamentale (Françoise Kerleroux), illustrée par l’exemple concret de
la flexion en temps-personne-nombre en français (Olivier Bonami et Gilles
Boyé).
2. Présentation de l’état présent d’une recherche originale (Marc Plénat).
3. Présentation de sa recherche en cours par une doctorante (Françoise Nore).
1. Présentation de la Morphologie contemporaine
[Exemplier I]
Françoise Kerleroux rappelle que la seconde partie du XXe siècle voit se
(re)fonder la morphologie (à partir des années soixante-dix), dans le cadre de la
grammaire générative (F. Dell, P.H. Matthews, M. Aronoff) et à partir des années
quatre-vingt avec la description exhaustive de la morphologie d’une langue (G. Booij,
S. Scalise, D. Corbin). Deux synthèses font le point sur l’ensemble de ces
recherches (S.R. Anderson et I. Mel’cuk). Voir les références en 1. dans l’exemplier
ci-après.
La position de M. Aronoff est fondatrice en ce qu’il constitue la morphologie
comme un domaine propre, autonome (son livre de 1994 s’intitule Morphology by
itself) et donc définit la théorie et les outils conceptuels permettant de rendre compte
du morphologique indépendamment de la phonologie et de la syntaxe. Contre le
point de vue « réductionniste », il montre qu’il y a du morphologique que l’on ne peut
pas réduire à la phonologie ou à de la syntaxe ; ainsi l’alternance flexionnelle peut se
marquer par un contraste accentuel : dans une langue des Philippines, si on
accentue le second /a/ de /anak/, on a le mot enfant au singulier, si on accentue le
premier /a/ de /anak/, on a le mot enfant au pluriel) ; il en va de même de
l’appartenance catégorielle : en anglais, dans export, si on accentue le e, on a le
nom, si on accentue le o, on a le verbe (premier tableau de la partie 3 dans
l’exemplier ci-après).
Deuxième exemple : un changement vocalique est marqueur de changement
morphologique ; c’est le cas, pour la flexion, en allemand ou en anglais (sing, sang,
sung), ou, pour la dérivation, de paires nom/verbe telles que ziehen/zug en allemand,
d’emplois intransitif/transitif tels que lay/lie en anglais (deuxième tableau de la partie
3 dans l’exemplier).
Troisième exemple : la réduplication permet de former des mots par flexion, le
grec ancien forme le parfait en doublant la première consonne du verbe, et en la

2
faisant suivre toujours de la même voyelle e : pai (futur) pe-pai (parfait) ; en latin,
c’est la première syllabe du verbe qui est doublée : curro (je cours), cucurri (j’ai
couru). Pour la dérivation, le français connaît ce mode de formation de mots :
fille/fifille (troisième tableau de la partie 3 dans l’exemplier).
Le procédé de l’affixation nous est plus familier : par exemple suffixe pour la
flexion des verbes (finit, finira, finiront) et préfixe pour la dérivation d’un verbe à partir
d’un autre verbe par exemple : faire/défaire/refaire (quatrième tableau de la partie 3
dans l’exemplier).
[Exemplier II]
Olivier Bonami et Gilles Boyé
L’expression du temps-aspect-mode (TAM) est morphologique en français
(tableau 3 de l’exemplier), mais ce n’est pas le cas dans toutes les langues : elle est
syntaxique en indonésien (tableau 4 dans l’exemplier) où le verbe n’est pas
conjugué ; si l’on veut spécifier le temps, on ajoute un mot : il s’agit bien d’un mot
autonome (donc d’un procédé syntaxique) puisque l’on peut par exemple insérer un
adverbe entre lui et le verbe. On a le cas en français avec ce que l’on appelle
traditionnellement les « périphrases verbales » : dans va partir, le verbe partir n’est
pas conjugué et le futur est exprimé par va (mot autonome puisqu’on peut le séparer
du verbe : va sans doute partir) ; l’impossibilité de formes telles que * ira partir résulte
d’un conflit entre syntaxe (le verbe, autonome, se conjugue à tous les temps) et
morphologie (le verbe marque ici le futur proche) : tableau 5 de l’exemplier. La
syntaxe construit aussi les temps composés en français : j’ai fait, j’ai peut-être fait, j’ai
peut-être parfois fait (tableau 6 de l’exemplier).
On peut alors se demander si la syntaxe peut construire les lexèmes : ce n’est
pas le cas des mots composés, malgré les apparences (ouvre-boîte : il ouvre les
boîtes) puisqu’il n’y a pas d’insertion possible (*ouvre-rapidement-boîte) donc ouvre-
boîte se comporte comme défaire (* dé-rapidement-faire). Ce n’est pas non plus le
cas des expressions figées : prendre une veste forme sémantiquement un seul mot
(« échouer ») et se prête à des manipulations syntaxiques (le verbe se conjugue, on
peut modifier le nom par un adjectif, changer l’article, cf. tableau 7 de l’exemplier)
mais la formation n’est pas productive, contrairement à ce qui se passe en allemand
(tableaux 8-9).
En tout état de cause, la flexion verbale en français relève de la morphologie ;
quel est le système des radicaux ? On a en effet des verbes à un radical tout au long
de la conjugaison (« 1er groupe » de type laver), mais aussi à deux radicaux (« 2ème
groupe » de type finir : fini- et finiss-, voir tableau 11) et plus (mourir, voir tableau 13).
Si l’on essaie de trouver une règle à la répartition, on voit par exemple que, pour finir,
le passé simple, le futur, le subjonctif imparfait et le conditionnel ont le même radical,
mais quel est le lien entre eux et avec les trois premières personnes du présent ? De
même, l’imparfait et le subjonctif présent ont le même radical, mais quel est le lien
entre eux, et avec les trois dernières personnes du présent ? Il n’est pas commode
de construire une classe morphosyntaxique claire expliquant la répartition des
radicaux (tableau 12).
A fortiori si l’on compare avec celle de mourir (tableau 13) : ici, l’imparfait est
homogène et le radical correspond aux deux premières personnes du pluriel du
présent (comme pour finir) mais la 3ème personne du pluriel de mourir au présent n’a
pas le même radical, contrairement à finir.

3
Le passé simple n’est plus sur la même base que les trois premières
personnes du présent, ni le futur qui, de ce fait, s’oppose ici au subjonctif présent,
etc. (tableau 14).
Est-ce à dire qu’il n’y a pas de système, et que donc l’enfant devrait pour
chaque verbe apprendre le micro-système particulier de la répartition des radicaux ?
La solution est de raisonner par espaces « thématiques » (on admet
terminologiquement que thème = radical) c’est-à-dire par ensembles de thèmes (ou
radicaux) : soit le radical 1, sauf indication contraire on admet que le radical 2 est le
même (« par défaut, le radical 1 est identique au radical 2 », cf. le tableau 21 de
l’exemplier) : lav-, lav- ou finis-, finis-. Pour mourir, le radical 3 est identique au
radical 2. Le micro-système est à présenter selon les règles par défaut (ainsi pour
finir, le radical 1 est finis- et non fini-, contrairement à la présentation traditionnelle
reprise dans le tableau 11.
La notion d’ « espace thématique » est utile dans d’autres cas que les verbes,
pour les règles de construction de lexèmes (RCL) tels que les adjectifs dérivés de
verbes (tableau 23) et pour les formes des adjectifs au masculin, au féminin et à la
liaison (tableau 24) : trois formes sont possibles a priori, la forme qui apparaît à la
liaison ne correspondant systématiquement ni au masculin (petit ami), ni au féminin
(fort accent) ; si on les énumère dans l’ordre : radical 1 = féminin, radical 2 =
masculin, radical 3 = forme de la liaison, on peut établir une règle (tableau 24).
[Retour à l’exemplier I : point 3 = Un lexème / plusieurs constructions]
Françoise Kerleroux développe trois exemples montrant que la formation de dérivés
obéit à une sélection dans les acceptions d’un lexème polysémique ; on observe par
exemple que l’apocope (= abréviation) ne concerne pas tous les emplois d’un mot
(1er cas de l’exemplier) : la manifestation de la vérité / * la manif de la vérité ≠ la
manifestation des cheminots / la manif des cheminots) ; de même la construction des
noms en –eur (2ème cas de l’exemplier) n’est pas possible pour tous les emplois du
verbe correspondant (Max tombe les femmes facilement : c’est un tombeur ≠ Max
tombe souvent : * c’est un tombeur) ; il en va de même des noms véhiculant l’idée
verbale (3ème cas de l’exemplier) : dans présenter sa fiancée à ses parents, le sujet
est un « agent » (il accomplit une action) et l’on peut dire la présentation de sa
fiancée à ses parents, mais dans le moteur présente une anomalie, le sujet est le lieu
(le « site ») où se trouve l’anomalie et le verbe exprime une relation d’inclusion (le
moteur a / comporte / renferme / inclut une anomalie), et l’on ne peut pas dire * la
présentation d’une anomalie par le moteur.
Correspondant au programme de cette première partie de la journée, on peut
lire les contributions de Françoise Kerleroux et Olivier Bonami & Gilles Boyé dans
Langages 152 : Quoi de neuf en morphologie ?, Paris, Larousse, 2003.
Danielle Leeman

4
EXEMPLIER 1
1° avril 2005 : Journée de Morphologie
(Séminaire d’Etudes Doctorales, Paris X Nanterre)
Exemplier de F. Kerleroux
1. Situation du livre de référence
Marc Aronoff, 1994, Morphology by itself, The MIT Press
Dans le cadre de la recherche des trente dernières années on peut envisager les
trois ensembles principaux suivants :
1.1. Les ouvrages fondateurs : qui fondent à nouveau l’étude de la Morphologie —
dans le cadre de la théorie de la Grammaire Générative :
Dell F. 1970, «Les règles phonologiques tardives et la morphologie dérivationnelle du
français » (PhD, MIT, mim.).
Dell F. 1973, Les règles et les sons — Introduction à la Phonologie générative,
Paris : Hermann,
[« Il est impossible de décrire la phonologie d’une langue sans une connaissance
détaillée de sa morphologie, en particulier sans avoir dressé un inventaire
systématique des paradigmes flexionnels et des irrégularités apparentes ou réelles
qu’ils présentent » p. 266 ]
Matthews P.H., 1972 , Inflectional Morphology, Cambridge : C.U.P.
Matthews P.H., 1974, 2° ed. 1991, Morphology : an Introduction to the Theory of
Word Structure, Cambridge : C.U.P.
Aronoff M., 1976, Word Formation in Generative Grammar, Cambridge : MIT Press
1.2. Les explorations à visée exhaustive de la Morphologie d’une langue :
néerlandais :
- Booij G., 1977, Dutch Morphology, Dordrecht : Foris
italien :
- Scalise S., 1984, Generative Morphology, Dordrecht : Foris
- Scalise S., 1994, Morfologia, Bologna : Il Mulino
français :
- Corbin, D., 1987, Morphologie dérivationnelle et structuration du lexique, Tübingen :
Niemeyer
1.3. Les synthèses ( ± descriptives ou ± théoriques)
Anderson, S.R., 1992, A-Morphous Morphology, Cambridge : C.U.P.
Mel’cuk I., 1993-1996, Cours de morphologie générale, 5 vol. Les Presses de
l’université de Montréal & CNRS Editions.

5
2. Définition
"Derivation and inflection are not kinds of morphology but rather uses of morphology :
inflection is the morphological realisation of syntax,
while derivation is the morphological realization of lexeme formation. (...) and the
same morphology can sometimes serve both".
Aronoff, Morphology by itself, 1994, MIT Press, p. 126
3. Exemples des deux usages du morphologique : les procédés variés sont
communs aux deux usages de la flexion et de la dérivation
1
flexion
dérivation
Patron
accentuel
Russe1 :
(1a) zerkal-a ‘miroir-NOM-PLU’
(1b) zerkal-a ‘miroir-GEN-PLU
(2a) voln-y ‘vague-GEN-SG’
(2b) voln-y ‘vague-NOM.PLU’
Pagasinan : (Philippines)2
recul d’accent : SG/PLU
anak anak ‘ enfant’
polis popolis ‘policier’
agi agagi ‘ frère cadet’
Anglais : paires V / N
To conflict / conflict
To insult / insult
To export / export
To torment / torment
To contrast / contrast
Patron tonal
Chichewa (Malawi, lg bantou)3
V, 1° SG (ton haut en gras)
ndi-na-fotokoza : simple past
ndi-na-fotokoza : recent past
ndi-ma-fotokoza : present habitual
ndi-ma-fotokoza ; past habitual
Birom (Nigeria)4 :
1
B. Fradin, 2003, Nouvelles approches en morphologie, PUF, p. 17, d’après Mazon, 1978, Grammaire de la
langue russe, Institut d’études slaves, Paris
2
Fradin op.cit., p. 50 ; d’après Benton, R.A., 1971, Pagasinan reference grammar, Honolulu.
3
Spencer, A., 1991, Morphological Theory,, Blackwell, p. 18.
4
Matthews, P.H., 1974, Morphology,, CU P, p. 141.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
1
/
13
100%