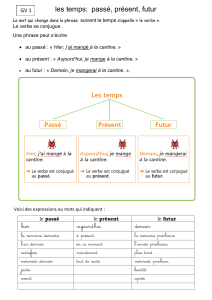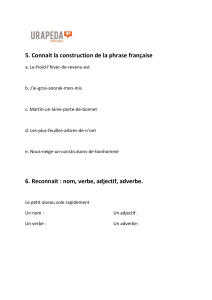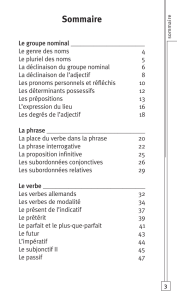Démarche Vocanet : Transformations et - Académie de Nancy-Metz

Démarche Vocanet : Transformations et assouplissement syntaxique
Il est souhaitable, toutes les fois qu’on en a de bonnes occasions, de transformer les phrases qui ont été
produites pendant la première séance : faire dire la même chose d’une autre façon, ou plus exactement
parler de la même chose d’une autre façon, les deux façons n’étant jamais strictement équivalentes.
Sept types possibles de transformations
Les deux premiers n’impliquent pas de reconstruction de la phrase, le nom et le prénom utilisé comme
sujet restant le sujet du verbe.
À partir du n°3, tous sont des « exercices d’assouplissement syntaxique », dans lesquels les différents
éléments de la phrase changent de fonction. Transformer ainsi fait donc apparaître l’essentiel du principe
4 : les rapports qui existent entre vocabulaire et syntaxe, manifestés par la pratique.
Peut-être que ces exercices seraient particulièrement bienvenus dans la deuxième séance, consacrée à la
lecture et à la correction des exercices écrits. Les élèves auront proposé des phrases indigentes ou mal
bâties. C’est peut-être le meilleur moment pour les leur faire transformer, essayer d’autres tournures,
améliorer le style…
1- Substituer à un mot un parasynonyme de même catégorie grammaticale.
On peut substituer un nom à un nom, un adjectif à un adjectif, un verbe à un verbe et voir les
changements que cela impose, en matière de contexte ou de niveau de langage : une bonne bouffe ne se
dit évidemment pas au même interlocuteur et dans la même situation qu’un repas exquis. Le verbe
grignoter convient mieux à la souris qui grignote un morceau de fromage qu’à l’éléphant qui avale une
tonne de fourrage. Une permutation peut ainsi entraîner d’autres permutations en chaîne.
Ex : Le petit garçon mange son poisson pané à la cantine.
Si on remplace petit garçon par ogre : →L’ogre dévore un enfant dans son château.
Si on remplace dévore par picore : → les moineaux picorent du grain dans le jardin.
2- Utiliser une locution figée en rapport de sens avec le mot étudié
Ex : Je suis affamé. (un peu recherché)
→ J’ai très faim. (simple, naturel, à l’oral)
→ J’ai l’estomac dans les talons. (pittoresque, familier, un peu humoristique)
L’utilisation de locutions figées jour souvent sur le registre de langue (soutenu, courant ou familier)
3- Mettre au passif un verbe transitif
On appréciera l’intérêt de préciser ou non le complément d’agent.
Ex : La photo a été cachée par Jean dans un tiroir.
Est-il important de préciser par Jean ? Oui si un autre peut être accusé de l’avoir cachée, et si on veut
préciser la responsabilité de Jean. Dans ce cas, on pourrait dire C’est par Jean que la photo a été cachée
ou C’est Jean qui a caché la photo.
Non si ce qui est important c’est qu’elle ait été cachée, peu importe par qui, ou si on veut protéger Jean
d’une accusation gênante. On retrouve de nombreuses formulations de ce type dans les journaux
quotidiens, notamment dans les titres, où l’agent manque par volonté éditoriale.
La même histoire sera racontée différemment si on utilise la voix active ou la voix passive :
Ex Le chat a dévoré la souris. (On raconte l’histoire du chat)
→ La souris a été dévorée par le chat. (Ici, on raconte l’histoire de la souris)

4- Faire des essais de déplacement de certains éléments de la phrase
Voir ceux qui sont déplaçables et ceux qui ne le sont pas, et les conséquences du déplacement en matière
de focalisation et d’expressivité.
Mise en valeur de certains éléments au moyen de C’est….. que.
Ex : C’est par Jean que la photo avait été cachée. ou C’est dans le tiroir qu’elle était cachée.
Selon que ce qui est important est la personne responsable ou le lieu.
Ex : Nos invités sont arrivés au restaurant avec des fleurs à midi.
On veut insister sur le temps :
→ À midi sonnant, nos invités sont arrivés au restaurant avec des fleurs.
On veut mettre en avant les fleurs :
→ Les bras chargés de fleurs, nos invités sont arrivés à midi au restaurant.
5- Dans une phrase simple, transformer un adjectif attribut en épithète et continuer
la phrase
Ex : Cette tarte était délicieuse. → Cette tarte délicieuse nous a régalés.
6- Transformer deux phrases simples en une phrase complexe
Ex : Il fait beau ! Ça me fait plaisir !
→ Ça me fait plaisir qu’il fasse beau ! (attention au subjonctif !)
7- Utiliser les noms d’action des verbes pour transformer complètement la phrase
Ex : On est en train de construire une maison.
→ La construction de la maison est en cours.
Ex : Aujourd’hui à la cantine, nous avons mangé des carottes râpées, des spaghettis à la bolognaise et
une orange.
→ Aujourd’hui, notre repas à la cantine se composait de carottes râpées, de spaghettis à la bolognaise et
d’une orange.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bien entendu, ce sont des suggestions multiples et il ne s’agit pas de les exploiter toutes à chaque fois !
Certains mots se prêtent mieux à certains types d’exercices qu’à d’autres. C’est à l’enseignant de voir ce
qu’il veut faire pratiquer au moment où les propositions d’élèves se présentent (l’adaptation pédagogique)
ou à programmer quelques pistes à manipuler en fonction du mot choisi (la préparation didactique).
Un dernier mot pour vous recommander de jouer sur ces transformations d’abord à l’oral, puis de passer
à l’écrit.
Document issu de l’ouvrage « Le vocabulaire, comment enrichir sa langue ? »
1
/
2
100%