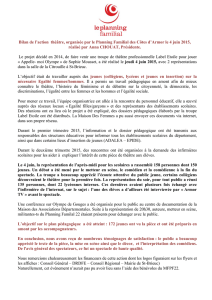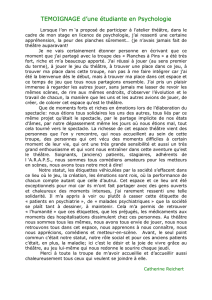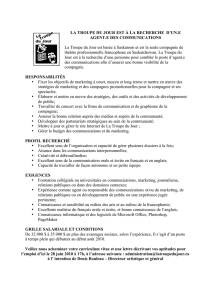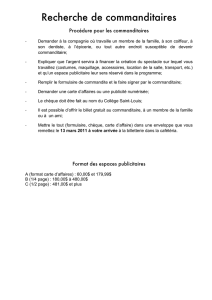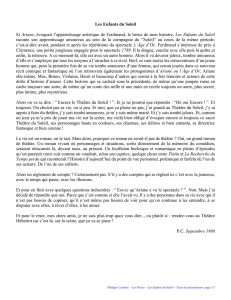Interview parue dans la revue Acteurs en avril

Philippe Caubère - Archives – interview revue Acteurs – 1982 – Page 1/4
Interview parue dans la revue Acteurs en avril 1982
Les troupes de la Cartoucherie
Le foyer théâtral qu’a peu à peu formé la Cartoucherie de Vincennes
depuis une quinzaine d’années est un phénomène majeur de notre théâtre.
Un style, un public se sont formés, rares et nombreux : tout cela, cette
extraordinaire réussite, ce rassemblement s’est fait autour de compagnies
et de troupes celle : d’Ariane Mnouchkine avec le théâtre du Soleil en tout
premier lieu, bien sûr, et puis l’Aquarium (la troupe en ce moment est
divisée, elle se remet en question : nous parlerons plus tard de
l’Aquarium), ensuite l’Epée de Bois (au Chaudron, c’est variable ; la
Tempête d’après Jean-Marie Serreau est un théâtre d’accueil). Nous avons
demandé à Philippe Caubère d’évoquer la troupe d’Ariane Mnouchkine,
celle d’avant Richard II, qui a disparu, en entier. André Gintzburger
évoque la tribu de l’Epée de Bois, qu’il connaît depuis toujours.
De la vie collective au one-man show :
Philippe Caubère :
sept ans au Soleil
Acteurs — Vous avez longtemps appartenu à
la troupe du théâtre du Soleil et, aujourd’hui,
vous jouez au théâtre Edouard VII, La danse
du diable, une pièce dont vous êtes à la fois
l’auteur, le metteur en scène, l’unique
interprète, et la “matière”. Ce passage du
travail collectif à la création individuelle vous
donne une expérience très riche pour parler
de la notion de troupe. Quelle a été votre
formation de comédien ?
Philippe Caubère — Je ne suis pas du tout
parisien, je suis marseillais. Après le bachot, je
suis arrivé à Aix-en-Provence pour faire des
études de lettres. Depuis longtemps déjà je
voulais faire du théâtre et je me suis inscrit,
comme tout le monde, dans un cours qui
s’appelait le cours Molière. C’était en novembre
1968. Je suis arrivé dans un cours qui était tout à
fait le cours de province tel qu’on peut se
l’imaginer mais qui était en pleine
effervescence, en pleine panique, parce qu’il y
avait eu mai 1968... C’étaient des dames qui
s’occupaient du cours, des amateurs, des filles
qui avaient fait du théâtre lorsqu’elles étaient
jeunes. Je le raconte dans La danse du diable. Il
y avait déjà deux choses qui se profilaient.
Micheline, une de ces dames que j’adorais — je
les adorais toutes les deux — enseignait le
théâtre aux gens comme elle l’avait appris
c’étaient des poèmes, des textes... Et puis, il y
avait l’autre, qui était plus jeune, qui avait été à
Avignon en 1968. Quant j’étais arrivé, elle
m’avait donné La formation de l’acteur de
Stanislavski — je n’avais d’ailleurs rien compris
du tout — en me disant “Il faut lire cela, c’est
un livre très important, vous verrez”. Et puis en
même temps “Vous savez, il y a des tas de
choses qui changent dans le théâtre”… Moi
j’étais naïf, j’étais allé à Avignon en 1968, deux
jours, parce que j’habitais à côté, mais je suis
arrivé là avec des idées naïves : je voulais être
Gérard Philipe ! Avec, en plus, les problèmes de
famille les plus classiques, les plus banals. Cette
femme, Marlène, avait fait elle-même un stage
avec Eugenio Barba. C’était l’époque de
Grotowski, que Bourseiller avait fait venir à
Aix. A ce moment, très vite, à Aix qui est une
petite ville très bourgeoise, très fermée, il y
avait cette espèce d’effervescence.
Finalement, à partir du cours, puis en dehors du
cours, on s’est retrouvé avec une bande de
copains et de copines à faire quelque chose
ensemble, à faire des spectacles nous-mêmes.
C’était autour d’Eric Eychenne qui a créé le
théâtre d’essai d’Aix-en-Provence, le Tex. Cela
a duré trois ans, cette histoire, ce qui est long !
On a créé quinze ou vingt spectacles, qui parfois
ne duraient que trois jours.
— Ce sont des spectacles que vous écriviez
vous-mêmes ?
— On inventait des pièces. Parfois on était
obligé de gagner de l’argent pour vivre, on avait
fait une vie de Molière, Eric faisait des
spectacles sur les Cathares. Parfois pas du tout :
on avait une pièce à partir des Surréalistes, Le
plaisir des morts, c’est de moisir à plat. On
avait fait une pièce sur les festivals de pop
music qui se passaient dans la région à cette
époque-là. Moi, j’avais écrit une pièce qui
s’appelait Le cercle, et qui était très
cérébralo-machintruc...
— A chaque fois il y avait un auteur ou
était-ce déjà un travail collectif ?
— Non, non, cela se faisait ensemble. Il y avait
toujours un auteur, mais il n’avait pas le droit de
le dire ! C’est toujours Eric Eychenne qui était
le chef, même si on le contestait sans arrêt. Ça,
c’était aussi 1968... Il s’est passé quelque chose
de passionnant — être obligé de faire du théâtre
tout de suite, et très vite d’en vivre, parce que
cela suscitait des problèmes épouvantables par
rapport à ma famille, qu’il a fallu que je
choisisse et que je parte — et en même temps
quelque chose de très fatigant et de très
épuisant, qui était justement le laxisme de cette
époque-là : il n’y avait pas de chef, pas de
metteur en scène...
— Il y avait une grande part
d’improvisation ?
— Oui, d’improvisation, de n’importe
quoi... Et parfois des choses tout à fait
passionnantes auxquelles je repense souvent.
C’était pour moi une espèce de bouillon de
culture. On voyait de grands spectacles
Bourseiller, c’était important — c’est lui qui a
produit Richard II monté par Chéreau, à
Marseille. Mais nous, on faisait un truc
complètement à nous. Et puis en 1970, on est
devenu plus théâtre politique, théâtre
d’agitation. On travaillait avec la Ligue
communiste de l’époque. C’est ça, ma
formation. Et c’est comme cela qu’on a
rencontré ensemble — on était trois — le Soleil,
un jour, à Lyon où ils étaient en tournée. Nous
leur avons joué un spectacle sur la Commune de
Paris, et Ariane Mnouchkine nous a proposé
d’entrer tous les trois au théâtre du Soleil. Je
suis arrivé au théâtre du Soleil en 1971, pour un
an, comme ça, pour apprendre notre métier (je
sentais vraiment qu’il fallait que j’apprenne,
qu’il me manquait un métier). Les idées, c’était
très bien, mais cela ne suffisait pas. On est entré
là-dedans pour un an... et puis, on est resté sept
ans !
— Est-ce dur d’entrer dans une troupe
préconstituée ?
— C’est très dur : mais notre chance a été
d’arriver à trois. D’abord, on s’est fait détester
de tout le monde car à trois dans une troupe, on
fait bloc, on se referme on se protégeait. Ce qui
a été très important, bien sûr, c’est qu’Ariane,
au niveau du travail, nous a dissociés. Elle
s’adressait à Philippe Caubère, à Maxime
Lombard ou à Jean-Claude Bourbault. On était
toujours habitués à être “nous, nous, nous”...
Une troupe, c’est “nous” et c’est “je”. Il y a une

Philippe Caubère - Archives – interview revue Acteurs – 1982 – Page 2/4
difficile dialectique entre les deux. Et Ariane,
très vite, comme ça, sans jamais intervenir dans
ce qui nous liait, en critiquant ce qui nous liait,
mais en nous critiquant avec tendresse, tout de
suite dans le travail, par la force des choses,
nous a obligés à être sur le même plan que les
autres. Chacun devait travailler et montrer s’il
avait quelque chose à apporter ou pas.
— Au théâtre du Soleil, y avait-il un noyau
permanent, beaucoup d’entrées et de
sorties ?
— Il y eut longtemps un noyau permanent. Cela
fait longtemps maintenant que le théâtre du
Soleil existe, depuis 1964 et même avant. C’est
une troupe qui a vingt ans maintenant. Il y a eu
plusieurs histoires du théâtre du Soleil, et sans
doute des histoires très différentes. Moi, j’ai
envie de dire que le noyau du théâtre du Soleil,
c’est Ariane. C’est un peu restrictif, mais c’est
quand même ça : c’est Ariane, et les relations
des gens qui travaillent avec elle, ou ceux qui
ont travaillé avec elle, avec qui elle retravaille
ou ne retravaille pas.
— Comment se combine la personnalité
d’Ariane Mnouchkine et la place faite au
travail collectif ?
— Je crois qu’au début du théâtre du Soleil, il
n’y avait pas du tout d’idée de travail collectif.
Il y avait une idée de responsabilité collective,
au niveau de l’entreprise. Je vous dis des choses
que je n’ai pas vécues, mais qu’on m’a
racontées... Cela passait par Ariane : il fallait
que cette fille fasse des mises en scène, qu’elle
ait les moyens de faire des mises en scène,
quelque prix que cela coûte, y compris dans la
vie... C’est certainement une des clés de la
réussite du théâtre du Soleil, c’est le meilleur
départ qui puisse exister. Et puis ils étaient amis
bien sûr... Ils ont eu la sagesse de rester un
groupe assez fragile, pas totalement constitué
dans un centre dramatique ou une structure
administrative pesante, ils étaient libres, ils ont
pu, au niveau de la création, c’est ça qui est très
important, assumer le bouleversement de 68 et
le traduire en termes de spectacle, ce qui
finalement a été assez rare. Cela a donné Les
clowns et surtout, trois ans plus tard 1789. Le
travail collectif, ils l’ont fait à leur manière,
d’abord en se passant d’auteur ; alors qu’ils
avaient toujours monté des auteurs ; soudain, ils
ont décidé qu’ils n’en monteraient plus. Cela
voulait dire qu’eux devenaient les auteurs... Et
c’est devenu cette sorte de système : Ariane leur
proposait un sujet à partir duquel les acteurs
improvisaient. Tout ce matériau d’improvisation
servait à Ariane de point de départ pour
composer un spectacle. Bien entendu, je crois
que c’est Ariane qui a suscité le travail collectif,
peut-être même l’a-t-elle imposé, je n’en sais
rien, je n’étais pas là. Quand je suis arrivé ça y
était, c’est après 89. Jusqu’à L’Âge d’or, qui a
été le dernier spectacle de création collective,
après lequel elle a repris vraiment en main son
rôle de metteur en scène avec Molière, avec
Méphisto. Depuis Molière, les choses ont
changé.
— Le travail de création collective
n’implique-t-il pas une grande lenteur entre
les spectacles ?
— Si, c’est cauchemardesque... J’ai calculé
qu’en sept ans au théâtre du Soleil, si je compte
Dom Juan, le spectacle que j’ai monté comme
metteur en scène, j’ai participé à la création de
quatre spectacles et repris 89 : j’ai créé 93,
L’Âge d’or, et la même année le film sur
Molière et Dom Juan. C’est très lent à
concevoir, très lent à faire et, une fois fait, ça a
été tellement long et épuisant qu’il faut le jouer
très longtemps, pour s’en remettre et pour
penser à autre chose, mais aussi pour l’amortir
du point de vue financier.
— Est-ce qu’un succès n’est pas également
un peu “lourd” pour les comédiens qui
doivent jouer des centaines de fois la même
pièce ?
— Moi, j’aime bien jouer un spectacle très
longtemps. Je ne sais pas ce que c’est, le
“métier”, mais je suis sûr que quand on joue un
spectacle 200 fois, on apprend quelque chose de
son métier. Car cela veut dire qu’on va passer
par des périodes d’euphorie, de désespoir,
d’ennui, de cauchemar... On ne peut pas se dire
que le cauchemar va s’arrêter, parce que l’on
sait que cela va continuer. Il faut trouver des
moyens en soi-même ou chez les autres pour
que cela recommence, que le plaisir revienne.
Au niveau du métier concret, je crois que jouer
beaucoup, mais tout le temps des choses
différentes, cela veut dire que tout le temps on
passera à côté du problème. Le problème, il
arrive au bout de 100 représentations quand on
n’en peut plus, qu’on en a marre. Là, tout ce qui
a été triché, tout ce qui a été mauvais, apparaît.
Tout ce qui est authentique et vrai de soi-même,
c’est là-dessus, brusquement qu’on est obligé de
s’appuyer.
— Mais en même temps les spectacles ne se
déglinguent-ils pas très souvent ?
— Si, tout le temps. Un spectacle c’est vivant.
L’âge d’or cela donnait des résultats
catastrophiques parfois, des choses aberrantes,
horribles. Il faut répéter, recommencer...
— Comment se faisait le choix des pièces, au
Soleil ? Il y avait une discussion sur les
enjeux ?
— Oui, c’était plus qu’une discussion, c’était
une maturation.
— Y avait-il beaucoup de fausses pistes, de
projets abandonnés ?
— Avant Les clowns, donc avant de décider de
se passer d’auteur, ils ont travaillé plus de six
mois sur une pièce de Brecht, Baal, c’était
presque fait, puis sur des Shakespeare... Après
93, on a travaillé trois mois pour un spectacle
sur 1936. Finalement, c’est devenu Méphisto,
quatre ans plus tard. Mais on avait beaucoup
travaillé sur 36, sur le Front Populaire, la guerre,
le fascisme, à partir de documents, de livres. On
avait fait des claquettes, car cela devait se passer
dans les bals.
— Et pourquoi le spectacle n’a-t-il pas
abouti ?
— Ça ne s’est pas fait parce qu’Ariane et nous
n’avons pas eu suffisamment envie de le faire...
Le projet doit venir d’elle. C’est obligé. Si. ça
ne vient pas d’elle, cela ne marche pas. Il faut
que, quand elle parle de son projet, les yeux des
gens fassent ding-ding.
C’est plus qu’une discussion. Le projet qui va se
faire, c’est quand brusquement, à la fin de la
réunion, tout le monde se met à picoler et à
sentir que ça y est ! Pour 36, cela me faisait
chier ce projet, d’abord faire des claquettes
j’avais horreur de cela. Et puis on était plusieurs
à dire : 36 c’est bien, mais pourquoi ne fait-on
pas un spectacle sur l’époque contemporaine ?
Ariane disait qu’on n’était pas prêts, pas mûrs.
On l’a fait plus tard, on a fait L’âge d’or et
c’était beau...
— Quelle est l’organisation de la troupe ?
— Je n’y suis plus depuis trois ans et à chaque
spectacle ou presque, tous les deux spectacles
pour être plus réaliste, le théâtre du Soleil
change parce qu’il change de gens. Moi, je ne
fais plus partie du théâtre du Soleil, quels que
soient mes attachements avec le théâtre du
Soleil, avec Ariane, quels que soient mes
sentiments, ce n’est plus moi du tout. Le théâtre
du Soleil, ce sont les gens qui le font
maintenant, que je ne connais pas. La richesse,
l’intelligence, la force d’Ariane c’est de savoir
tromper ses amours, c’est de savoir aller
ailleurs, trouver d’autres gens et faire d’autres
choses. Ça implique des tas de problèmes
humains, évidemment, parfois des
déchirements, mais ça fait partie du jeu et à la
limite, du plaisir, et surtout d’une nécessité
artistique. Si, à un certain moment, j’ai eu une
critique fondamentale à faire au Soleil, c’est que
c’était toujours les mêmes qui jouaient. Il y a un
moment où ça doit être d’autres gens.
— Inversement, le Soleil a pu servir de
“modèle” à d’autres troupes.
— Je ne crois pas que modèle soit le terme qui
convienne. C’est une source... Le propre des
grands créateurs c’est qu’ils font leur œuvre et
qu’ils essaiment, ils donnent naissance à autre
chose. Quand on parle de Jouvet, de Dullin, ce
sont des gens qui sont venus de la même source
qui était Copeau. Barrault était l’élève de
Dullin... Si quelqu’un n’essaime pas, c’est que
sa création transporte sa propre mort. Ariane est
vraiment quelqu’un qui donne naissance à
beaucoup de choses — que cela lui plaise ou
pas, c’est un autre problème. C’est bien fait pour
elle !
— Comment s’est fait pour vous le passage
du théâtre au cinéma avec le Molière ?
— Il s’est fait assez naturellement. On s’est dit
on va faire un spectacle, mais ce sera du cinéma,
parce que cette histoire-là il faut qu’elle soit
racontée au cinéma, parce qu’Ariane avait envie
de faire un film et beaucoup de gens avec elle.
— Il n’y a pas eu de problèmes avec le
mélange de deux équipes très différentes ?
— Non, ça s’est très bien passé. Au début,
c’était dur, bien sûr. Ils se demandaient qui on
était et nous, on les regardait... Mais finalement
les techniciens de cinéma ce sont des artisans
comme nous. Une reconnaissance s’est faite très
vite.
— Vous aviez gardé vos méthodes
théâtrales ?
— Transposées pour le cinéma.

Philippe Caubère - Archives – interview revue Acteurs – 1982 – Page 3/4
— En répétant beaucoup ?
— Avant les prises, pendant les prises, on
recommençait parfois dix-huit fois les prises...
Et puis on parlait entre nous de choses qu’on
connaissait.
— C’étaient des discussions collectives ?
— C’est plus simple et naturel que cela, c’est
beaucoup plus tribal ou primitif. Cela ne se
passe pas comme dans un parti politique ou un
symposium. On parle avec tout le monde quand
c’est le monde, on parle avec une personne
quand c’est une personne, on s’engueule, on se
tombe dans les bras. C’est beaucoup plus
familial Ça m’amuse toujours quand on me
demande : “ Mon Dieu, comment as-tu pu faire
pour rester sept ans au Soleil et supporter
cela ? “ Non seulement je l’ai très bien supporté,
j’étais très heureux, pas tout le temps bien sûr
mais en fait, ce n’est pas un kolkhoze ! Par
exemple, il n’y a pas de contrat, c’est très
important : les gens quand ils en ont marre, ils
s’en vont, ils peuvent partir quand ils veulent.
J’ai vu des comédiens partir pendant les
représentations — on les remplaçait dans
l’après-midi... S’ils restent c’est qu’ils ont envie
de rester. Alors évidemment, il y a tous les
problèmes que l’on peut imaginer, les
problèmes de pouvoir. Ariane ne dirige pas le
théâtre du Soleil comme une copine gentille,
c’est un chef, et ce n’est pas possible autrement.
C’est peut-être ma plus grande leçon, après le
texte : on dirige une troupe, on dirige un travail
théâtral, on dirige un film. Ça ne se fait pas avec
tout le monde autour d’une table qui discute.
C’est Renoir qui disait que pour faire un film il
faut que tout le monde creuse dans le même
trou. L’art le plus difficile au théâtre, c’est
d’être directeur de troupe, c’est ce qui est le plus
rare. Diriger une troupe, c’est infernal, ça doit
être passionnant, mais c’est extrêmement
difficile. Faire de la mise en scène c’est facile,
jouer c’est déjà très dur, écrire aussi...
— Vous pensez qu’on peut diriger une troupe
sans être soi-même acteur ?
— C’est une question de talent. On ne peut pas
diriger une troupe sans les acteurs, contre les
acteurs. Cela arrive parfois, c’est normal,
quelqu’un qui n’est pas acteur va essayer de
diriger une troupe sans les acteurs, mais il se
plantera, c’est sûr. Au bout du compte, ce sont
les acteurs qui doivent, devant le public, gagner
la partie. Si on rate cela, on rate toute
l’entreprise.
— Est-ce que le vedettariat que vous a
apporté le film, avec le rôle principal, votre
nom connu de tout le monde, est-ce que cela a
entraîné un changement dans votre statut au
sein de la troupe ?
— Il n’y avait pas de noms dans le film non
plus, puisqu’il n’y avait pas de générique, chose
qui m’a d’ailleurs fait chier énormément. Là,
c’est aussi quelque chose qui m’a gêné, à un
certain moment, au théâtre du Soleil, cette peur
de mettre des noms sur la tête des acteurs. Pour
moi, troupe ne veut pas dire anonymat, sinon je
m’enfuis. Je crois que dans une troupe tout le
monde n’est pas pareil, il y a des gens plus forts,
moins forts, cela dépend aussi des moments. Il y
a des gens qui méritent plus que d’autres d’avoir
leur nom. Moi, quand je suis arrivé au théâtre du
Soleil, j’aurais trouvé ridicule qu’on mette mon
nom en gros parce qu’il y avait des acteurs qui
étaient bien plus forts que moi et qui avaient des
rôles plus importants. Par contre quand j’ai joué
Molière, je trouvais tout à fait normal qu’on
mette mon nom ou celui de Joséphine Derenne...
Dans la troupe de Vilar, au TNP, les gens
avaient des noms !
— Votre mise en scène de Dom Juan était le
prolongement de votre travail de réflexion
pour le film ?
— Oui, j’avais surtout envie depuis longtemps
de faire la mise en scène d’une pièce écrite.
Travailler sur Molière et relire Dom Juan,
comme les autres pièces, m’a rappelé des tas de
choses, et puis j’avais une distribution dans la
tête, avec des acteurs qui étaient au Soleil et
avec qui j’avais envie de travailler. Après, cela a
été un concours de circonstances. Ariane
travaillait à son montage, je lui ai proposé mon
projet et elle a été d’accord.
— Que faisaient les autres comédiens de la
troupe pendant ce temps ?
— Il y en avait une partie avec moi sur Dom
Juan, une partie avec Jean-Claude Penchenat
dans le théâtre du Campagnol qui jouait David
Copperfield et une partie qui était au chômage
ou qui travaillait ailleurs...
— Après vous avez été en Belgique ?
— Il y a eu d’abord un an où je n’ai rien fait.
J’ai suivi Molière en tournée, lorsque le film est
sorti en province, j’ai été discuter avec le public
pendant quatre-cinq mois. Et puis je suis entré à
l’Atelier théâtral de Louvain pour travailler avec
Krejca sur Lorenzaccio et Les trois sœurs.
— Pendant ce temps-là Méphisto démarrait ?
— Ils ont commencé à répéter trois mois avant
que je parte.
— L’Atelier de Louvain, c’est aussi une
troupe ?
— C’est très différent. D’abord l’Atelier a été
créé pour Lorenzaccio. C’est encore en
gestation, mais ça fonctionne d’une manière
plus traditionnelle, comme un Centre
dramatique, avec des comédiens. Les salaires
sont différents... C’est une équipe autour de
deux têtes : Armand Delcampe qui est le
directeur du théâtre et Otomar Krejca qui est le
directeur artistique. Cela fonctionne à
l’allemande, avec dramaturge, directeur...
— Avez-vous eu des problèmes
d’acclimatation ?
— Je ne me suis pas du tout fait à la structure
humaine. J’aime beaucoup Krejca, c’était très
important de travailler avec lui, j’aime bien
Armand aussi, mais c’est une structure qui ne
m’intéresse pas du tout, parce que cela exclut
des tas de choses qui me paraissent très
importantes, comme l’amitié... On prend des
acteurs pour une distribution, ensuite ce ne sont
plus ceux-là, c’est comme partout... Moi je ne
me sentais pas bien. Dans une troupe il y a une
question d’amitié qui joue, une question
passionnelle. C’était d’ailleurs critiqué au
théâtre du Soleil : on dit toujours qu’Ariane a
des relations passionnelles avec les gens, c’est
vrai, mais c’est cela qui m’intéresse. Sans
relations, il n’y a pas de création possible.
— Comment avez-vous créé votre propre
spectacle, La danse du diable, après cette
expérience de l’Atelier théâtral de Louvain ?
— C’est parti un an plus tard. J’ai joué
Lorenzaccio à Avignon, puis en tournée ainsi
que Les trois sœurs. J’avais un contrat d’un an
qui s’arrêtait au mois de mai 1980. Et là,
vraiment, je voulais écrire une pièce. C’est
devenu La danse du diable.
— Vous l’avez écrite seul ?
— Seul d’abord, puis avec un ami Jean-Pierre
Tailhade — qui est d’ailleurs un des fondateurs
du théâtre du Soleil et par qui j’ai rencontré le
Soleil, mais il était déjà parti quand je suis
arrivé dans la troupe — et avec Clémence
Massart, une comédienne avec qui je vis et qui
travaille au Magic Circus. On a travaillé comme
cela, l’un, l’autre, et seul pendant un an.
— Vous arrivez à travailler seul ?
— C’est très difficile, très cruel, mais j’avais
besoin de cela. Je ne crois pas qu’on puisse faire
du théâtre sans troupe humaine, quelle que soit
la nature de la troupe, mais je ne crois pas qu’on
peut faire du théâtre sans savoir être seul
parfois, sans garder son individualité, sans
travailler aussi avec son individualité, sans
savoir comment on est quand on est tout seul, ce
qu’on a envie de raconter. C’est pour cela que
j’ai fait ce spectacle. Au départ, je ne devais pas
le jouer seul, je voulais l’écrire pour plusieurs
acteurs, mais je n’y suis pas arrivé et je me suis
rendu compte que le thème de mon spectacle me
contraignait à jouer seul ! C’est comme cela
qu’il aurait un sens, s’il avait un sens. Je ne
voulais pas que ce soit un spectacle de metteur
en scène — même en étant le metteur en scène,
comme Dom Juan est un spectacle de metteur
en scène — ni un spectacle de dramaturge... Je
voulais que ce soit un spectacle écrit et mis en
scène par un acteur, qui ne cesse d’avouer et de
proclamer qu’il est acteur, que son langage est
un langage d’acteur...
— Votre rapport avec le public doit être très
différent lorsque vous vous trouvez seul en
scène, au lieu de jouer au milieu d’une
troupe ?
— Cela dépend du spectacle, bien sûr. Là, ce
qui est une surprise formidable, c’est que le
spectacle est porté par le public les trois-quarts
du temps. C’est un plaisir extraordinaire. C’est
très différent de jouer seul, c’est vrai, cela fait
aussi beaucoup plus peur. Il y a eu un moment à
la fin des Trois sœurs où je m’emmerdais
prodigieusement (pour la première fois de ma
vie). Je ne supporte pas cela, ça me rend malade
de m’ennuyer en jouant, je préfère faire autre
chose, vivre au chômage, glander... Et là, j’ai
vraiment retrouvé quelque chose que j’avais
perdu depuis longtemps, c’est le plaisir de jouer,
donc aussi la peur. Je n’avais plus peur, je
n’avais plus le trac, rien... Là, j’ai peur. Quand
je joue le soir, toute la journée je décroche mon
téléphone et j’ai la trouille. Pour des tas de
raisons débiles, physiques: pour que je ne me
fasse pas mal parce que si j’ai la voix cassée, il
n’y a rien. J’ai peur aussi parce que, à Ivry, les

Philippe Caubère - Archives – interview revue Acteurs – 1982 – Page 4/4
gens venaient parce qu’on leur avait dit que
c’était bien, alors il ne fallait pas qu’ils soient
déçus. Brusquement je retrouve des sensations
très primitives comme cela, mais qui font aussi
que le plaisir est fantastique quand ça marche !
C’est une explication entre un acteur et le
public, sans rien qui gêne, ni décor, ni troupe...
Et en plus avec une histoire, l’histoire d’un
acteur.
— Vous pourriez écrire autre chose ?
— J’ai essayé de fuir cela. Il n’y a rien de plus
casse-gueule que d’écrire l’histoire d’un
adolescent qui rêve de faire du théâtre, c’est
tellement banal. J’ai essayé de raconter cela
autrement, mais Tailhade m’a vu dans un tel état
d’angoisse qu’il m’a dit : c’est ça que tu veux
raconter et tu dois le raconter ! Et tout de suite
les gens ont compris, parce qu’ils ont compris
que c’était leur histoire. Un gamin qui veut faire
du théâtre parce qu’il rêve de gloire, ou une
mère qui a du souci parce que son fils s’enferme
dans sa chambre et qu’il va faire du théâtre,
mais pas dans les beaux théâtres, dans des
endroits pourris. C’est l’histoire de tout le
monde.
1
/
4
100%