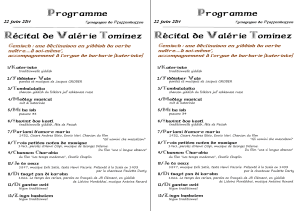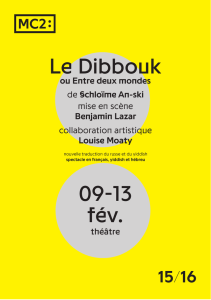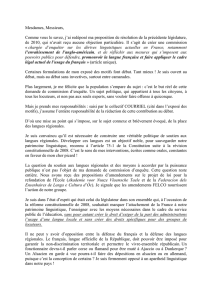5 - de Tud le l`Alsace par les Ostrogoths

une langue bizarre
23

une langue bizarre
24
SYNAGOGUES ALLEMANDES EN 1170
selon Benjamin de Tudèle
Veuillez excuser les nombreuses maladresses, je maîtrise très mal mon ordinateur

une langue bizarre
25
5- de Tudèle à l'Alsace par les Ostrogoths
LES OUBLIS DE BENJAMIN
Dans "l'Itinéraire de Paris à Jérusalem", CHATEAUBRIAND cite Benjamin de Tudèle et sa liste des synagogues
allemandes:
A Andernach 11 km W Coblence B Bamberg 47 km NNW Nuremberg
C Bengen (Bingen, 30 km SW Mayence ?) D Caub (Kaub 32 km SSE Coblence ?)
E Coblentz F Creutznach ( Kreuznach, 31 km SW Mainz)
G Freising 30 km N Munich H Gemersheim 20 km N Karlsruhe
I Mantern (W Vienne ou NNW Graz ?) J Munster (N Dortmund ou W Colmar)
K Reguenspurch Ratisbonne L Strasbourg
Tsor introuvé
Un ouvrage à l'AIU, (références non notées) ajoute: M Bonn, N Cologne, O Metz, P Nuremberg, Q Trèves, R
Worms, S Würzburg, mais ni Caub, ni Tsor, ni Creutznach. Selon (SHATZMILLER 1331):
"Voici les villes d'Allemagne où il y a des communautés, toutes généreuses: Metz, Trèves, Coblence, Andernach,
Bonn, Cologne, Bingen, Munster, Worms, Mistran (?) Kaub, Kartania (?), Strasbourg, Minden (?) Bamberg
Freising Duisbourg et Ratisbonne. Au-delà se trouve la Bohême et la ville appelée Prague, commencement du
pays de la Slavonie. Les Juifs qui y habitent l'appellent Canaan, parce que les habitants vendent leurs fils et leurs
filles à toutes les nations, de même que ceux de Russie..."
Soit le tableau:
Chateaubriand A.I.U Shatzmiller
Andernach Andernach Andernach
Bamberg Bamberg Bamberg
Bengen Bengen Bingen
/ Bonn Bonn
Caub / Kaub
Coblentz Coblence Coblence
/ Cologne Cologne
Creutznach / /
/ / Duisbourg
Freising Freising Freising
Gemersheim Gemersheim /
/ / Kartania
Mantern Mantern /
/ Metz Metz
/ / Minden
/ / Mistran
Munster Munster Munster
/ Nuremberg /
Reguenspurch Regensburg Ratisbonne
Strasbourg Strasbourg Strasbourg
/ Trèves Trèves
Tsor / /
/ Worms Worms
/ Würzburg /
Etranges divergences ! Mais ça ne fait que 24 villes, dont 8 font l'unanimité et au moins trois semblent très
difficiles à identifier. On ne voit ni Spire, ni Magdebourg, Mayence ou Francfort. Comme Benjamin n'y est pas
allé, il peut s'agir aussi bien d'oublis que de disparitions.
Le même ouvrage nous apprend: (ibidem 1310): (à Constantinople) "des marchands viennent des pays de
Babylone, de Sinéar,(qui me dira où il se trouvait ?) de Perse, de Médie et de tout le royaume d'Egypte, de la terre
de Canaan, du royaume de Russie, de Hongrie, du pays des Petchènègues, de Khazarie, de Lombardie et
d'Espagne". Ce qui prouve:
a) que la Khazarie existait toujours (du Plan Carpin a vu des Khazars en 1246, sous le joug mongol)
b) Benjamin a vu à Constantinople des musulmans, catholiques, karaïtes et Juifs, mais pas de Turcs.

une langue bizarre
26
voyage en zig-zag
Benjamin énumère les chefs de famille juifs (CHATEAUBRIAND 1325,29): "4 à Barcelone, 6 à Montpellier, 300 à
Marseille, 1 à Corfou, 50 à Tibériade, 50 000 à Samarcant, 1 000 à Bagdad, 300 000 qui habitent les villes et
autres lieux du pays de Théma, (Teymen, Yémen) 20 à Messine, 1 500 à Palerme.." On voit qu'en Chrétienté, les
Juifs ne sont qu'une poignée, sauf à Palerme alors normande. Le trajet semble erratique, mais pas du tout:
embarquement à Barcelone, escales à Palavas et Marseille, visites en Provence, Italie puis vers Corfou,
Constantinople, la Palestine, détour par Samarcande et Bagdad (?), embarquement à Bassorah vers le Yemen,
retour par l'Egypte et la Sicile. (BARNAVI) ne croit pas au Yemen, pourtant escale de la navigation de Bagdad à
l'Egypte. Je doute de Samarcande. Il ne passa pas par l'Allemagne, se contentant d'ouï-dire.
au pays des cours d'amour
Ayant parlé toulousain avant le français, j'ai eu le cœur serré à lire les chiffres de Benjamin lorsqu'il passe en
Occitanie: 4 à Barcelone, (linguistiquement cousine des Occitans) 6 à Montpellier ! Alors que j'étais persuadé que
l'Occitanie était bien plus accueillante que le reste de la Chrétienté, on voit que 40 ans avant le début de la
Croisade des Albigeois (1208 à 1250) la situation des Juifs ne devait pas y être brillante, sauf à Marseille. Or les
Croisés reprochaient aux Albigeois d'être trop tolérants envers les Juifs !
digression polonaise
Presque aux mêmes dates, Patatiah de Ratisbonne va à Bagdad par la Pologne, où pourtant la présence juive ne
sera attestée que plus tard. (Wroclaw / Breslau: 1280). Comment fit-il pour le minian des veillles du Sabbat ?
(assemblée de 10 mâles au moins) En 1500, (JOHNSON 273), estime le nombre de "polaks": 20 à 30 000 au plus.
Pour atteindre 150 000 en 1575, qu'il suppose des expulsés d'Europe occidentale.
La guerre de 30 ans, 1618 /1648, fut, selon (ibidem 276) un renouveau, grâce aux "princes marchands" de
Prague, tels Marcus Meisel, qui finança la guerre de Rodolphe de Habsbourg contre les Turcs, et Jacob Bassevi,
qui lui permit de reprendre Prague. Cette longue tuerie força Suédois et Allemands à recourir aux Juifs pour leur
intendance, seuls neutres capables d'évoluer dans tous les camps. Financiers et courtiers juifs en profitent pour
obtenir plus de tolérance. Les Juifs de Pologne s'enrichissent (les pans polonais plus encore) en fournissant les
belligérants. Ce faisant, ils s'attirent la haine des paysans plus exploités que jamais. Or, les seigneurs (catholiques)
rusés envoyaient "leurs" Juifs extorquer les récoltes aux paysans (orthodoxes) indignés contre ces "vampires
malgré eux". Cause probable de la révolte cosaque de 1648.
Et d'un antisémitisme tenace jusqu'à nos jours.
hochepots voyageurs
Mon dictionnaire yiddish à: hotseplots "lieu imaginaire au bout du monde, Fouillis-les-Oies". (Sholem
Aleykhim écrit: hotseklots) Selon DA, en alsacien, Hotzeblotz: "plat réalisé avec des restes de viande" En
slovaque, hocičo (hotsitsho): "n'importe quoi" Expliquant ces ressemblances curieuses à mon frère Jacques, il
remarqua qu'un hochepot de chez nous ressemble fort à ce "hotzeblotz" (le Petit Robert 1990 ignore ce plat et le
Petit Larousse 1990 explique: "Pot-au-feu à base de queue de porc, poitrine de bœuf & mouton & légumes divers,
spécialité flamande" En allemand (Garnier 1942) hochepot se traduit: Hotschpott, Fleisch-ragoût mit Rüben und
Kastanien (ragoût de viande avec navets et châtaignes) Or, en un récit de voyage, un anglais déguste un hotpot aux
Falkland (Iles malouines) mais sans donner la recette. Je me précipite sur mon Webster's qui l'ignore mais indique:
hotch-potch = fatras. Bien sûr, un dico Garnier récent le décrit "ragoût aux navets ou châtaignes". Un autre,
anglais: hodge-podge: fouillis. Avouez que ce vocable, peu courant, ne manque pas de sources, où seuls, hot
anglais et pot français sont compréhensibles, mais peu. Un vrai hotchpotch international anglo-slovaco-alsaco-
germano-flamando-franco-yiddish-auvergnat ! Dieu merci, l'espagnol ne connaît que hogaza, pan de salvados
(pain perdu) autrement dit fait avec des restes rassis .
Mais hoh poaz (prononcer: khokh pozz) breton, c'est un cochon cuit.. ("hog", cochon anglais, est proche cousin
du "hoh" armoricain ) Si, à Dieu ne plaise, j'étais féru d'étymologies, je commencerais par un constat: les seuls
mots qui fassent sens ensemble viennent du breton....dont mon dico ignore ce hochepot ! Et le plus proche (au son)
de ce breton, c'est hochepot, français, qui doit avoir été adopté voici belle lurette, sans doute en pays gallo. Hélas,
on ne peut reconstruire l'arbre généalogique de ce vocable voyageur car les mots n'ont pas d'ADN tant qu'ils ne
sont pas sur papier. Quel romancier pourrait imaginer plus bizarres aventures, des forêts slovaques aux îles
Malouines ? C'est bien la preuve que l'étymologie est un genre de poésie, on commence par vouloir donner un
sens plus pur aux mots de la tribu, et on finit par se balader dans le Temps et l'Espace sur les ailes du rêve ! En se
nourrissant d'un ragoût de châtaignes et de cochon désordonné. Tout en pensant que mes textes sont un vrai
hotseplots !

une langue bizarre
27
LITUANIE
Victoria Martsinkya Vitshute (Hippocrene, New-York 1997) complète mon yiddisho-européen: J'extrais
quelques vocables. Commençons par les (rares) ressemblant au yiddish de ce langage "proche du sanscrit" ai-je lu
jadis.
Lituanien français yiddish autre le plus proche
boba femme, épouse
bobute grand'mère bobe biélorusse: babulya
bulvé pomme de terre bulbe biélorusse: bulba
garstyčia moutarde gorshitse russe: gorshitsa; gaulois: garua
guo'lis lit geleger breton: gwele; gaulois: uolegion
kišene poche keshene polonais: kieszen
kilke sprat kilkes
lélé poupée lyalke polonais: lalka
té 'tis père tate alsacien, gaulois: tate, tatis
Très peu nombreux (sauf erreurs dues à mon ignorance), mais souvent importants: père, grand'mère, lit. Les
ressemblances sont bien plus nombreuses avec russe, biélorusse et polonais: seimy'na (famille) vient-il du russe
siemya, du biélorusse siamya, de l'ukrainien simya, ou à l'inverse, du balto-slave originel ? ou de semina latin ?
J'emploie le lexique de M. (RICOLFILS), dont j'ai retrouvé pas mal de mots dans l'ouvrage de Mr (LAMBERT), un
des meilleurs "gaulistes" actuels, qui me confirme sa pertinence. Les ressemblances gauloises semblent concerner
des rapports assez sommaires, un vocabulaire de voyageurs en pays inconnu:
gaulois et lituanien
lituanien gaulois français lituanien gaulois français
bala balta marais baseinas baccinon bassin
batas bondos botte bebras bibros castor
briauna bariga berge brüzgai bruscia broussaille
büda bota cabane burbéti br: bourboutal grommeler
draugas drutos ami drütas druto épais, dru
galia gallia vaillance gleivès glutis glu, viscosité
garstyčia garua moutarde guolis uolegion lit
kaminas camminos cheminée kat cattos chat
kraujas cruos sang obuolys aballo pomme
ratas rato roue rudas rudos rouge
saul saulo soleil slidus slimno glissant
tauta teutos peuple, gens tétis tatis père
vilkas ulcos loup vilna ulana laine
yla ala alène
Quelques uns s'expliquent par l'indo-européen. Mais ces "balto-slaves d'allure gauloise", peu nombreux
semblent pourtant très voisins du gaulois. Je suppose qu'ils sont surtout emprunts, plutôt que d'une langue-mère, à
marchands des vieilles routes de l'ambre: lit, pomme, grommeler, etc... Un sabir d'aubergistes.
ambre balte
Quel nom les Gaulois donnaient-ils à l'ambre ? Etait-il voisin du "gintaras" lituanien ?
Rappelons qu'ambre viendrait sans doute de l'arabe anbar, d'où ambra russe et serbo-croate, omar gaélique, omra
irlandais, amfer gallois, Bernstein allemand, bursztyn polonais et biélorusse, anbar hébr. mod.
Mais le latin succinum, le grec elektron, le breton goularz, l'ukrainien et le russe yantar ?
Pour (CHEVALLIER Raymond, 360) selon Tacite, les Barbares disaient glesum, d'où l'allemand Glas (verre)
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%