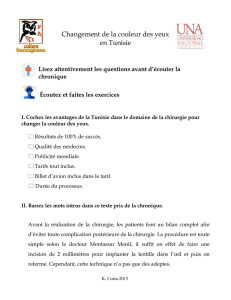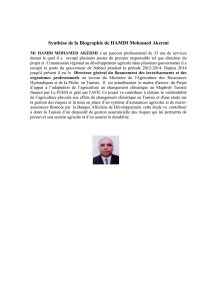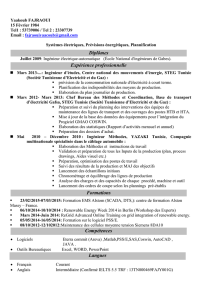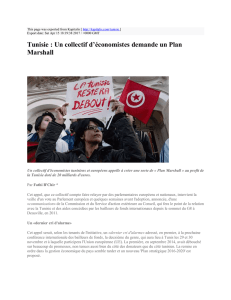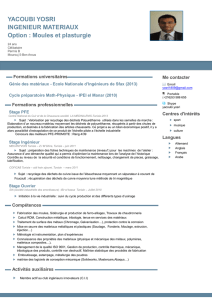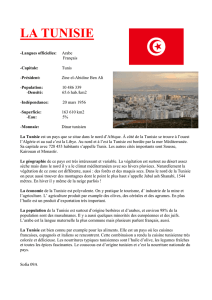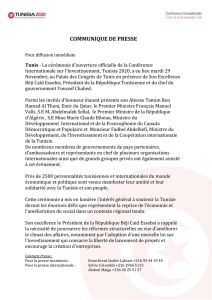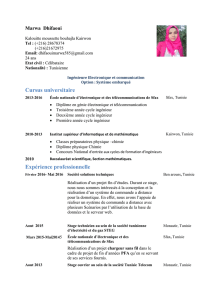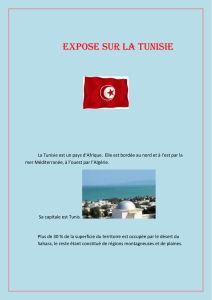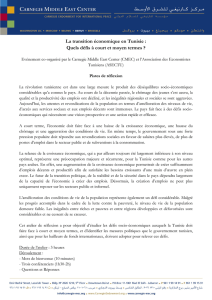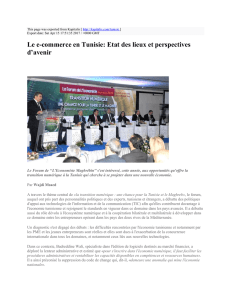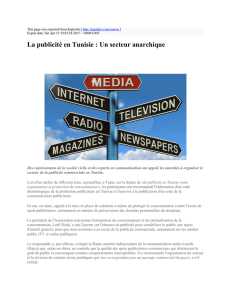Les engagements non tenus du partenariat de Deauville

This page was exported from Kapitalis [ http://kapitalis.com/tunisie ]
Export date: Sat Apr 15 20:43:51 2017 / +0000 GMT
Les engagements non tenus du partenariat de Deauville (2e
partie)
L'échec du partenariat de Deauville s'explique par l'incapacité du G7 et de l'Union européenne à
développer une vision équilibrée de leurs relations avec les pays sud-méditerranéens.
Par Ahmed Ben Mustapha *
La première partie de cet article (Les engagements non tenus du partenariat de Deauville) a permis de situer le
«partenariat pour la démocratie» de Deauville dans le cadre évolutif des relations nord sud et d'en souligner la
caractéristique principale – supposé le distinguer des autres précédents cadres stratégiques ayant régi les
rapports de le Tunisie avec l'Europe et le bloc occidental – à savoir la priorité accordée à la promotion de la
démocratie en Afrique du Nord et au Moyen Orient. Et cette réorientation était censée traduire dans les faits un
changement radical des politiques occidentales en direction de la Tunisie post révolution et les autres pays
arabes touchés par la vague de soulèvements contre les dictatures.
Il convient de rappeler que le précédent tournant historique à l'échelle régionale ou mondiale remonte aux
années 90 et correspond à la première guerre du Golfe consécutive à l'effondrement de l'URSS et la fin de la
guerre froide; celle-ci ouvre la voie au «nouvel ordre mondial» symbolisé par un monde unipolaire dominé par
les Etats-Unis et ses alliés européens qui ambitionnaient d'étendre au reste de la planète les «valeurs du monde
libre» notamment celles de l'économie de marché et du libre échange.
Au plan diplomatique, les accords d'Oslo de 1993 et le processus de Barcelone de 1995 étaient censés mettre
un terme au conflit arabo-israélien et favoriser l'émergence d'une zone méditerranéenne de paix, de sécurité, de
prospérité partagée et de libre échange entre les deux rives.

Le processus de Barcelone : 1er partenariat global entre les deux rives
Cette période coïncide avec l'émergence de la notion de «partenariat Euro Med» initié par l'Union européenne
(UE) axée pour la première fois sur la mise en place en commun d'un nouveau cadre global de coopération
stratégique incluant les dimensions politiques, sécuritaires et économiques au bénéfice de tous les pays du
bassin méditerranéen.
S'agissant de la Tunisie, le changement de régime opéré en 1987 après le renversement du président Bourguiba
correspond à une extension de la politique d'ouverture économique et d'insertion dans la mondialisation et
l'économie de marché initiée dès 1986 par le plan d'ajustement structurel (PAS) recommandé par le Fonds
monétaire international (FMI) avec son cortège de privatisations et de libéralisation des investissements au
profit du capital étranger.
Et c'est dans ce contexte que la Tunisie adhère tout naturellement à l'Organisation mondiale du commerce
(OMC) en 1994 avant d'être le premier pays de la rive sud à conclure avec l'UE, en 1995, l'accord de libre
échange des produits industriels, qui était le premier à s'inscrire dans le cadre d'un partenariat global prévoyant
l'extension du libre échange à tous les autres secteurs économiques, prélude à l'intégration de la Tunisie dans
l'espace européen.
A noter que l'accord incluait des dispositions d'encouragement à l'ouverture politique et au respect des libertés
en Tunisie mais dans la réalité des faits c'est sa dimension essentiellement commerciale qui a prévalu au
détriment des valeurs de démocratie et de liberté qu'il était également censé promouvoir.
En fait ce sont les considérations sécuritaires liées à l'engagement de la Tunisie et des autres pays arabes dans
la «guerre contre le terrorisme» initiée par les Etats-Unis et leurs alliés consécutivement aux attentats du 11
septembre 2001 et la lutte contre les migrations clandestines – outre leur insertion sans limite dans l'économie
de marché – qui ont été les facteurs déterminants justifiant le soutien occidental sans faille accordé jusqu'à la
fin aux régimes arabes en dépit de leurs défaillances démocratiques.
Quant aux processus politiques d'Oslo et de Barcelone censés se traduire par l'édification au bout de cinq ans
d'un Etat Palestinien, et la normalisation des relations entre les pays arabes et Israël – préludé à l'édification
d'un espace de paix, de sécurité et de prospérité partagée – ils aboutiront à un échec consacrant le retour à
l'instabilité politique régionale dans un contexte de recrudescence de la crise économique mondiale de 2007 et
2008.
Crise du modèle économique et chute des dictatures
En fait cette crise persistante traduit également l'essoufflement du modèle de l'économie de marché et du libre
échange dominé par les puissances occidentales, qui s'était imposé après la fin de la guerre froide comme étant
l'unique mode de croissance et de gestion de l'économie mondiale ainsi que des échanges commerciaux à
l'échelle planétaire.
A noter que les répercussions négatives de la crise de 2008 ont touché de plein fouet la Tunisie et autres pays
du sud du fait de leur dépendance économique quasi exclusive voire excessive à l'égard de l'UE et elle a sans
doute contribué à accélérer la chute des dictatures arabes.
En outre, cette crise semble avoir été accentuée en Europe par la montée des nouveaux pays émergents qui se
positionnent en redoutables concurrents mettant en péril la prééminence occidentale dans ses marchés et zones
classiques d'influence.

Et c'est dans ce contexte que survient la révolution tunisienne et les autres soulèvements arabes qui semblent
prendre au dépourvu les pays occidentaux, lesquels s'empressent d'y répondre par le nouveau «partenariat
pour la démocratie» de Deauville censé traduire une nouvelle approche stratégique des relations Nord-Sud.
Les causes de l'échec du partenariat de Deauville
Cinq ans après son lancement, il est légitime de s'interroger sur les raisons de l'échec du partenariat de
Deauville dans la concrétisation des principaux objectifs qu'il s'était assigné dont notamment celui de favoriser
les conditions de stabilité économique et politique propices à la promotion de la démocratie et la réussite de la
transition politique et économique en Tunisie et dans les autres pays du «printemps arabe».
Bien entendu, il ne s'agit pas de faire assumer au G7 la responsabilité de l'effondrement économique de la
Tunisie post révolution ainsi que de sa démocratie chancelante et son instabilité politique consécutives
essentiellement aux choix politiques, économiques et constitutionnels suivies par les responsables
gouvernementaux tunisiens de même que leur incapacité à défendre et à faire respecter les droits et les intérêts
du peuple tunisien.
Mais le non respect des engagements pris dans le cadre du processus de Barcelone puis la déclaration de
Deauville – qui ne sont pas seulement d'ordre financier mais également politiques et sécuritaires – a sans doute
été un facteur aggravant voire déterminant non seulement dans la dégradation continue des indicateurs
économiques et financiers tunisiens mais également dans l'instabilité politique locale et régionale qui a
gravement hypothéqué la «transition démocratique» en Tunisie.
A ce propos, des éléments d'appréciation seront soulignés dans ce qui suit…
* Sur «le moyen et le long terme», le G7 s'était engagé à introduire un «changement stratégique dans
l'approche de la communauté internationale dans la région» avec pour objectif d'aider les pays du partenariat
«à répondre à leurs défis économiques et à accomplir une transition durable alliant démocratisation et
élargissement des opportunités économiques sur la base des priorités définies et approuvées par les
gouvernements nationaux à l'issue d'une large concertation avec les parties prenantes concernées».
Il convient de souligner qu'un tel engagement clé suppose la latitude laissée à la Tunisie d'établir les bilans des
politiques économiques passées, de débattre démocratiquement des causes de l'échec de son modèle de
développement et éventuellement de reconsidérer ses choix et ses priorités économiques.
Or, dans la réalité des faits, le G7 a hypothéqué voire empêché un tel débat en liant les promesses d'aide
financières au maintien des orientations économiques d'insertion de la Tunisie dans le libre échange et
l'économie de marché ainsi que la prise en charge de l'endettement inconsidéré et partiellement «odieux» de
l'ancien régime. Ainsi les soutiens financiers promis dans la déclaration de Deauville étaient réservés
uniquement aux pays du partenariat qui confirment «le choix de l'économie de marché… et de l'intégration
dans l'économie régionale et mondiale grâce au développement du commerce et des investissements étrangers
dans la région» par le biais du libre échange.
A cet effet, le onzième point de cette déclaration promet un accroissement des échanges et des investissements
au profit des pays qui procèdent à des réformes dans le sens de l'ouverture économique. Sur cette base «l'UE
prend des initiatives dans le cadre du partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée pour
développer les échanges commerciaux avec les pays du sud de la Méditerranée, notamment par des accords de
libre échange approfondis et complets et des investissements, des accords sur l'autorisation de produits
industriels…».
Et c'est dans ce cadre que la Tunisie a été acculée à conclure dès 2012 puis en 2014 avec l'UE le plan d'action
quinquennal 2013- 2017 qui a ouvert la voie à la conclusion du partenariat pour la sécurité ainsi que les

négociations sur l'Accord de libre échange complet et approfondi (Aleca) qui suscite une vive controverse en
Tunisie car jugé par les spécialistes déséquilibré et nuisible aux intérêts de la Tunisie.
En outre, la Tunisie s'est trouvée, sous la pression de la crise économique et financière, contrainte de recourir
depuis 2013 au FMI et à la Banque mondiale en partie en raison du non respect des engagements de Deauville.
Ce faisant, la transition et le débat démocratique ont été d'emblée tronqués voire vidés de l'essentiel de leur
substance du fait que le choix du libre échange ainsi que les principaux dossiers stratégiques y associés – dont
les relations avec l'UE et le G7, la révision du modèle de développement, le surendettement, la politique
étrangère… – se sont trouvés dès le départ exclus du débat national tant dans les moyens d'information que lors
des échéances électorales.
Dès lors l'opinion publique et la société civile tunisienne ont ainsi été maintenues – contrairement aux
engagements également pris à Deauville – à l'écart des décisions prises ou des négociations engagées sur les
grands dossiers qui engagent l'avenir de la Tunisie en particulier pour ce qui a trait aux accords stratégiques
avec l'UE portant extension du libre échange (Aleca) ainsi que la politique d'endettement bilatérale ou
multilatérale incluant les financements et ajustements structurels conditionnés négociés depuis 2013 puis à
nouveau en 2016 avec le FMI et la Banque mondiale.
* Aucune information ou explication n'a été donnée à l'opinion publique tunisienne sur les raisons ayant
justifié le non respect des engagements pris de restituer ses avoirs volés au peuple tunisien et de l'octroi à la
Tunisie de financements à des conditions préférentielles. A cet effet, le G7 avait recommandé à Deauville aux
institutions financières internationales et au FMI l'élaboration rapide d'un «plan d'action commun» adapté à
chaque pays concerné en veillant à en préserver la cohérence «avec des cadres macroéconomiques de moyen
terme soutenables».
De même la Tunisie avait été conviée au sommet du G7 tenu en Allemagne en juin 2015 mais aucune suite n'a
vraisemblablement été donnée à ses demandes d'aide «exceptionnelles» également présentées à nouveau en
avril 2016 lors de la tenue du conseil d'association Tunisie-UE.
Si ces engagements avaient été tenus, la Tunisie aurait probablement évité l'effondrement de ses équilibres
financiers et préservé une relative autonomie décisionnelle dans la détermination de sa politique économique et
la gestion de ses ressources financières.
Mais il ne faut pas perdre de vue que la préoccupation stratégique première du G7 était de préserver la rive sud
dont la Tunisie en tant que marché exclusif et zone d'influence politique et économique privilégiée au seul
bénéfice de l'Occident et notamment des ex-puissances coloniales ayant des intérêts particuliers dans la région.
Or la dépendance financière demeure l'outil privilégié pour réaliser cet objectif et le G7 ainsi que l'UE n'ont
pas hésité à en user et à en abuser face à des gouvernements avides de financements «toxiques» –
indépendamment des conditions draconiennes y associés – et inconscients des dangers inhérents à l'engrenage
fatal du surendettement.
Concevoir en commun d'un nouveau cadre de partenariat global
En somme, la faillite du partenariat de Deauville s'explique en grande partie par l'incapacité du G7 et de l'UE à
se départir des anciennes politiques et à développer une réelle vision d'avenir novatrice et équilibrée de leur
relations avec les pays de la rive sud de la Méditerranée, tenant compte des écarts de développement et des
intérêts des deux parties.

Dans un contexte de retour à un nouveau monde multipolaire, ils redoutent la remise en cause du modèle
économique du libre échange qui a servi de cadre à leur domination politique et économique mondiale ainsi
que sur la rive sud de la Méditerranée. Et leur stratégie consiste à empêcher les puissances rivales émergentes
de menacer leurs intérêts dans la région.
Et c'est ce qui explique la volonté du G7 et de l'UE à monopoliser la conception des cadres de coopération et
de partenariat qui ont régi leurs relations avec la rive sud et la Tunisie y compris l'Aleca en leur imprimant une
dimension essentiellement commerciale au même titre que les accords de première et seconde génération
notamment ceux de 1969 , 1976 et 1995, qui ont servi de cadre stratégique régissant les relations tuniso-
européennes depuis l'indépendance.
C'est pour cela que la Tunisie devrait à ce stade négocier avec le G7 et ses partenaires européens un nouveau
cadre de coopération et de partenariat global conçu d'un commun accord et adapté à ses besoins spécifiques.
Avec pour objectif la conclusion d'un contrat de développement et de partenariat technologique et scientifique
tenant compte des relations historiques et des intérêts de l'UE tout en permettant à notre pays de se
métamorphoser économiquement en vrai pays industriel et agricole émergent pouvant tirer profit du libre
échange avec l'Europe.
Mais ce nouveau partenariat ne saurait se limiter aux intérêts purement commerciaux; il devrait s'insérer dans
le cadre d'un nouveau projet régional de partenariat global politique et économique inspiré par la diplomatie
tunisienne et orienté vers la réhabilitation des valeurs de démocratie, de sécurité et de prospérité partagée entre
les deux rives de La Méditerranée.
* Diplomate et ancien ambassadeur.
Premier article:
Les engagements non tenus du partenariat de Deauville
Post date: 2016-06-22 09:00:29
Post date GMT: 2016-06-22 08:00:29
Post modified date: 2016-06-22 09:00:29
Post modified date GMT: 2016-06-22 08:00:29
Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com
1
/
5
100%