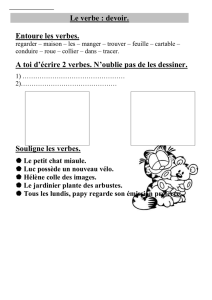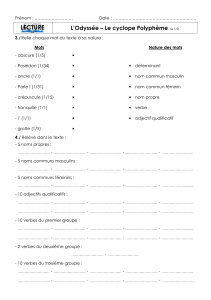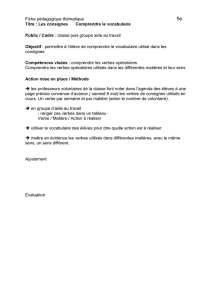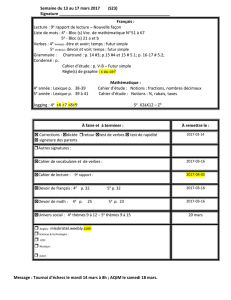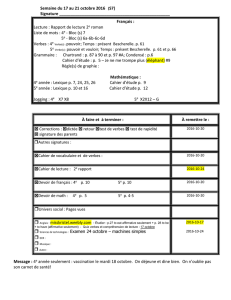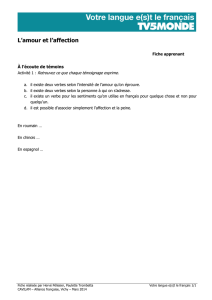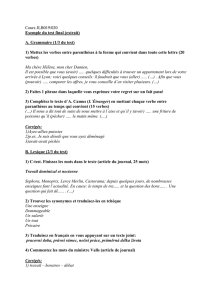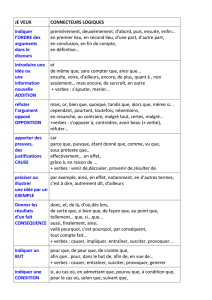meemoireCuppsats20065B25D - Lund University Publications

2
2
Remerciements
Je voudrais principalement remercier ma famille qui m’a donné le goût des langues et la
possibilité de les appliquer en voyageant. Je remercie donc mes parents, Rémi et Ana, pour le
français et surtout ma mère qui m’a également introduit à l’anglais et au portugais. Merci
aussi à Ronny pour toute l’aide avec le suédois et Mats pour être un petit frère adorable.
Fredrik, merci pour ton support pendant tous les mois que j’ai passé devant l’ordinateur.
Un grand merci à la famille D. dont les enfants sont les sujets de mon corpus. Merci pour
m’avoir si chaleureusement acceuillie chez vous.
Je remercie Jonas Granfeldt pour son aide avec le programme informatique CHAT. Enfin,
toute ma gratitude à Suzanne Schlyter, ma directrice de mémoire, qui pleine de patience m’a
guidé et aidé tout au long de ce mémoire.

3
3
Table des matières
1. Introduction et but ........................................................................................................4
2. Cadre théorique..............................................................................................................5
2.1 Les stades de développement en français L2 selon Bartning et Schlyter.................5
2.2 Les critères du niveau grammatical de Heinen et Kadow.........................................7
3. Présentation du corpus ...............................................................................................8
3.1 Les sujets d’étude..........................................................................................................8
3.2 Les enregistrements....................................................................................................10
3.3 Les transcriptions........................................................................................................11
4. Méthode d’analyse.......................................................................................................12
5. Analyse.............................................................................................................................13
5.1 Longueur Moyenne d’Énoncé (LME).......................................................................13
5.2 Structuration nominale et verbale.............................................................................16
5.3 Finitude........................................................................................................................19
5.4 Accord sujet-verbe......................................................................................................19
5.5 Temps, mode et aspect des verbes.............................................................................23
5.6 Subordination..............................................................................................................28
5.7 Approximation de stades finals d’après les critères de Bartning et Schlyter........29
5.8 Les critères de Heinen et Kadow...............................................................................30
5.9 Alternance codique......................................................................................................31
6. Conclusion et discussion............................................................................................34
Bibliographie.......................................................................................................................37
Appendice
1. Le tableau de Bartning et Schlyter
2. Les transcriptions des interviews
2.1 Arthur et Céline
2.2 Antoine
2.3 Annelie
2.4 Marie
2.5 Charles
3. La bande dessinée
4. Les transcriptions des récits (BD à l’oral)
4.1 Arthur
4.2 Céline
4.3 Antoine
4.4 Annelie
4.5 Marie
4.6 Charles
5. Les résumés (BD à l’écrit)

4
4
1. Introduction et but
Avec l’augmentation des loisirs, le tourisme à l’étranger est aujourd’hui accessible à
beaucoup de monde. Mais nombreux sont ceux qui s’installent dans un pays pour y travailler
ou y étudier. Il y a aussi beaucoup de personnes qui recommencent leur
vie dans un nouveau pays : les immigrés, les réfugiés et autres. Avec les autochtones cela fait
un grand mélange de cultures. De ces sociétés multiculturelles pleines de savoirs, et espérons-
le, de respect mutuel, vont naître de nouvelles générations. Ces enfants ont, si les conditions
sont bonnes, la chance de devenir bilingues et même peut-être plurilingues. Mais qu’est-ce
que le bilinguisme ?
La première définition du mot bilingue qui vient à l’esprit est sûrement : quelqu’un qui parle,
connaît deux langues. Cette définition est identique avec celle que nous donne le dictionnaire
le Petit Larousse Illustré (1991). Le Petit Robert précise ce terme en disant qu’un bilingue est
une personne « qui parle, possède parfaitement deux langues » (2004). Mais que signifie la
possession parfaite d’une langue ? Et qui peut s’en flatter ? Comblain et Rondal (2001)
affirment que le « bilinguisme parfait ne peut sans doute être atteint. Une langue domine
souvent l’autre, elle est mieux connue et plus fréquemment utilisée [...] » (2001:28). Mais « Il
existe plusieurs définitions du bilinguisme ; il est dit parfois qu’il y a autant de définitions que
de chercheurs » (Virta, 1983 ; d’après Osbeck-Svensson, 2001:1). Lietti (1994:68) écrit avec
humour que « par souci de cohérence, de nombreux linguistes appellent « bilingue » aussi
bien l’enfant élevé à travers deux idiomes dès le berceau que l’adulte en première semaine de
son cours Berlitz ».
Chaque cas de bilinguisme est un cas particulier (Kielhöfer et Jonekeit, 1994) et nous allons
dans ce mémoire décrire et analyser, à partir de notre corpus, le français de six enfants d’une
famille franco-suédoise, âgés de 7 à 15 ans, qui ont déménagé de la France vers la Suède il y a
quatre ans. Notre but est de décrire le français spontané de ces enfants et d’indiquer leur
niveau de développement linguistique en nous basant sur l’étude d’Inge Bartning et Suzanne
Schlyter : Itinéraires acquisitionnels et stades de développement en français L2 (2004), et les
critères du niveau grammatical d’enfants monolingues francophones de Sabrine Heinen et
Helga Kadow (1990). Pour parvenir à notre but nous établissons aussi la Longueur Moyenne
des Énoncés (LME) des enfants et identifions leur cas d’alternance codique. Nous pensons
que les enfants les plus âgés ont un français plus nuancé, ceci dû aux nombres d’années

5
5
vécues en France pendant lesquels leur français a pu se développer. Nous espérons que nos
résultats nous permettrons de confirmer notre première impression qui est également notre
hypothèse.
Nous basons notre mémoire sur deux études, celle de Bartning et Schlyter (2004) qui traite
l’acquisition du français L2 d’apprenants adultes suédophones et celle de Heinen et Kadow
(1990) qui parle de l’évolution linguistique attendue chez des enfants monolingues
francophones entre l’âge d’environ un et trois ans. Ces deux études sont utilisées parce qu’il
n’y a pas de méthode spécifique pour évaluer le français d’enfants et d’adolescents bilingues
franco-suédois. Il est donc difficile d’évaluer réellement le niveau linguistique des enfants de
notre corpus d’après les critères de ces deux études, mais nous pensons toutefois arriver à
plusieurs conclusions et nous placerons approximativement les enfants dans les différents
stades proposés.
2. Cadre théorique
2.1 Les stades de développement en français L2 selon Bartning et Schlyter
Notre mémoire se base principalement sur l’étude Itinéraires acquisitionnels et stades de
développement en français L2 (2004) d’Inge Bartning, qui est professeur à l’université de
Stockholm, et de Suzanne Schlyter, professeur à l’institut d’études romanes à l’université de
Lund. Bartning et Schlyter ont pendant plusieurs années fait des recherches sur l’acquisition
du français comme deuxième langue et plus particulièrement sur l’existence de stades de
développement en français. Elles sont arrivées à des résultats en étudiant leur deux corpus,
InterFra et Lund où elles examinent l’acquisition L2 d’apprenants adultes suédophones, qui
indiquent que l’acquisition du langage suit une progression de six stades, allant du début de
l’acquisition jusqu’à la production quasi-native des apprenants. Leur intention est d’organiser
l’apprentissage du français en itinéraires :
Ces itinéraires, et les stades que nous essayons d’en déduire, reflètent l’acquisition du français
de l’apprenant suédophone, dans des situations orales spontanées où elle/il doit avoir recours à
ses connaissances automatiques. Le cadre de cette étude est donc descriptif et empirique. Un
objectif ultérieur est de servir de base à une évaluation du niveau grammatical d’un certain
apprenant à un moment donné. (2004:281)
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
1
/
38
100%