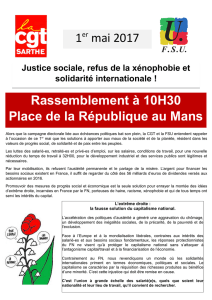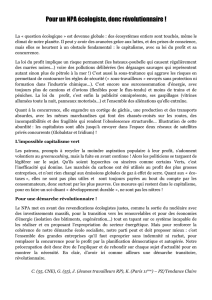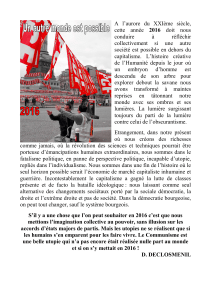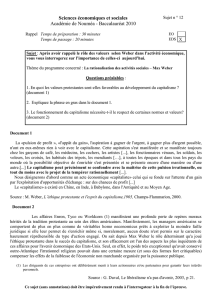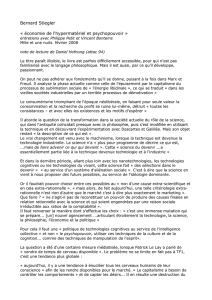Sens et enjeux de la transition vers le capitalisme cognitif : une mise

1
Sens et enjeux de la transition vers le capitalisme cognitif :
une mise en perspective historique
jeudi 7 octobre 2004, par Carlo Vercellone
url: http://seminaire.samizdat.net/article.php3?id_article=14
Sens et enjeux de la transition vers le capitalisme cognitif : une mise en
perspective historique [1]
par Carlo Vercellone [2
Papier présenté au séminaire
« Transformations du travail et crise de l’économie politique »
Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonn , 12 octobre 2004.
Cet article s’interroge sur l’hypothèse selon laquelle l’instabilité productive et
financière du capitalisme contemporain et sa difficulté à retrouver un sentier de
croissance stabilisé sont dues à une crise de mutation majeure et dont l’épuisement
du modèle fordiste n’aurait été que le point de départ. Cette grande crise de mutation
traduirait l’épuisement même de la logique de développement du capitalisme issue de
la première révolution industrielle. Elle correspondrait à la transition vers une
« nouvelle phase du capitalisme « qualifiée de « capitalisme cognitif » . Par ce concept
on désigne une transformation majeure du rapport salarial et des formes de la
concurrence dans laquelle la connaissance se présente de plus en plus comme l’enjeu
clé de la création de valeur et de l’accumulation du capital.
Cette hypothèse, dont l’élaboration reste au stade de programme de recherche, et
non à celui d’une construction théorique achevée, a déjà donné lieu à un nombre
important de publications et semble rencontrer désormais un certain écho aussi bien
en France qu’à l’étranger. Il faut noter également que cette hypothèse a bien
évidemment ses détracteurs, porteurs de critiques plus ou moins constructives.
Malheureusement, ces critiques sont parfois construites sur des lectures hâtives ou de
deuxième main. Il en a résulté une série de malentendus et d’interprétations
simplificatrices qui ôtent à l’hypothèse du capitalisme cognitif sa spécificité et son
contenu critique, en l’assimilant à une variante des analyses de la « nouvelle
économie « des NTIC ou aux approches d’inspiration néo-classique portant sur
l’économie de la connaissance.
Il importe donc de rappeler que la spécificité de l’hypothèse du capitalisme cognitif
tient tout autant au rejet du déterminisme technologique qu’à celui d’une approche
réductrice restreignant le domaine de l’économie de la connaissance aux activités
délibérées de production de savoir. Elle concerne aussi la critique d’une approche de
l’économie de la connaissance qui fait abstraction de l’histoire et de la transformation
des rapports sociaux et qui finit par appréhender le savoir comme un facteur de
production indépendant du capital et du travail.
La plupart des approches relatives à l’économie de la connaissance sont en fait
caractérisées par une vision a-historique, positiviste et non conflictuelle de la science
et de la technologie. Elle conduit à effacer les contradictions sociales, éthiques et
culturelles que le développement de l’économie du savoir engendre. Aussi l’une des
originalités de l’approche en termes de capitalisme cognitif se trouve-t-elle justement
dans le choix d’une méthode mettant l’accent sur l’historicité des économies. Elle
cerne la problématique de la connaissance dans sa dimension sociale et collective. Il
en résulte une grille de lecture qui renoue avec le rôle structurant des transformations

2
de la division du travail et qui met l’accent sur les conflits de savoir et de pouvoir qui
vont de pair avec le développement d’une économie fondée sur la connaissance. Il
s’agit, d’une certaine manière, d’un retour à la problématique qui, avec les pères
fondateurs de l’économie politique, et notamment Smith, avait été au coeur de
l’analyse de l’avènement du capitalisme industriel et du questionnement sur l’origine
et les causes de la richesse des nations. Dans cette optique, l’une des dimensions
essentielles de la mutation du capitalisme impulsée par la crise sociale du fordisme se
trouve dans les conflits qui ont conduit à la formation d’une intellectualité diffuse et
vers une nouvelle prépondérance qualitative des savoirs du travail vivant sur les
savoirs incorporés au capital et à l’organisation des firmes. Cette grille de lecture,
centrée sur le rôle moteur des transformations de la division capitaliste du travail, est
ainsi renouvelée et permet de s’interroger, cette fois-ci, sur l’hypothèse d’un
« crépuscule « du capitalisme industriel.
Il s’agit d’interpréter à ce prisme le sens de deux évolutions principales (et
contradictoires) du capitalisme contemporain : l’essor d’une économie fondée sur la
diffusion et le rôle moteur du savoir d’une part, et le développement d’une logique
d’accumulation reposant sur la captation de rentes financières et monopolistes,
notamment au moyen d’un processus de privatisation des savoirs et du vivant, d’autre
part.
Dans cette démarche, cet article s’articulera en trois parties.
La première partie sera consacrée à rappeler le questionnement à l’origine de la
formulation du programme de recherche autour de l’hypothèse du capitalisme cognitif
et la manière dont celui, loin de s’opposer, se propose de combler les insuffisances
d’une approche faisant de la finance l’acteur autonome et principal de l’ensemble des
mutations actuelles du capitalisme.
La deuxième comprendra des éléments théoriques et méthodologiques qui permettent
de mieux comprendre le sens de l’hypothèse du capitalisme cognitif. Nous mettrons
au clair deux dimensions essentielles : la première a trait à la spécificité de notre grille
de lecture par rapport à d’autres interprétations qui, elles, font référence aux concepts
de révolution informationnelle, d’économie de la connaissance ou encore d’économie
fondée sur le savoir ; la deuxième, concerne les fondements marxiens de la méthode
d’analyse et des catégories intermédiaires par lesquelles l’approche en termes de
capitalisme cognitif aboutit à une construction théorique du temps historique.
La troisième partie enfin, sera dédiée à resituer dans la dynamique longue du
capitalisme le sens et les enjeux de la mutation actuelle du capitalisme. Il y sera
proposée une périodisation fondée sur l’identification de trois « systèmes historiques
d’accumulation « : le capitalisme mercantiliste, le capitalisme industriel, puis le
capitalisme cognitif. Il s’agira notamment de montrer, à l’aide de quelques faits
stylisés, les ruptures principales qui caractérisent la crise du capitalisme industriel et
la transition vers le capitalisme cognitif. Il sera également question de mettre en
exergue la nature « nouvelle « des antagonismes et des contradictions qui
caractérisent l’essor du capitalisme cognitif.
I : L’origine du programme de recherche autour de l’hypothèse du capitalisme
cognitif : questions de méthode et hypothèses de lecture
Le programme de recherche autour du capitalisme cognitif naît du constat d’une crise
qui se prolonge depuis trente ans et qui a démenti tous les scénarios d’une
recomposition neo-fordiste ou post-fordiste de la régulation du capitalisme.
Pour identifier les éléments de nouveauté propres au mouvement actuel, il convient

3
au préalable de rappeler à grands traits la logique des restructurations du capitalisme
qui, jusqu’à la crise du fordisme, a caractérisé la dynamique longue du capitalisme
industriel.
Dans le capitalisme issu de la première révolution industrielle et qui a trouvé dans le
fordisme une sorte d’aboutissement historique, les rythmes économiques et sociaux
étaient scandés, durant des périodes relativement brèves, par des processus de
restructuration correspondant à la mise en place de paradigmes techno-productifs
successifs. Ces phases de restructuration intense, impulsées par une dialectique
complexe conflits/innovations (Dockès et Rosier, 1983, 1988), ont été le propre des
« grandes crises de mutation « du capitalisme : une « grappe « d’innovations
techniques, organisationnelles et institutionnelles radicales, était suivie par des
périodes relativement longues de consolidation d’un modèle productif s’inscrivant dans
un régime de croissance stabilisé. Certes cette grille de lecture est très schématique,
mais sa valeur heuristique est validée par de multiples travaux portant sur la
dynamique historique du capitalisme, qu’ils soient issus de la théorie de la régulation,
des analyses néo-schumpetériennes ou encore de la vision en termes d’ondes longues
à la Kondratiev.
Avec la crise du fordisme, on a cru de prime abord se trouver face à la réédition de
cette dynamique conflits-innovation-restructuration du capital. Les chercheurs comme
les gestionnaires se sont lancés à la recherche du nouveau modèle industriel
susceptible de remplacer celui de la production de masse en crise. Cette recherche
alimenta l’essentiel du débat sur la production de masse flexible et le modèle japonais
qui a accompagné la première vague de restructuration des années 1970-80.
Cependant, le modèle japonais n’a pas fait long feu. Le débat s’est alors déplacé sur
les « mythes de la nouvelle économie « des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et sur l’émergence d’un capitalisme patrimonial où la
socialisation de la propriété du capital, grâce au développement de l’épargne salariale,
aurait dû constituer le socle d’un nouveau compromis entre travail et capital se
substituant au compromis salarial de la période fordiste.
Last but not least, l’effondrement de la bulle spéculative sur laquelle a reposé le
miracle de la « nouvelle économie « et l’annonce de la mise en place d’un régime de
croissance tiré par la finance remet une fois de plus à l’ordre du jour la question de la
nature du mode de développement en devenir. Il conduit également à porter de
nouveau l’attention sur les transformations de l’organisation du travail et des modèles
productifs. Qui plus est, ce que nous pourrions qualifier, par un jeu de mots, de
« mouvement de restructuration structurel et continu « semble prendre la relève de la
dynamique propre au capitalisme industriel, marquée par l’alternance de périodes
brèves d’innovations radicales et de périodes plus longues d’innovations
incrémentales.
Pour développer une intuition féconde de Fernand Braudel, nous avons là une des
manifestations de l’épuisement du rythme typique des Kondratiev (propre au
capitalisme industriel), mais aussi d’une crise de mutation qui se poursuit sans
parvenir à définir les contours d’un « nouveau mode de développement stabilisé « :
tout se passe comme si cette crise devenait en elle-même une sorte de norme de
l’horizon économique contemporain, un mode de régulation s’imposant sous les
semblants d’une contrainte objective. Et ce alors que la montée du chômage et des
formes dites atypiques et précaires d’emploi ébranle le modèle du plein emploi
fordiste et le système de protection sociale assis sur la norme du contrat de travail à
durée indéterminée, la vie durant.

4
I.1. L’hypothèse insuffisante du capitalisme financier
Pour interpréter l’instabilité de la conjoncture historique actuelle, une première grille
de lecture est proposée par les tenants de la thèse du capitalisme financier. Le
capitalisme actionnarial aurait remplacé le capitalisme managérial et productif de
l’époque fordiste en imposant ses normes de rendement aux entreprises. Il en
résulterait un processus continuel de restructuration et de nouvelles formes de
gouvernance dont le but essentiel serait la maximisation de la valeur pour les
actionnaires. La logique de court terme et les comportements mimétiques en vigueur
sur les marchés financiers s’affirmeraient au détriment d’une logique de gestion
soucieuse du long terme et de l’emploi.
Aussi, selon Hoang-Ngoc et Tinel (2003) la finance aurait-elle joué un rôle premier et
en grande partie exogène au rapport salarial dans les changements institutionnels de
ces deux dernières décennies. Il en résulte que « d’un point de vue positif, l’hypothèse
de la crise du fordisme est peut-être à relativiser. Le coeur des mutations propres aux
vingt dernières années se situe moins dans le rapport salarial que dans le rapport
financier où les actionnaires ont durci leurs normes de contrôle résiduel « (ibidem, p.
4). En somme, c’est un changement des rapports de forces internes aux différentes
fractions du capital et du capital financier avec l’Etat qui aurait induit, « dans un
deuxième temps seulement, la redéfinition des normes dans les rapports salarial
« (ibidem), et ce dans un contexte de continuité substantielle par rapport aux formes
fordistes -industrielles de la division du travail et de la soumission du travail au
capital.
Ce type d’argumentation nous laisse largement insatisfait et contient de plus deux
risques majeurs :
celui de négliger la nouveauté substantielle de l’actuel processus de financiarisation,
en le reconduisant, comme le fait par exemple Arrighi (1994), dans une schéma
historique de récurrence de phases d’accumulation à dominante financière ;
celui de reléguer au deuxième plan le rapport antagoniste capital/travail à l’avantage
d’une vision de l’histoire mettant l’accent, dans la dynamique longue du capitalisme,
sur la primauté d’un autre type de contraste : le contraste perpétuel entre la logique
universelle d’expansion du capital argent, d’une part et les limites que les pouvoirs
politiques des Etats tendent à lui imposer, d’autre part [3]. Dans cette optique, la
phase historique actuelle correspondrait alors à un nouveau basculement historique
dans le rapport conflictuel entre le pouvoir des Etats et la tendance de la sphère
financière à échapper à toute réglementation.
Finalement, de cette analyse, il résulte que l’enjeu essentiel pour un processus de
sortie de crise serait de re-réglementer les marchés financiers en rétablissant, dans le
même mouvement, le pouvoir régulateur des Etats et les piliers institutionnels d’une
régulation fordiste du rapport salarial
Cette interprétation tend à surestimer la dimension antagonique du rapport
Etat/marchés, en négligeant la manière dont le pouvoir politique des Etats a souvent
été le protagoniste du processus de déréglementation et des réformes institutionnelles
à l’origine de la montée en puissance de la finance de marché et du capitalisme
actionnarial. Elle tend aussi et surtout à évacuer les relations complexes qui, sous
l’impulsion de la crise du rapport salarial fordiste, ont conduit à des mutations
structurelles de la division du travail et des mécanismes de valorisation du capital. En
fait, si la logique de la finance est en partie l’expression d’un pouvoir autonome et
structurant, son essor est, aussi et surtout le résultat de la crise du modèle
d’organisation fordiste.

5
La financiarisation traduit aussi la tentative du capital de s’adapter aux mutations qui
affectent les fondements les plus essentiels de l’efficacité économique et de la valeur
sur lesquels le capitalisme industriel a reposé. L’essor de la finance ne peut pas être
pensée sans le rapprocher de la crise des modalités industrielles d’extraction de la
plus-value. Il n’est pas seulement la cause, mais également la conséquence de la crise
du rapport salarial fordiste et de la montée de l’immatériel et du contenu intellectuel
du travail. C’est dans ce cadre que doit être interprété le processus de financiarisation
de l’économie sans le réduire, comme c’est parfois le cas, à un simple renversement
du rapport de force interne entre deux fractions du capital : le capitalisme
actionnarial, dont la logique de court terme, aurait imposé ses normes et remplacé le
« bon vieux « capitalisme managérial de l’époque fordiste soucieux de la production et
de l’emploi.
Les transformations de la division du travail, le rôle nouveau des actifs dits
immatériels et la montée en puissance de la finance sont des aspects interdépendants
des actuels processus de restructuration que connaît le capitalisme. C’est cette
interdépendance que l’hypothèse du capitalisme cognitif se propose d’explorer, en
restituant la primauté à une analyse fondée sur le rôle moteur du rapport
capital/travail.
Dans cette optique, quatre faits majeurs concernant la généalogie et la logique de
développement de la financiarisation peuvent être invoqués :
Le rôle de plus en plus central attribué à la finance par nombre de grands groupes
industriels débute au moment de la vague de conflits des années soixante-dix. Il va
significativement de pair avec deux autres volets relatifs aux premiers processus de
restructuration : l’automatisation et la décentralisation productive [4]. Nous avons là,
comme le note Revelli (1988), le point de départ d’une transformation structurelle qui
marque l’évolution vers une vocation financière de plus en plus prononcée du capital
industriel. Le capital prend ainsi, en privilégiant la forme argent par rapport à celle du
capital fixe, sa dimension abstraite et éminemment flexible et mobile, en opposition à
la rigidité de la force de travail et à la conflictualité endémique qui, à cette époque,
paralyse les firmes fordistes. Le processus d’accumulation s’efforce ainsi à se rendre,
en partie du moins, indépendant du procès de travail concret et du « pouvoir« des
salariés dans les entreprises. Cette stratégie va s’accentuer avec la montée du rôle du
travail intellectuel et immatériel ;
la diffusion du savoir, fondement d’une nouvelle qualité intellectuelle de la force de
travail, fait en sorte que la captation du surplus ne peut plus s’opérer par les formes
traditionnelles de mise au travail propres à la grande entreprise fordiste. C’est aussi
pourquoi le capital tend à se désengager des formes directes de contrôle de la
production pour privilégier des mécanismes de captation plus indirects, de type
marchand et financier. C’est ce que montre la montée en puissance de la finance mais
aussi le passage du modèle de la grande concentration productive de main-d’oeuvre
au modèle de l’entreprise réseau, selon des modalités qui peuvent parfois faire songer
à un retour du putting-out system
La montée des actifs immatériels et de l’intellectuel pose de redoutables problèmes
d’évaluation « du rapport entre coûts, performance et valeur « . Ainsi le rôle moteur
des connaissances et leur renouvellement rapide contribuent à expliquer la
financiarisation comme modalité essentielle d’évaluation et d’organisation de la
mobilité des ressources dans un contexte où « on passe en quelque sorte d’une
efficacité d’entreprise à une efficacité de système « (voir Veltz, 2000, chapitre 6).
Toutefois comme l’observe Halary (2004), la tentative du capital financier d’expliquer
le goodwill ou survaleur par l’existence d’actifs immatériels non spécifiés, est
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
1
/
35
100%