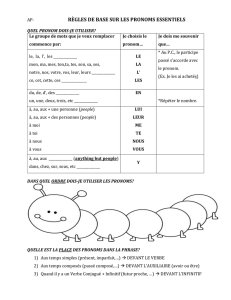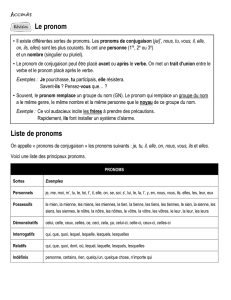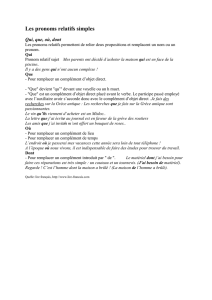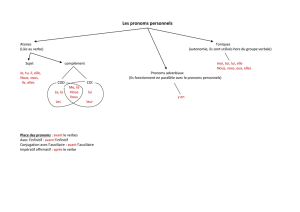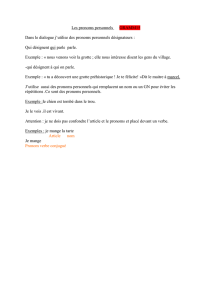Construire le sens à travers l`outil des indices personnels

1
Tzaneva Boryana
Université de Sofia « Saint Kliment Ohridski »
Université Stendhal Grenoble 3
Construire le sens à travers l’outil des indices personnels. L’exemple du texte
dramatique français et bulgare*
Dans l’édifice d’un texte chaque élément, se liant aux autres et interagissant avec eux,
concourt à la production du sens de l’ensemble. Le présent article se propose de se pencher
sur un type particulier d’éléments constitutifs du langage : les indices de personne.
L’optique d’analyse est celle d’une étude contrastive qui a pour objectif de relever les
particularités systémiques des indices personnels en passant par la confrontation de séquences
hiérarchisées et cohérentes déployées sur l’axe syntagmatique.
Le corpus retenu comprend deux pièces contemporaines – une française et une bulgare
– chacune appariée à sa traduction dans l’autre langue.
1
Depuis plusieurs décennies le théâtre attire dans son orbite des chercheurs d’horizons
de plus en plus divers. En considérant le dire théâtral comme une modalité entre autres de la
réalisation de la parole on a fini par s’affranchir de l’idée de sa valeur purement littéraire.
Néanmoins, pour légitimer sa prétention à la scientificité l’étude proprement
linguistique du texte théâtral ne pourrait se passer d’évoquer les particularités du genre
dramatique.
1. Le genre dramatique comme point d’appui d’une analyse linguistique : contraintes
et avantages
Les recherches allant dans le sens de la dimension linguistique du théâtre ont
longtemps insisté à définir le dialogue dramatique comme une mimesis plus ou moins parfaite
des échanges verbaux ordinaires.
Or la distance qui sépare ces deux types de production langagière ressort clairement si
on observe en parallèle un corpus issu de la transcription de conversations authentiques
enregistrées et un autre, tiré cette fois-ci de textes de théâtre. Les caractéristiques de l’oral –
répétitions, énoncés inachevés, chevauchements, etc. – sont presque absents du texte
* La variante du texte qui suit ci-dessus n’est pas définitive.
1
Yasmina Reza, « Art » ; Hristo Boytchev, Orchestre Titanic. (références détaillées ci-dessus)

2
dramatique : quand on en aperçoit des traces, celles-ci sont essentiellement à mettre sur le
compte d’une quête d’effets stylistiques effectuée par l’auteur. Le théâtre est un produit de
l’activité d’écriture et cette qualité première prédétermine dans une large mesure le
fonctionnement des structures linguistiques qu’il engendre.
Ceci dit, il semblerait pertinent de se demander si le discours théâtral, de par son
origine de texte écrit et intrinsèquement monologal (la voix unique de l’auteur multipliée dans
les voix des personnages), n’offre pas au linguiste un matériau d’analyse maigre et limité par
comparaison avec la conversation « spontanée ».
Le parti pris consistant à choisir pour objet d’étude un corpus écrit table sur deux traits
essentiels que présente le texte écrit. En premier lieu, sa facilité d’accès : on est dispensé des
multiples complications d’ordre instrumental qui accompagnent le traitement et la
transcription des séquences orales. En deuxième lieu, et c’est une raison bien plus forte, au
niveau scriptural les brouillages propres à l’oral sont écartés en sorte que l’image de la
situation linguistique s’y dessine avec une netteté accrue. Résultant de l’application
consciente des règles linguistiques, l’écrit est en mesure d’en fournir la représentation
systématisée plus aisément que l’oral
2
. Cela revient à dire que du point de vue du linguiste un
corpus constitué de textes dramatiques, comme tout autre corpus d’écrits littéraires, bénéficie
par rapport au corpus oral d’avantages tels que le dépouillement et la mise à nu de la
charpente même du langage.
Si le théâtre se démarque tout de même des autres genres de l’écrit tout en se
rapprochant de l’oral, c’est qu’il est destiné à être joué sur scène par des acteurs, i. e. à être
prononcé « comme si » c’était une vraie conversation.
Ainsi, on pourrait définir l’œuvre théâtrale comme espace situé à mi-chemin entre
l’écrit et l’oral. Le dispositif énonciatif qui s’y déploie porte l’empreinte de cette hybridité.
Comme cela a été montré par C. Kerbrat-Orecchioni la situation communicative qui s’instaure
au théâtre possède une structure tripartite. Trois niveaux d’instances énonciatives y sont
décelables. Le niveau de base incluant les deux autres mais caractérisé à la différence d’eux
par une relation dissymétrique est celui où l’auteur adresse son message au public. Le
deuxième niveau est réservé aux personnages. Le troisième niveau, quant à lui, appartient aux
acteurs qui ont pour tâche de faire passer l’écrit à l’oral.
3
2
Cf. la thèse que « [dans le théâtre] les règles du dialogue ordinaire sont souvent systématisées » (A. Petitjean,
1984, 78.)
3
C. Kerbrat-Orecchioni, 1985. Cette structure emboîtée propre à la communication théâtrale est plus complexe
que l’organisation discursive des échanges verbaux quotidiens qui s’effectuent, eux, entre partenaires situés au
même niveau.

3
C. Kerbrat-Orecchioni souligne que les maximes du discours n’agissent que sur les
personnages. Ceux-ci représentent la seule instance énonciative « conversationnellement
pertinente »
4
. Le niveau du texte brut où ils interagissent reste donc l’essentielle source de
données linguistiques.
2. La problématique des indices personnels
La catégorie de la personne étant une catégorie clé qui jouit d’une portée universelle, il
est légitime de tenter de l’appréhender en explorant ses diverses réalisations. Par indices
personnels on va désigner ici toutes les formes qui comportent l’idée de personne.
2.1. Extension du terme d’indice de personne
D’après J. Feuillet :
« […] la personne n’est pas une catégorie verbale, pas plus qu’elle n’est une catégorie nominale : elle
entretient simplement une relation avec le verbe ou avec le nom sous forme d’indice ou de pronom
« autonome ». »
5
On voit ici une distinction terminologique entre indices, d’une part, et pronoms,
d’autre part. Pour rendre compte de ce que recouvrent ces deux notions on va faire appel aux
travaux de D. Creissels.
La notion d’indice pronominal proposée par Creissels dans une optique de typologie
syntaxique se destine à embrasser trois sous-types d’éléments morphologiques. Au sein du
premier sous-type on retrouve notamment les pronoms conjoints français alors que le
troisième sous-type regroupe les désinences personnelles du verbe dans les langues comme le
latin – mais aussi le bulgare – désinences qui sont susceptibles d’être coordonnées à un
constituant nominal représentant l’argument sujet, mais dont la spécificité consiste surtout à
pouvoir représenter l’argument sujet à elles seules.
6
4
Ibid., p. 238. Un des effets de cet emboîtement de niveaux, c’est le « trope communicationnel », en vertu
duquel le public, par définition destinataire secondaire des répliques des personnages, en devient le destinataire
principal, ibid., p. 242.
5
Feuillet J., 2005, 17.
6
Creissels remarque au passage que, loin de signaler un fonctionnement véritablement pronominal des éléments
en question le qualificatif « pronominal » est censé refléter plutôt le fait que ces trois types d’indices
« représentent les étapes successives d’un processus de grammaticalisation dont le point de départ est la
cliticisation des pronoms personnels. » (Creissels, 2004).

4
L’appellation d’indices est réservée donc aux désinences et aux pronoms
« dépendants », alors que l’étiquette de pronoms s’applique aux pronoms employés sans
support verbal.
Sans contester la légitimité de la discrimination entre ces deux types d’unités
morphologiques, on optera ici pour une autre démarche visant à répondre à un besoin
méthodologique. En remplaçant dans le terme d’ « indice pronominal » son deuxième
constituant par « personnel », on se plie à une logique d’addition. La modification vise à
mettre en valeur l’unité fonctionnelle des pronoms et des indices jusque là opposés.
Le fait de parler d’ « indice », de « marque » ou de « marqueur » personnel représente
au fond une tentative d’embrasser dans un terme générique l’ensemble des phénomènes
linguistiques qui ont trait à la catégorie de la personne. A l’intérieur de cet ensemble on
retrouve les pronoms personnels, les adjectifs et les pronoms possessifs, les formes
personnelles du verbe, pour n’en citer que les classes traditionnellement recensées quand il y
va de la catégorie de la personne. Dans le contexte de l’étude contrastive des réalisations de la
personne en français et en bulgare l’emploi du terme d’ « indice de personne » revêt le
caractère d’une étape opératoire. Comme cela va être montré par la suite, l’apparition du
pronom à côté du verbe est d’ordre systématique en français mais ne l’est pas en bulgare.
D’autre part, les pronoms français connus sous l’étiquette de pronoms disjoints, voient
souvent apparaître comme leurs équivalents en bulgare également des pronoms personnels et
non plus la seule désinence du verbe. Mais comment analyser les cas où l’emploi du pronom
bulgare n’est pas facultatif ni le résultat d’une visée emphatique. S’agit-il alors d’un emploi
indexical du pronom « autonome » ? L’analyse de toutes ces formes et occurrences en terme
d’ « indice de personne » donne les moyens de surmonter la disparité morphologique entre
pronoms et formes verbales pour essayer de découvrir des fonctionnements et des contenus
notionnels communs.
2.2. La place des indices de personne dans le texte dramatique
La possibilité du dialogue théâtral repose comme pour n’importe quel autre dialogue
sur la réversibilité d’un « je » et d’un « tu » à l’intérieur de « tours de parole » successifs.
La double articulation du théâtre qui l’apparente à la fois à l’écrit et à l’oral en fait un
terrain propice pour l’analyse des indices de personne, ceux-ci manifestant pleinement la
richesse de leur paradigme dans le cadre d’échanges verbaux entre deux ou plusieurs
interlocuteurs.

5
C’est au niveau médian où évoluent les personnages que se construisent et s’habillent
en structures linguistiques les relations de personne. C’est aux personnages seuls que réfèrent
les déictiques dans le texte théâtral.
7
Quant aux didascalies, elles sont une partie intégrante de l’écrit dramatique mais se
distinguent du reste de son tissu textuel. Les indices de personne qui s’y retrouvent obéissent
à des règles particulières.
3. Hypothèses
L’analyse initiale du corpus permet de formuler l’hypothèse que dans le texte de
théâtre il existe deux plans distincts du fonctionnement des indices de personne.
Le premier qu’on va appeler plan de base concerne l’usage basique des indices de
personne dans la construction des énoncés. C’est le niveau où les indices personnels
fonctionnent comme de simples éléments constitutifs dont la présence est indispensable pour
assurer la bonne syntaxe du texte.
Le deuxième plan qu’on pourrait nommer plan de mise en valeur se rapporte à des
emplois spécifiques des marqueurs de personne qui représentent une déviation (transfert de
personne) ou une surenchère (reprise emphatique) de l’emploi basique et auxquels l’auteur du
texte dramatique fait appel pour atteindre un objectif dramaturgique précis.
C. Kerbrat-Orecchioni fait remarquer que pour l’auteur « il s’agit moins de rechercher
la vraisemblance que de se plier aux exigences de l’efficacité dramatique ».
En reprenant les termes utilisés et en reformulant légèrement cette affirmation, on
pourrait dire que les indices de personne agissent dans le texte dramatique sur l’axe de la
vraisemblance (c’est-à-dire de la correspondance à la règle, de la correction syntactico-
sémantique) et sur l’axe de l’efficacité. Par ailleurs il paraît que ses deux axes ne s’opposent
pas l’un à l’autre mais sont plutôt complémentaires.
7
C. Kerbrat-Orecchioni, 1985.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%